La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numéro 8 : Règlement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (stockage et chargement de liquides pétroliers volatils)
Les commentaires sont temporairement désactivés. Veuillez réessayer plus tard.
Le 24 février 2024
Fondement législatif
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Ministères responsables
Ministère de l’Environnement
Ministère de la Santé
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Commentaire général
Résumé
Enjeux : Les rejets de composés organiques volatils (COV) pendant le stockage et le chargementréférence 1 de liquides pétroliers posent des risques pour l’environnement et la santé des Canadiens. L’ensemble hétéroclite de mesures volontaires et obligatoires actuellement en place ne remédie pas suffisamment aux risques présentés par les rejets de COV en tant que précurseurs du smog pendant le stockage et le chargement de liquides pétroliers. De plus, ces mesures ne permettent pas d’atténuer de façon adéquate les risques pour la santé engendrés par certains COV cancérigènes, comme le benzène. Compte tenu des risques pour la santé humaine et l’environnement posés par les COV et du fait qu’un grand nombre d’installations de stockage et de chargement de liquides pétroliers se trouvent à proximité de communautés autochtones et d’autres secteurs résidentiels, un règlement est nécessaire pour réduire les rejets de COV provenant de ces installations.
Description : Le projet de Règlement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (stockage et chargement de liquides pétroliers) [le projet de règlement] exigerait que les réservoirs de stockage et les rampes de chargement de liquides pétroliers soient équipés d’équipement de contrôle des émissions. Les exploitants de ces installations auraient l’obligation d’installer, d’inspecter, d’entretenir et de réparer cet équipement afin d’obtenir des résultats de contrôle des émissions appropriés. Le projet de règlement comprendrait également des exigences en matière de tenue de registres et de production de rapports que les exploitants seraient tenus de respecter. Les installations qui seraient assujetties au projet de règlement incluraient les terminaux et les dépôts routiers de liquides pétroliers, les raffineries de pétrole, les usines de valorisation et les installations pétrochimiques dans l’ensemble du Canada.
Justification : En raison des lacunes dans la couverture offerte par les instruments provinciaux et municipaux actuels en matière de réduction des émissions de COV, les Canadiens ne bénéficient pas d’une protection uniforme à l’échelle nationale contre les risques pour la santé et l’environnement posés par les émissions de COV provenant du stockage et du chargement de liquides pétroliers. Par ailleurs, l’exposition par inhalation au benzène est particulièrement préoccupante pour les populations des régions où les émissions provenant des opérations de stockage et de chargement augmentent les concentrations atmosphériques de ce polluant dans l’air. Le projet de règlement permettrait de combler ces lacunes grâce à l’introduction d’exigences réglementaires nationales, notamment pour les installations préoccupantes. Dans l’ensemble, au cours de la période d’analyse (de 2024 à 2045), le projet de règlement réduirait les rejets d’émissions fugitives de COV d’environ 494 kilotonnes (kt) et les émissions de méthane d’environ 8 kt. Ces réductions se traduiraient par une amélioration de la santé humaine et de l’environnement ainsi que par des avantages pour les entreprises en raison de la perte évitée de produits pétroliers. À l’heure actuelle, on estime la valeur des avantages à environ 1,43 milliard de dollars et la valeur des coûts à environ 1,09 milliard de dollars, pour un bénéfice net de 337 millions de dollars. Le projet de règlement est conçu de manière à pouvoir être harmonisé, lorsque cela est possible, avec les exigences réglementaires de diverses administrations, y compris des municipalités, les provinces et les États-Unis, où la réglementation est en place depuis les années 1980.
Enjeux
Les activités de stockage et de chargement de liquides pétroliers sont parmi les plus importantes sources de rejets non contrôlés de COV dans les secteurs pétrolier et pétrochimique. Les mesures volontaires et obligatoires actuellement en place ne remédient pas suffisamment aux risques pour la santé et l’environnement posés par les COV en tant que précurseurs du smog, pas plus qu’elles ne permettent d’atténuer de façon adéquate les risques pour la santé de certains COV cancérigènes, comme le benzène. Il n’est pas rare que plusieurs grandes installations soient situées à proximité l’une de l’autre dans les zones urbaines et périurbaines, ce qui augmente le risque d’exposition de la population locale à des concentrations élevées de benzène. Une surveillance de l’air ambiant réalisée non loin de certaines installations a permis de relever des concentrations de benzène qui pourraient être dommageables pour la santé humaine. Étant donné qu’un grand nombre d’installations de stockage et de chargement se trouvent à proximité de communautés autochtones et d’autres secteurs résidentiels, un règlement uniforme à l’échelle nationale est nécessaire pour protéger les Canadiens des effets nocifs découlant des rejets de COV par les installations de stockage et de chargement de liquides pétroliers.
Contexte
Composés organiques volatils
Les COV sont les précurseurs dans la formation de l’ozone troposphérique et des particules fines, qui sont les principaux constituants du smog. Il a été prouvé que l’ozone troposphérique et les particules fines (plus particulièrement les particules fines d’un diamètre égal ou inférieur à 2,5 micromètres [PM2,5]) étaient préjudiciables à la santé humaine. L’exposition à ces polluants augmente le risque d’un large éventail de problèmes de santéréférence 2. En raison de leur rôle en tant que précurseurs dans la formation de l’ozone troposphérique et des particules fines, les COV ont été inscrits à la Liste des substances toxiques de la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE].
Du point de vue de la santé humaine, les données scientifiques indiquent qu’une exposition de courte durée à l’ozone troposphérique cause divers symptômes respiratoires et constitue un facteur de risque de décès prématuré. Certains symptômes, comme l’essoufflement et la réduction de la fonction pulmonaire, peuvent se conclure par des visites à l’hôpital. L’exposition de longue durée à l’ozone troposphérique a été associée à une variété d’effets indésirables sur la santé, comme l’apparition de l’asthme, la mortalité de cause respiratoire et des changements structurels des poumonsréférence 3,référence 4. En outre, il a été démontré à l’appui de données probantes considérables et solides que l’exposition aux PM2,5 était aussi liée à des effets indésirables sur la santéréférence 5. L’exposition de courte durée aux PM2,5 peut causer des insuffisances cardiaques, des crises d’asthme et des décès prématurés, tandis que l’exposition de longue durée peut causer des décès prématurés et est une cause probable de cancer du poumon et de maladies cardiaques et pulmonaires. Il n’existe aucun seuil d’exposition à l’ozone troposphérique ou aux PM2,5 en deçà duquel il n’y a aucun risque pour la population. Dans l’ensemble, l’exposition à ces deux polluants donne lieu à une plus grande quantité de journées d’activité restreinte, de visites à l’urgence, d’hospitalisations et de mortalité prématurée.
Par ailleurs, des données environnementales révèlent que l’ozone troposphérique peut aussi avoir une incidence négative sur les processus biochimiques et physiologiques, comme la photosynthèse. L’exposition à l’ozone troposphérique peut ainsi endommager les cellules foliaires, voire entraîner leur mort. Les effets néfastes sur les espèces végétales sensibles sont particulièrement préoccupants pour les secteurs de l’agriculture et de la foresterie dont la viabilité économique pourrait être touchée de façon défavorableréférence 6. Les particules fines peuvent s’accumuler sur les surfaces et altérer les caractéristiques optiques de ces dernières, causant de la saleté visible et pouvant exiger davantage d’efforts de nettoyage. Elles peuvent aussi réduire la visibilité en bloquant et en diffusant la lumière directe du soleil dans l’atmosphère.
Benzène
Le benzène est un composé des COV et un agent cancérogène pour les humains inscrit à la Liste des substances toxiques de la LCPE. L’on sait, d’après des données provenant d’études menées chez l’humain et des animaux de laboratoire, que le benzène peut causer le cancer. Dans les études axées sur le lien entre le benzène et le cancer, on s’est surtout concentré sur la leucémie et d’autres formes de cancer des cellules sanguines. L’évaluation du benzène au titre de la LCPE publiée en 1993 par le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé indiquait que l’examen des options en vue de réduire l’exposition au benzène devrait être d’une priorité élevée et qu’une telle exposition devait être réduite dans toutes les situations possiblesréférence 7. Dans l’Inventaire national des rejets de polluants, il est indiqué que les raffineries, les usines de valorisation et les installations pétrochimiques au Canada rejettent du benzène dans leur milieu environnantréférence 8. On s’attend à ce que les rejets de substances cancérigènes par ces installations contribuent aux risques de cancer pour les Canadiens qui habitent à proximité.
L’Évaluation préalable – Approche pour le secteur pétrolier : Condensats de gaz naturel référence 9 du gouvernement du Canada a conclu que les expositions par inhalation aux émissions par évaporation de condensats de gaz naturel provenant des sites de chargement de camions et de trains et des lieux de stockage des condensats de gaz naturel pouvaient constituer un danger pour la vie ou la santé humaines. Ce danger est associé à l’exposition au benzène, un composant très dangereux des condensats de gaz naturel.
Les stations de stockage et de déchargement aux stations-service peuvent aussi présenter des risques similaires d’exposition aux émissions pour les populations locales, et un récent rapport du ministère de la Santé a conclu que l’« exposition par inhalation au benzène attribuable aux émissions des stations-service peut présenter des risques inacceptables pour la santé de la population vivant à proximité »référence 10. L’exposition de courte durée à des concentrations élevées de benzène près des stations-service peut aussi présenter un risque pour les personnes enceintes et leur fœtus en développement.
L’analyse du ministère de l’Environnement (le Ministère) a révélé que certaines communautés, comme la Première Nation Aamjiwnaang non loin de Sarnia, en Ontario, pourraient être exposées à des concentrations ambiantes élevées de benzène pouvant présenter un risque pour la santé humaine. De récentes données de surveillance de l’air et mesures de la limite de propriété des installations ont permis d’établir un lien entre les activités et de stockage et de chargement et les concentrations élevées de benzène dans certaines communautés.
Règlements connexes
À la suite des évaluations préalables réalisées dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiquesréférence 11 qui ont permis de relever les risques pour la santé humaine, le Ministère, en collaboration avec le ministère de la Santé, a élaboré un règlement afin de contrôler les émissions fugitives de COV des secteurs pétrolier et pétrochimique. Le Règlement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (secteur pétrolier) a été finalisé en novembre 2020. Ce règlement limite les émissions fugitives, y compris de substances cancérigènes comme le benzène, provenant des fuites d’équipement aux raffineries de pétrole, aux usines de valorisation et aux installations pétrochimiques qui sont intégrées à une raffinerie de pétrole ou à une usine de valorisation.
Au cours des consultations sur le Règlement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (secteur pétrolier) qui ont eu lieu de 2016 à 2018, un certain nombre de peuples autochtones et d’organisations non gouvernementales ont souligné que des mesures supplémentaires devaient être prises pour aborder les autres sources de COV, dont le stockage et le chargement de liquides pétroliers. Le projet de règlement aborderait ces sources d’émissions supplémentaires.
Il existe un règlement fédéral qui traite des réservoirs de stockage de produits pétroliers, soit le Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés (le règlement modifié)référence 12, promulgué en juin 2008 et modifié en 2020 dans le but de réduire les fuites liquides et les déversements des systèmes de stockage de produits pétroliers. Ce règlement ne porte pas sur les polluants émis directement dans l’atmosphère, dont les émissions atmosphériques de COV, et il régit une plus vaste gamme de réservoirs de stockage que le projet de règlement, y compris les très petits réservoirs de stockage et les réservoirs qui contiennent des liquides non volatilsréférence 13, comme le diesel et le mazout domestique. Par ailleurs, le règlement de 2008 ne vise que les réservoirs situés sur des terres fédérales ou autochtones ou exploitées par des organismes précis qui relèvent du gouvernement fédéral. La majorité des installations visées par le règlement modifié comprennent des sites qui stockent de petites quantités d’hydrocarbures (essence, diesel, carburéacteur et mazout) en vue d’un usage local.
Mesures de gestion des risques existantes au Canada
Deux instruments volontaires publiés par le Conseil canadien des ministres de l’environnement (CCME) portent spécifiquement sur le stockage et le chargement de liquides pétroliers, à savoir le Code de recommendations techniques pour la protection de l’environnement applicable à la récupération des vapeurs dans les réseaux de distribution d’essence (CCME PN 1058), publié en 1991, et des lignes directives environnementales sur la réduction des émissions de composés organiques volatils par les réservoirs de stockage hors sol (CCME PN 1181), publiées en 1995.
Certaines des installations visées par ces instruments volontaires sont également assujetties à des mesures provinciales ou municipales obligatoires, adaptées en grande partie des instruments volontaires du CCME. À titre d’exemple, Metro Vancouver impose des exigences relatives au contrôle des vapeurs lors du chargement d’essence, tandis que Québec impose des exigences relatives à la conception des réservoirs de stockage. De leur côté, Montréal, certaines parties de l’Ontario et Terre-Neuve-et-Labrador imposent des exigences relatives au contrôle des vapeurs lors du chargement d’essence ainsi qu’à la conception, à l’entretien et à l’inspection des réservoirs de stockage. Autrement dit, les terminaux dans ces administrations présentent généralement des intensités d’émissions beaucoup plus faibles que les terminaux dans les autres administrations, où le contrôle des émissions n’est pas réglementé.
Un certain nombre d’installations de stockage et de chargement de liquides pétroliers ne sont pas visées par les instruments volontaires du CCME, des instruments provinciaux ou des exigences municipales, dont un grand nombre d’activités de chargement ferroviaire et maritime, de pétrole brut et de produits pétrochimiques. Les permis d’exploitation de certaines installations font référence aux directives volontaires du CCME en ce qui concerne les réservoirs, mais la conformité générale avec certains éléments de ces directives, en particulier les exigences en matière d’inspection, est faible dans le secteur, si l’on en croit les séances de mobilisation et les discussions détaillées menées à ce jour.
Les émissions de COV dans le secteur du pétrole en amontréférence 14 sont régies par le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) de 2018. Ce règlement n’aborde pas les risques liés aux émissions de COV provenant des activités de stockage et de chargement aux terminaux de pétrole brut ni les activités de chargement aux sites de production de pétrole et de gaz.
La diversité des instruments connexes susmentionnés mis en œuvre par les différentes administrations, le cas échéant, signifie que les installations adoptent des approches variées pour atténuer les émissions de COV. De plus, les données de surveillance continuent de faire état de concentrations ambiantes élevées de benzène à proximité des installations de stockage et de chargement des liquides pétroliers, malgré les mesures fédérales et provinciales existantes. Par conséquent, il n’existe aucune norme de protection uniforme contre les risques pour la santé associés aux émissions de COV.
Sources d’émissions
Les sources d’émissions de COV comprennent les réservoirs de stockage et les rampes de chargement que l’on retrouve dans les terminaux, les raffineries, les usines de valorisation, les installations pétrochimiques et les dépôts routiers qui stockent de grandes quantitésréférence 15 de liquides pétroliers volatils. Selon les données du Ministère, les émissions totales de COV provenant de ces installations étaient de 53 790 tonnes en 2019, dont environ 63 % (33 878 tonnes) étaient attribuables au stockage et au chargement de liquides pétroliers volatils. Les émissions provenant du stockage prennent généralement la forme d’émissions par évaporation, en raison de contrôles des émissions inadéquats et à une mauvaise étanchéité des réservoirs dans lesquels sont stockés les liquides volatils. Les émissions provenant du chargement sont principalement attribuables à l’évacuation pendant les opérations de transfert des produits, particulièrement en l’absence d’équipement de contrôle des émissions. Les tableaux 1 et 2 présentent un résumé des installations par province et territoire, et une estimation des émissions de COV découlant des activités de stockage et de chargement, respectivement.
Les terminaux incluent les terminaux de pétrole brutréférence 16 et les terminaux primaires (produits raffinés)référence 17. Le transport du pétrole vers ces installations et à partir de celles-ci se fait au moyen de divers modes de transport, dont les pipelines, les navires, les wagons et les camionsréférence 18. Les terminaux primaires ont tendance à être situés près de secteurs plus densément peuplés; il peut s’agir d’installations autonomes ou d’installations intégrées à des raffineries de pétrole.
Les raffineries traitent du pétrole brut ou du pétrole brut synthétique (PBS) et produisent des carburants de transport, l’essence étant le produit le plus courant. Celles-ci produisent également du diesel, des mazouts domestiques, des lubrifiants, du pétrole lourd, de l’asphalte pour les routes et des matières premières pour les installations pétrochimiques. La majorité des produits raffinés produits au Canada sont destinés au marché intérieur, tandis que d’autres sont exportés, principalement aux États-Unis.
Les usines de valorisation convertissent le bitume ou le pétrole lourd en PBS et certaines peuvent aussi produire des produits pétroliers raffinés, comme le diesel et le kérosène. La plupart des installations sont intégrées ou associées à des processus d’extraction de sables bitumineux. La majorité du PBS est exporté aux États-Unis, bien qu’une partie soit transportée vers des raffineries canadiennes.
Les installations pétrochimiques transforment des matières premières, comme le pétrole raffiné, le gaz naturel ou les liquides de gaz naturel, en produits tels que le styrène, le xylène, le benzène et le butadiène. Ces produits sont vendus à des installations de fabrication de produits chimiques canadiennes ou exportés, principalement aux États-Unis.
Les dépôts routiersréférence 19 sont situés dans des régions moins densément peuplées où il n’est pas économique ni pratique de livrer des produits aux utilisateurs finaux à partir de terminaux primairesréférence 20. Les dépôts routiers sont des installations de stockage et de distribution plus petites que les terminaux primaires. De façon générale, elles se font livrer des produits par camions-citernes à partir d’un terminal primaire et leurs réservoirs de stockage sont à toit fixe.
| Province/ territoire | Installation de produits chimiques | Terminal de pétrole brut | Terminal primaire | Raffinerie | Terminal de raffinerie | Usine de valorisation | Dépôt routier | Total | % du total des installations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.-N.-L. | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 5,8 |
| Î.-P.-É. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4 |
| N.-É. | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2,1 |
| N.-B. | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2,5 |
| Qc | 3 | 3 | 13 | 2 | 1 | 0 | 5 | 27 | 11,1 |
| Ont. | 7 | 6 | 18 | 5 | 3 | 0 | 22 | 61 | 25,1 |
| Man. | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3,3 |
| Sask. | 0 | 16 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 24 | 9,9 |
| Alb. | 3 | 34 | 5 | 5 | 2 | 5 | 7 | 61 | 25,1 |
| C.-B. | 0 | 5 | 19 | 2 | 1 | 0 | 6 | 33 | 13,6 |
| Yn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| T.N.-O. | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,2 |
| Nt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Total | 13 | 71 | 74 | 17 | 7 | 6 | 55 | 243 | 100,0 |
| Province / territoire | Installation de produits chimiques | Terminal de pétrole brut | Terminal primaire | Raffinerie | Terminal de raffinerie | Usine de valorisation | Dépôt routier | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.-N.-L. | 0 | 0 | 1 095 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 120 |
| Î.-P.-É. | 0 | 2 008 | 510 | 1 465 | 0 | 634 | 75 | 4 692 |
| N.-É. | 92 | 384 | 1 872 | 1 076 | 24 | 0 | 29 | 3 476 |
| N.-B. | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 |
| Qc | 0 | 83 | 210 | 1 075 | 0 | 0 | 25 | 1 392 |
| Ont. | 0 | 525 | 1 787 | 414 | 0 | 0 | 54 | 2 781 |
| Man. | 355 | 324 | 1 055 | 3 810 | 18 | 0 | 94 | 5 658 |
| Sask. | 0 | 0 | 1 915 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 924 |
| Alb. | 191 | 3 847 | 1 679 | 1 788 | 2 001 | 1 212 | 176 | 10 893 |
| C.-B. | 0 | 427 | 945 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 397 |
| Yn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.N.-O. | 0 | 232 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 |
| Nt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 638 | 7 829 | 11 381 | 9 628 | 2 043 | 1 846 | 513 | 33 878 |
Objectif
Les objectifs du projet de règlement sont les suivants :
- réduire les émissions fugitives de COV provenant des réservoirs de stockage et de l’équipement de chargement de liquides pétroliers au Canada;
- protéger la santé humaine en réduisant au minimum, dans toute la mesure du possible, l’exposition aux COV cancérigènes, comme le benzène;
- améliorer la qualité de la santé humaine et de l’environnement grâce à la réduction de la pollution atmosphérique;
- faire la promotion de règles du jeu équitables au moyen de mesures de gestion des risques liés aux COV uniformes à l’échelle du pays;
- dans la mesure du possible, harmoniser ces mesures avec les mesures existantes dans d’autres administrations (par exemple les provinces, les municipalités et les États-Unis);
- offrir une certitude réglementaire afin de permettre aux propriétaires d’installations de prendre des décisions éclairées en matière d’investissement à long terme et de renforcer la confiance chez les autres parties intéressées quant au fait que des résultats en matière d’environnement et de santé seront obtenus.
Description
Le projet de règlement établirait des exigences fondées sur l’équipementréférence 21 pour les réservoirs de stockage de liquides pétroliers volatils nouveaux et existants ainsi que pour les activités de chargement aux installations pétrolières et pétrochimiques (ci-après nommées les « installations réglementées ») situées au Canada. L’applicabilité serait propre à l’installation, et l’exploitant de chacune des installations réglementées (ci-après nommé l’« exploitant ») serait tenu de faire ce qui suit :
- installer de l’équipement de contrôle des émissions sur les réservoirs de stockage et l’équipement de chargement;
- mettre en œuvre des processus d’inspection et de réparation;
- tenir des registres et produire des rapports.
Le projet de règlement définit des critères relatifs au délai prévu dont disposent les installations réglementées pour mettre l’équipement en conformité; ces critères sont fondés sur l’état antérieur de l’équipement et les risques d’émissions. La mise en œuvre du projet de règlement suivrait une approche progressive qui exigerait que les installations réglementées accordent la priorité à l’équipement émettant le plus de COV. Veuillez vous reporter à la sous-section « Entrée en vigueur » pour plus de détails.
Échantillonnage et essais
Le projet de règlement exige l’utilisation de méthodes normalisées de l’ASTM International (auparavant connue sous le nom de American Society for Testing and Materials) ou de l’Office des normes générales du Canada (incorporées par référence) lors de l’échantillonnage et de l’essai de liquides pour déterminer la concentration de COV, la pression de vapeur réelle ou la concentration de benzène. Un système de permis permettrait au ministre d’approuver des solutions de rechange à ces méthodes normalisées dans les cas où les méthodes spécifiées ne sont pas applicables au liquide soumis à l’essai, dans les cas où un exploitant a identifié une méthode qui produit des résultats plus exacts ou plus précis, ou dans les cas où un exploitant souhaite utiliser un échantillonnage ou un test automatisé, mais où l’automatisation n’est pas supportée par les méthodes spécifiées.
Le projet de règlement exigerait que les instruments soient conformes aux exigences de conception et de performance lorsqu’ils sont utilisés pour effectuer des inspections, telles que les essais d’étanchéité des systèmes de contrôle des vapeurs ou les essais de limite inférieure d’explosivité des réservoirs à toit flottant interne.
Équipement de contrôle des émissions
Les installations réglementées seraient tenues d’installer, d’entretenir et de réparer de l’équipement de contrôle des émissions sur les réservoirs de stockage de liquides pétroliers et les rampes de chargement où l’on manipule des liquides pétroliers volatils, comme il est décrit dans le tableau 3. La conception et le fonctionnement de cet équipement seraient assujettis aux normes établies ou incorporées par renvoi dans le projet de règlement.
| Type d’installation | Exigence |
|---|---|
| Grands réservoirs (volume interne supérieur à 100 m3) | Toit flottant interne, toit flottant externe ou système de contrôle des vapeurs |
| Petits réservoirs (volume interne de 4 m3 à 100 m3) | Évent à pression-dépression |
| Réservoirs dont le volume interne est inférieur à 4 m3 | Aucune exigence |
| Réservoirs dont le volume interne est égal ou supérieur à 4 m3 et qui stockent des liquides pétroliers à teneur élevée en benzène (plus de 20 % en poids) ou ayant une pression de vapeur élevée (plus de 76 kPa de pression de vapeur réelle) | Système de contrôle des vapeurs note a du tableau a3 |
| Rampes de chargement | Système de contrôle des vapeurs Système de retour en boucle des vapeurs permis aux dépôts routiers |
| Rampes de chargement à faible débit note b du tableau a3 | Aucun équipement de contrôle des émissions exigé |
Note(s) du tableau a3
|
|
Le projet de règlement établirait également un système de permis qui permettrait l’utilisation d’équipements de contrôle des émissions de substitution.
Inspections et réparations
Les exploitants auraient l’obligation d’inspecter l’équipement de contrôle des émissions et de faire les réparations nécessaires, au besoin, notamment :
- inspection visuelle mensuelle des réservoirs à toit flottant pour détecter les défauts majeurs ou les débordements;
- analyse mensuelle de la limite inférieure d’explosivité des réservoirs à toit flottant interne;
- mesure annuelle des espaces entre les joints de bordure secondaires des réservoirs à toit flottant externe; la mesure des espaces entre les joints de bordure primaires, quant à elle, serait requise tous les cinq ans;
- inspection interne des réservoirs, y compris des joints d’étanchéité, tous les vingt ans;
- inspection annuelle des évents à pression-dépression;
- entretien d’un système de surveillance continue des émissions sur les systèmes de contrôle ou de destruction des vapeurs;
- inspection mensuelle des systèmes de contrôle des vapeurs afin de détecter les fuites.
Les exploitants seraient tenus de réparer les défauts de l’équipement de contrôle des émissions dans les délais prévus dans le projet de règlement, à compter de la date à laquelle le défaut a été découvert. Des délais étendus seraient autorisés dans des circonstances précises, notamment lorsque l’installation réglementée a déjà plusieurs réservoirs hors service, lorsqu’il y a des problèmes de vidange ou de nettoyage des réservoirs pour préparer la réparation, ou lorsqu’il y a un risque de perturbation importante des activités. Il serait exigé de prendre des mesures d’atténuation des émissions provisoires lorsque les délais de réparation standard ne peuvent pas être respectés, et la préparation et la mise en œuvre d’un plan de réduction des émissions seraient requises lors du nettoyage de l’intérieur d’un réservoir ou du remplacement du joint de rebord d’un réservoir à toit flottant interne ou externe.
Les exploitants seraient tenus d’effectuer les réparations aux réservoirs à toit flottant dans un délai de 45 jours, ou jusqu’à 180 jours si les délais étendus s’appliquentréférence 22, et d’effectuer les réparations aux systèmes de contrôle des vapeurs dans un délai de 15 jours, ou jusqu’à 40 jours si les délais étendus s’appliquent. Un délai de réparation plus court serait nécessaire pour les événements à plus haut risque d’émission, par exemple lorsque des toits flottants coulent ou sont inondés. Les délais de réparation ne s’appliqueraient pas pendant les périodes où l’équipement nécessitant une réparation a temporairement été mis hors service, par exemple lorsqu’un réservoir a été vidé et nettoyé, et ils seraient étendus si l’équipement a été doté d’un système temporaire de contrôle des vapeurs pour contrôler les émissions.
Tenue de registres et production de rapports
Les exploitants devraient :
- tenir des registres sur les inspections, l’entretien, les spécifications de l’équipement et la formation du personnel;
- conserver ces registres pendant six ans, à l’exception des registres portant sur la conception et la construction de l’équipement, qui seraient conservés pendant toute la durée de vie de l’équipement, ainsi que les registres portant sur les inspections effectuées à des intervalles supérieurs à six ans, lesquels seraient conservés jusqu’à la date de la prochaine inspection;
- enregistrer les installations réglementées auprès du Ministère;
- soumettre des rapports si certaines défaillances des réservoirs ou des systèmes de contrôle des vapeurs se produisaient, notamment les cas où des toits flottants ont coulé ou ont été inondés, et les cas où il a fallu faire fonctionner une rampe de chargement pendant plus de 24 heures sans système de contrôle des vapeurs fonctionnel.
Champ d’application
Le projet de règlement s’appliquerait aux terminaux, aux raffineries, aux usines de valorisation, aux installations pétrochimiques et aux dépôts routiers qui :
- stockent des liquides pétroliers volatils dans des réservoirs qui atteignent ou dépassent une capacité déterminée, en général 100 m3;
- chargent et déchargent des liquides pétroliers volatils qui dépassent une quantité quotidienne ou annuelle déterminée, en général 500 000 litres standard par jour ou 25 millions de litres standard par anréférence 23.
Un liquide pétrolier est considéré comme volatil s’il est liquide dans les conditions normales (20 °C, 101,325 kPa) et a une pression de vapeur réelle supérieure à 10 kPa dans ces conditions (ou dans les conditions réelles de stockage s’il est chauffé), ou supérieure à 3,5 kPa s’il contient également plus de 2 % de benzène par poids. Selon cette définition, l’essence, la plupart des pétroles bruts, certains produits intermédiaires et certains produits chimiques seraient visés par le projet de règlement, mais pas les liquides à faibles émissions de COV, comme le carburant diesel, le carburéacteur de type kérosène, le mazout de chauffage et certains pétroles bruts lourds.
Les installations dont les émissions sont à faible risque et qui pourraient être visées par des exemptions comprennent les suivantes :
- les installations de vente de carburant au détail;
- les réservoirs et les rampes de stockage assujettis au Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont);
- les installations extracôtières situées à plus de 5 km des côtes;
- les installations où l’on ne retrouve que des réservoirs dont le volume interne est inférieur à 4 m3, des réservoirs de véhicule ou des appareils à pression;
- les terminaux et les dépôts routiers qui répondent aux critères énoncés dans le tableau 4.
Tableau 4 : Critères pour l’exemption d’installations supplémentaires
Remarque : Les installations qui traitent des produits liquides ayant une teneur en benzène, en poids, d’au moins 2 % ne peuvent pas faire l’objet d’exemptions.
| Type d’installation | Distance minimale du centre de population le plus près (en km) | Distance minimale de l’immeuble occupé le plus près (en m) | Capacité de stockage maximale sur place (en m3) | Capacité annuelle de chargement/déchargement note a du tableau a4 (en m3/année) | Capacité quotidienne de chargement/déchargement note b du tableau a4 (en m3/jour) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dépôts routiers de très petite taille | S.O. | S.O. | 500 | 1 000 | S.O. |
| Dépôts routiers et terminaux de petite taille | S.O. | 300 | 2 000 | 25 000 | 500 |
| Terminaux ou dépôts routiers de petite taille et éloignés | 100 | S.O. | 5 000 | 30 000 | 2 000 |
Note(s) du tableau a4
|
|||||
Entrée en vigueur
Le projet de règlement entrerait en vigueur dès l’enregistrement, mais permettrait l’application différée de certaines dispositions. Les installations réglementées seraient tenues de veiller à ce que les nouveaux réservoirs de stockage et les nouvelles rampes de chargement (ceux qui entrent en service après l’enregistrement du projet de règlement) soient conformes à toutes les exigences au moment où ils sont utilisés pour la première fois pour stocker ou charger des liquides pétroliers.
Les installations réglementées seraient tenues de mettre en conformité un certain pourcentage de leurs rampes de chargement et réservoirs de stockage existants chaque année. Une période d’un à trois ans serait allouée pour la mise en conformité de l’équipement, en fonction de son état antérieur et des risques d’émissions qu’il présente. Les réservoirs contenant des liquides dont la teneur en benzène est particulièrement élevée (plus de 20 % par poids) seraient soumis à des délais de mise en œuvre plus courts. Au moins 80 % des réservoirs d’une installation devraient être mis en conformité au cours des trois premières années et, chaque année, le pourcentage de réservoirs non conformes devraient être réduit de 5 %. Une certaine souplesse pourrait être offerte concernant le délai de mise en conformité, avec des exigences particulières relatives aux joints d’étanchéité et aux raccords des toits flottants, lorsque les inspections des réservoirs démontrent un rendement continu en matière de contrôle des émissions.
Dans les cas où une grande partie des rampes de chargement ou des réservoirs existants exigent l’installation d’un équipement de contrôle des émissions, une période de mise en œuvre pouvant aller jusqu’à sept ans pourrait être accordée pour les réservoirs et une période pouvant aller jusqu’à cinq ans pour les rampes de chargement. Les installations réglementées seraient tenues de soumettre un plan de mise en œuvre et de confirmer le moment où elles se conforment avec le projet de règlement.
Sur la base de cette approche progressive et en supposant que le projet de règlement entre en vigueur en 2024, on estime que la plupart des rampes de chargement à fortes émissions seront équipées de systèmes de contrôle des émissions entre 2025 et 2027 et que la plupart des réservoirs, y compris tous les réservoirs présentant les risques d’émissions de benzène les plus élevés, seront mis en conformité d’ici à la fin de 2027. Le reste de l’équipement serait mis en conformité à un rythme de 14 % par année chaque année jusqu’en 2031, année où tout l’équipement devra être conforme au projet de règlement. Le tableau 5 présente un résumé des délais de conformité.
| Date |
Éléments devant être conformes au projet de règlement |
Flexibilité de conformité |
|---|---|---|
Lors de l’enregistrement |
|
s.o. |
Un an après l’enregistrement |
|
s.o. |
Trois ans après l’enregistrement |
Contrôles des émissions pour au moins 80 % des réservoirs existants à l’installation, ou pour tous les réservoirs existants si deux ou moins ont nécessité l’installation d’un nouvel équipement de contrôle des émissions |
Jusqu’à quatre années supplémentaires pour mettre en conformité les réservoirs existants restants, à un rythme de 5 % du nombre total de réservoirs à l’installation par an |
Trois ans après l’enregistrement |
Contrôles des émissions pour les rampes de chargement à émissions plus élevées |
Jusqu’à deux années supplémentaires pour mettre en conformité les rampes de chargement à émissions moins élevées restantes |
Élaboration de la réglementation
Consultation
Premières consultations — de 2021 à 2023
Les premières consultations remontent à mai 2021, au moment de la diffusion d’un document de travail intitulé « Une approche proposée pour le contrôle des émissions de composés organiques volatils (COV) provenant du stockage et du chargement de liquides pétroliers ». Le Ministère avait alors communiqué avec des représentants de l’industrie, des gouvernements provinciaux, territoriaux et municipaux, des groupes autochtones et des organisations non gouvernementales pour les aviser de la publication du document de travail et recueillir leurs commentaires concernant l’approche proposée. Une période de commentaires informelle d’une durée de 60 jours a suivi, avant de prendre fin en juillet 2021. On a mené, plus récemment, des consultations auprès des collectivités autochtones et des parties concernées jusqu’à l’automne 2023.
Dans les semaines qui ont suivi la publication du document de travail, le Ministère a tenu des webinaires, en anglais et en français, en vue d’offrir des précisions sur l’approche proposée; en tout, 250 personnes y ont assisté. Il a également organisé des réunions avec plusieurs organismes pour répondre à leurs questions et à leurs préoccupations. Le Ministère a reçu 30 observations écrites de la part d’organismes de l’industrie, de sociétés individuelles, de gouvernements provinciaux, territoriaux et municipaux, ainsi que de groupes autochtones. Il n’a reçu aucun commentaire écrit de la part d’organisations non gouvernementales ou de particuliers.
À l’issue de la période de commentaires officielle, le Ministère a poursuivi ses efforts de mobilisation auprès des parties concernées : il a tenu des réunions et communiqué par téléphone et par courriel avec des organismes de l’industrie, des sociétés individuelles, des provinces et des groupes autochtones, en plus d’effectuer des visites de raffinerie, de terminaux, d’usines de produits chimiques et d’établissements dans les collectivités. Ces discussions de suivi ont permis de faire le point, entre autres, sur l’état du projet de règlement, les détails techniques, les révisions et modifications potentielles en réponse aux préoccupations, ainsi que les données additionnelles utilisées afin de préciser soit les exigences techniques, soit l’analyse coûts-avantages.
Les principaux commentaires soulevés par les parties concernées portaient sur le calendrier de la mise en œuvre et des réparations, le traitement des sources d’émissions de benzène, les procédures d’inspection et la prise en compte des installations et de l’équipement de petite taille et/ou éloignés. On a apporté d’importantes modifications à la version originale du projet de règlement en fonction de la rétroaction reçue. En voici des exemples :
- un calendrier de mise en œuvre par étapes qui permet d’accorder la priorité à l’équipement posant le plus grand risque (c’est-à-dire l’équipement qui émet le plus de COV);
- le devancement des échéances de mise en œuvre pour les sources qui présentent un potentiel élevé d’émissions de benzène (c’est-à-dire les réservoirs stockant des liquides ayant une teneur en benzène de plus de 20 %);
- l’ajustement des procédures d’inspection et de réparation (de façon à allouer davantage de temps aux réparations qu’il serait difficile ou dangereux d’effectuer rapidement, de même qu’à réduire ou à modifier les exigences d’inspection l’hiver ou par mauvais temps);
- l’exemption des installations de petite taille situées en région éloignée qui posent un risque faible pour la santé.
Le Ministère a également fait le point auprès de collectivités des Premières Nations et les provinces sur le projet de règlement lors de réunions récentes sur la pollution de l’air due au secteur pétrolier et gazier.
Commentaires reçus et réponses du Ministère
Industrie
Le Ministère a tenu de nombreuses discussions avec les représentants de l’industrie du secteur pétrolier et gazier, du secteur des produits chimiques et d’autres secteurs industriels que le projet de règlement pourrait toucher, comme le secteur des transports. Parmi les principales parties concernées ayant participé à ces discussions, mentionnons l’Association canadienne des carburants, l’Association canadienne des producteurs pétroliers, l’Alliance Canadienne du Camionnage, l’Association canadienne de l’industrie de la chimie, ainsi que des sociétés individuelles exploitant des installations pétrolières et gazières ou des installations de fabrication de produits chimiques au Canada. Les représentants ont appuyé les objectifs en matière de santé et d’environnement de l’approche provisoire, de même que la structure globale proposée (exigences concernant l’utilisation d’équipement de contrôle des émissions combinées aux exigences en matière d’inspection et de réparations). Les représentants de l’industrie ont néanmoins exprimé des préoccupations à l’égard du calendrier de mise en œuvre et de réparations proposé; ils affirment qu’il y aurait des difficultés logistiques au chapitre de la mise à niveau de l’équipement de contrôle des émissions, des facteurs à considérer sur le plan des achats et de l’approvisionnement, et qu’il faudrait mettre les réservoirs hors service séquentiellement afin d’effectuer les mises à niveau sans nuire aux opérations. Ils demandent donc des délais considérablement plus longs, de même qu’un programme de mise en œuvre par étapes.
Les représentants de l’industrie ont également demandé des indemnités pour la réduction ou la modification des inspections l’hiver ou par mauvais temps, ainsi qu’un seuil de taille plus élevé pour les petits réservoirs; ils demandent plus particulièrement que les exigences s’appliquent aux réservoirs de plus de cinq mètres de diamètre, plutôt que quatre, comme il était proposé à l’origine. Ils ont également soulevé des préoccupations concernant la possibilité de chevauchement des exigences ou de confusion avec les autres exigences réglementées, dont la réglementation et les initiatives provinciales visant à réduire les émissions de méthane provenant du secteur pétrolier et gazier d’amont.
En réponse à ces préoccupations, le Ministère a prévu, dans le cadre du projet de règlement, une approche de mise en œuvre prolongée et par étapes. Cette approche permettra d’accorder la priorité aux sources d’émissions qui posent le plus grand risque, en plus d’offrir une période de mise en œuvre prolongée (sept ans pour les réservoirs et cinq ans pour les rampes de chargement, par rapport à l’échéancier de mise en œuvre initial, qui s’échelonnait sur deux ans) dans les cas où une installation réglementée compterait un grand nombre de réservoirs de stockage ou de rampes de chargement à réparer ou à mettre à niveau. Le Ministère a ajouté certaines dispositions visant à allouer plus de temps aux réparations qu’il serait difficile ou dangereux d’effectuer rapidement. On a également procédé à des ajustements pour élever le seuil de taille de l’équipement auquel les exigences s’appliquent, y compris la limite de taille des petits réservoirs, en vue d’alléger le fardeau imposé aux installations de petite taille. Par ailleurs, un certain nombre de dispositions d’ordre technique sont prévues, notamment sur les procédures d’inspection, afin d’éviter tout fardeau inutile et toute confusion avec les pratiques opérationnelles.
En réponse aux préoccupations concernant la possibilité de chevauchement ou de confusion avec les autres exigences réglementées en vigueur, le Ministère a modifié le champ d’application aux installations et à l’équipement, de même que les exigences en matière d’équipement et d’inspection, afin d’éviter toute confusion et de réduire les chevauchements dans la mesure du possible.
Gouvernements provinciaux et territoriaux
La plupart des représentants des gouvernements participants ont appuyé le projet de règlement.
Le Ministère a informé l’ensemble des provinces et des territoires du projet de règlement; certains d’entre eux, à savoir la Colombie-Britannique, la Saskatchewan, l’Ontario, le Québec, le Nouveau-Brunswick et les Territoires du Nord-Ouest, ont présenté des commentaires écrits ou participé aux discussions avec le Ministère. Dans l’ensemble, les représentants participants ont exprimé un appui à l’égard du projet de règlement. Certains ont dit souhaiter prendre part au processus d’élaboration du Règlement et à d’autres discussions sur son application, la mise en commun des données et l’interaction avec les exigences déjà en vigueur au sein de leurs administrations respectives.
Le Ministère a davantage mobilisé ses partenaires provinciaux et territoriaux en vue de discuter de l’application du projet de règlement aux activités et aux sources d’émissions particulièrement préoccupantes ou, du moins, assurer l’efficacité du projet de règlement et réduire au minimum le recoupement des exigences existantes.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Obligations relatives aux traités modernes
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une évaluation des répercussions des traités modernes a été réalisée dans le cadre de la proposition réglementaire. L’évaluation consistait notamment en l’examen de la zone géographique et de l’objet de l’initiative par rapport aux traités modernes en vigueur. La zone géographique du projet de règlement comprend tous les lieux au Canada dans lesquels se trouvent des installations réglementées, y compris des régions dans l’ensemble des provinces et des territoires, sauf le Nunavut.
On a répertorié de possibles répercussions des traités modernes en ce qui concerne quatre installations de distribution de carburant situées dans le nord du Québec et visées par la Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ), en particulier par rapport à une obligation de consulter prévue dans le régime de protection de l’environnement et du milieu social de la CBJNQ.
Afin de tenir compte de toutes les possibles répercussions des traités modernes, on fera appel aux organismes chargés du régime de protection de l’environnement et du milieu social de la CBJNQ en fonction des modalités de celui-ci. Ces organismes procéderont notamment à l’examen du projet de règlement, en particulier les dispositions qui tiennent compte des circonstances uniques des installations de distribution de carburant au nord pour garantir que le projet de règlement est adéquat et approprié, et répond au besoin des collectivités autochtones touchées. Les dispositions qui tiennent compte des circonstances uniques des installations de distribution de carburant au nord, comme celles visées par la CBJNQ (surtout le remplissage sporadique des réservoirs et les carburants de remplacement limités si un équipement est mis hors service aux fins d’entretien), pourraient faire en sorte que toutes les installations visées par la CBJNQ soient exclues de la portée du projet de règlement.
Dans l’ensemble, on s’attend à ce que le projet de règlement ait une incidence positive en ce qui a trait aux droits des signataires de traités modernes, si incidence il y a, puisqu’il devrait permettre d’améliorer la santé de la population et la qualité de l’air près des installations réglementées et que toutes les exigences imposées concerneraient les sites industriels réglementés. Le Ministère estime que les quatre installations indiquées au titre de la CBJNQ sont en deçà des limites de stockage et de chargement, et elles seraient exemptées des exigences de cette proposition.
Consultation et mobilisation des Autochtones
Le Ministère a mobilisé un certain nombre de groupes autochtones dans le cadre de l’élaboration du projet de règlement. Parmi les principaux groupes ayant présenté des commentaires écrits ou pris part à des discussions bilatérales, on compte l’Inuit Tapiriit Kanatami, la Nation des Tsleil-Waututh et la Première Nation Aamjiwnaang. Les représentants autochtones ont appuyé l’objectif environnemental de l’approche provisoire, mais se sont dits préoccupés de la qualité de l’air locale, de l’application du règlement et de la tenue de dossiers, ainsi que de possibles répercussions sur l’approvisionnement en carburant dans les régions du Nord.
Les représentants des collectivités touchées par des niveaux ambiants élevés de benzène et d’autres COV ont réclamé que des mesures soient prises pour veiller à ce que le projet de règlement atténue efficacement ces problèmes. Ils demandaient plus particulièrement que l’on utilise la meilleure technologie de contrôle et de surveillance disponible pour l’équipement présentant un potentiel élevé d’émissions de benzène, qu’on prenne en compte la totalité des sources (dont le traitement des eaux usées et les égouts), qu’on mette les exigences en œuvre rapidement, et qu’on rende des comptes et tienne les dossiers de façon transparente et accessible au public. Ils disaient également souhaiter participer davantage à l’élaboration de la réglementation et au processus d’application. La Première Nation Aamjiwnaang a fait valoir que la qualité de l’air et les niveaux ambiants de benzène près de leur collectivité sont toujours les pires parmi les zones industrialisées d’Amérique du Nord, et qu’il existe des solutions réalisables et efficaces pour contrôler la pollution de l’air, qui n’ont toutefois pas été mises en œuvre.
Les représentants des régions du Nord ont fait remarquer la nécessité de prendre en compte certains facteurs pour veiller à ce que le projet de règlement ne nuise pas à l’approvisionnement en carburant dans les collectivités du Nord, compte tenu des chaînes d’approvisionnement fragiles et des conditions météorologiques extrêmes.
En réponse aux préoccupations concernant l’exposition au benzène et aux COV, le Ministère a révisé le calendrier de mise en œuvre pour veiller à ce que les exigences qui visent les sources qui présentent un potentiel élevé d’émissions de benzène entrent en vigueur le plus rapidement possible, en plus d’abaisser les niveaux de benzène permis dans le système de contrôle du dégagement des vapeurs. Le Ministère continuera également à analyser les informations disponibles, y compris les données de surveillance, afin de déterminer si des contrôles sur d’autres sources d’émissions, telles que le traitement des eaux usées et les égouts, non visées par le projet de règlement, sont justifiés. En réponse aux préoccupations liées à la reddition de compte et à la tenue de dossiers, le Ministère a prévu des exigences supplémentaires à ce sujet concernant les inventaires d’équipement, les réparations et la progression de la mise en œuvre, et le Ministère évaluera les options permettant de rendre publiques les données déclarées tout en protégeant les renseignements commerciaux confidentiels.
En réponse aux préoccupations concernant l’approvisionnement en carburant dans les régions du Nord, le Ministère a prévu des dispositions visant à prévenir l’application du projet de règlement aux installations de petite taille et éloignées qui ne posent que peu de risques pour la santé, en plus d’indemnités visant à allouer plus de temps aux réparations qu’il serait difficile ou dangereux d’effectuer rapidement.
Choix de l’instrument
Le Ministère a examiné et évalué divers instruments réglementaires et non réglementaires afin de déterminer le meilleur instrument qui permettrait d’atteindre les objectifs du projet de règlement. L’évaluation comportait un éventail de critères, dont l’efficacité environnementale, l’efficience économique, l’effet distributif, l’applicabilité et la faisabilité de la mise en œuvre, l’acceptabilité des parties concernées et des partenaires, et la compatibilité entre les administrations. On trouve ci-dessous un résumé des conclusions.
Scénario de base
Comme indiqué plus haut dans la section « Mesures de gestion des risques existantes au Canada », certaines installations réglementées ont installé des systèmes de contrôle des vapeurs dans les rampes de chargement et d’autres dans les réservoirs de stockage. Bon nombre de ces systèmes de contrôle des vapeurs ont été mis au point d’après deux instruments volontaires du CCME publiés en 1991 et en 1995. Ces instruments volontaires portent sur les effets des COV sur l’ozone troposphérique, sans tenir particulièrement compte des effets sur la santé humaine des COV cancérogènes comme le benzène.
Selon les directives du CCME, les réservoirs de stockage nécessitent, au minimum, une inspection des réservoirs à toit flottant interne tous les 10 ans ou d’autres essais annuels de limite inférieure d’explosivité. Lorsque seules ces exigences minimales sont respectées, les fuites majeures risquent d’empirer au fil du temps avant qu’elles ne soient détectées et réparées. Il est essentiel de détecter et de réparer les petites et les grandes fuites rapidement, car même une courte exposition à de faibles concentrations d’émissions cancérogènes peut être nocive pour la santé humaine. Récemment, les résultats de la surveillance des rejets atmosphériques ont indiqué des niveaux élevés de benzène dans l’air ambiant près de grands réservoirs de stockage, malgré qu’ils étaient dotés de systèmes de contrôle des vapeurs décrits dans les directives du CCME. Cela laisse supposer de possibles lacunes dans les spécifications de l’équipement ou dans les critères d’inspection et d’entretien des directives.
Le Code du CCME concernant les rampes de chargement porte sur le chargement d’essence dans les camions, mais pas sur le chargement d’essence pour le transport ferroviaire ou marin, ni sur d’autres liquides pétroliers volatils, y compris ceux qui peuvent contenir des substances cancérogènes. Le Ministère estime que plus de la moitié des rampes de chargement moyennes et grandes sont non contrôlées.
Compte tenu de ces systèmes restreints, maintenir le statu quo n’est pas l’option à privilégier, car elle ne pallie pas les risques que présentent les COV pour la population canadienne à proximité des installations qui sont des sources d’émissions.
Code de pratique
Un code de pratique fournirait les spécifications techniques dans un document uniformisé dans lequel on répertorierait et promouvrait les meilleures pratiques visant à réduire les émissions provenant des réservoirs de stockage et des rampes de chargement. Un code de pratique n’a pas été envisagé en tant qu’instrument potentiel de réduction des rejets de COV, puisqu’il serait volontaire au lieu d’exécutoire. On ne s’attend pas à ce que toutes les installations adoptent un code de pratique, s’il y en avait un, étant donné qu’il a été démontré que certaines installations ne suivent pas le Code et les directives du CCME existants (bon nombre n’utilisent pas de systèmes de contrôle des vapeurs pour les rampes de chargement). Par conséquent, on est venu à la conclusion qu’un code de pratique n’entraînerait pas de réduction des rejets de COV nécessaires à la protection adéquate de la santé humaine.
Avis de planification de la prévention de la pollution
Un avis de planification de la prévention de la pollution consiste en un instrument flexible qui peut servir à la gestion des risques pour l’environnement et la santé humaine, ce qui pourrait réduire la nécessité d’une intervention réglementaire supplémentaire. Les personnes visées par un avis de planification de la prévention de la pollution (P2) doivent préparer et mettre en œuvre un plan P2 qui répond aux exigences de l’avis, mettre leur plan à la disposition de tous sur le site et mener à bien les mesures figurant dans leur plan. La mise en œuvre des plans P2 est exécutoire; toutefois, leur contenu peut grandement varier puisque chaque installation met au point son propre plan P2. Ainsi, un avis de planification P2 ne favoriserait pas la cohérence à l’échelle nationale. De plus, il ne permettrait pas de mettre en œuvre les mesures nécessaires en vue de la réduction de l’exposition aux composants carcinogènes présents dans les liquides pétroliers volatils dans toute la mesure du possible, comme de fréquentes inspections (par exemple inspections mensuelles des réservoirs à toit flottant interne) et l’installation de systèmes de contrôle des vapeurs à rendement élevé. Par conséquent, le Ministère a conclu qu’un avis de planification P2 n’était pas le meilleur instrument pour atteindre les objectifs du projet de règlement.
Instruments axés sur le marché
Le Ministère a envisagé des instruments axés sur le marché comme les programmes de plafonnement et d’échange, ainsi que les frais et les droits.
Un système de plafonnement et d’échange permettrait l’établissement d’un seuil des émissions de COV pour le secteur et les installations pourraient accumuler et échanger des crédits. Des évaluations récentes sur le benzène indiquent qu’il faudrait grandement prioriser les options de réduction de l’exposition des personnes à proximité des sources industrielles. Un système de plafonnement et d’échange ne permettrait pas de prescrire les endroits où les réductions des émissions devraient avoir lieu; ces endroits seraient déterminés par les marchés. Il ne serait donc pas possible d’atteindre l’objectif de protéger la population canadienne à proximité des installations réglementées par l’entremise du système de plafonnement et d’échange.
Autrement, on pourrait imposer des frais et des droits aux installations dont les émissions de COV dépassent le seuil établi. Cette approche se traduirait par une grande charge de travail administratif de la part des parties réglementées et de travail administratif et de surveillance des parties par l’organisme de régulation ainsi que par énormément de temps consacré à la détermination des frais et des droits qui entraîneraient des réductions d’émissions dans les secteurs locaux et régionaux les plus touchés.
En outre, il serait coûteux et long de réviser la structure des frais au fur et à mesure que la technologie évolue et cela ne permettrait pas de tirer parti des règlements axés sur les équipements qui existent dans certaines compétences canadiennes. Dans cette approche, la force exécutoire par rapport à la remédiation des problèmes de la qualité de l’air local ferait défaut.
Aucun de ces deux instruments, soit le système de plafonnement et d’échange ou les frais et les droits, n’a été envisagé en tant qu’instrument acceptable pour les raisons énoncées ci-dessus. Ces approches laisseraient aussi entendre qu’il existe des niveaux acceptables de rejet de substances cancérogènes (pour l’échange ou des niveaux qui, si dépassés, s’accompagneraient de frais et de droits), ce qui n’est pas le cas.
Modifications du règlement existant
Il existe un règlement fédéral, c’est-à-dire le Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés, qui porte sur la réduction des fuites et des déversements liquides des systèmes de stockage. Datant de 2008 et modifié pour la dernière fois en 2020, le Règlement s’applique uniquement aux réservoirs situés sur les terres autochtones ou sur le territoire domanial ou à ceux en exploitation par des organismes précis qui relèvent de la compétence fédérale. Il y a peu de recoupement entre le règlement de 2008 et le projet de règlement par rapport aux parties réglementées ou aux exigences, outre la tenue de dossiers de base et l’inscription des installations. Par conséquent, on a rejeté l’option visant à modifier considérablement le règlement de 2008, plutôt que la création d’un nouveau règlement.
Nouveau règlement
Imposer des exigences réglementaires nationales a été jugé comme le moyen le plus pratique et le plus efficace de diminuer les rejets de COV et ainsi réduire l’exposition de la population aux composants cancérogènes et protéger la santé de celle-ci. Un nouveau règlement fournirait des exigences précises qui assureraient la résolution des problèmes de la qualité de l’air au niveau local et la force exécutoire, et offriraient une certitude et une harmonisation générale avec les règlements déjà en place dans d’autres compétences. Étant de nature obligatoire et uniforme, les mesures réglementaires fourniraient des systèmes de contrôle des émissions de COV cohérents pour l’ensemble des installations réglementées des secteurs pétroliers et pétrochimiques du Canada, ce qui permettrait l’atteinte des objectifs du projet de règlement.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Cadre analytique
Les avantages et les coûts associés au projet de règlement ont été évalués conformément au Guide d’analyse coûts-avantages pour le Canada : Propositions de réglementation du Secrétariat du Conseil du Trésor, ce qui comprend la détermination et la quantification des effets de la politique et, dans la mesure du possible, l’établissement de la valeur pécuniaire de ces effets. Une analyse coûts-avantages a été effectuée pour évaluer les effets différentiels du projet de règlement en comparant deux scénarios. Dans le scénario de référence, il est présumé que les installations réglementées continueraient de satisfaire aux exigences réglementaires actuelles ou d’appliquer les pratiques volontaires de contrôle des émissions fugitives de COV. En ce qui concerne le scénario réglementaire, il est présumé que les installations réglementées prendraient les mesures exigées par le projet de règlement. Les différences entre les effets du scénario réglementaire et ceux du scénario de référence constituent les effets différentiels (les coûts et les avantages) du projet de règlement. Les coûts différentiels ont été quantifiés et leur valeur pécuniaire a été déterminée. Les avantages différentiels ont été quantifiés et leur valeur pécuniaire a été déterminée lorsque c’était possible; sinon, ils ont été décrits de manière qualitative.
Le projet de règlement devrait entrer en vigueur en 2024 et donner aux installations réglementées jusqu’à sept ans pour s’y conformer (par exemple les plus grandes installations, qui ont davantage de réservoirs de stockage, pourraient avoir besoin de plus de temps pour rendre l’ensemble de leurs réservoirs conformes). La période d’analyse est de 22 ans. Elle commencera en 2024 (l’année où le projet de règlement devrait entrer en vigueur) et se terminera en 2045. Cette période a été sélectionnée afin de couvrir de multiples cycles de certains coûts qui sont engagés tous les 10 ans et de s’aligner de façon générale sur la durée de vie utile attendue de l’équipement de contrôle des émissions. À moins d’indication contraire, toutes les valeurs sont présentées en dollars canadiens de 2022, actualisés à un taux de 2 % pour l’année 2024.
Le modèle logique (figure 1) explique le lien entre le problème, le projet de règlement et les effets différentiels (avantages et coûts). Le problème à l’étude est la grande quantité de COV fugitifs qui est émise par les réservoirs de stockage et les activités de chargement dans le secteur pétrolier et qui contribue à la pollution atmosphérique. Pour s’attaquer à ce problème, le projet de règlement établit des mesures de contrôle des émissions pour les activités de chargement et les réservoirs de stockage nouveaux et existants dans le secteur pétrolier. Le respect du projet de règlement générerait des avantages pour l’environnement et la santé grâce à l’amélioration de la qualité de l’air (en raison de la réduction des émissions de COV) et à la réduction des répercussions des changements climatiques (en raison de la réduction des émissions de méthane). Le projet de règlement permettrait également la récupération de produits (essence et pétrole brut) en raison de la réduction des gaz d’évaporation émis par les installations réglementées. La vente de ces produits récupérés procurerait des avantages supplémentaires en matière de production. Par ailleurs, la réduction de l’exposition aux substances cancérigènes (comme le benzène) pourrait avoir des avantages pour la santé; toutefois, ces avantages n’ont pas pu être quantifiés en raison de limites techniques et liées aux données.
Pour résoudre ce problème, l’industrie devrait assumer des coûts de conformité en vue de remplir les exigences réglementaires et des coûts administratifs en vue de prouver qu’elle se conforme à ces exigences. Le gouvernement devrait également payer des coûts administratifs pour appliquer le projet de règlement. Une ventilation de ces coûts est présentée dans le modèle logique suivant.
Figure 1 : Modèle logique du projet de règlement
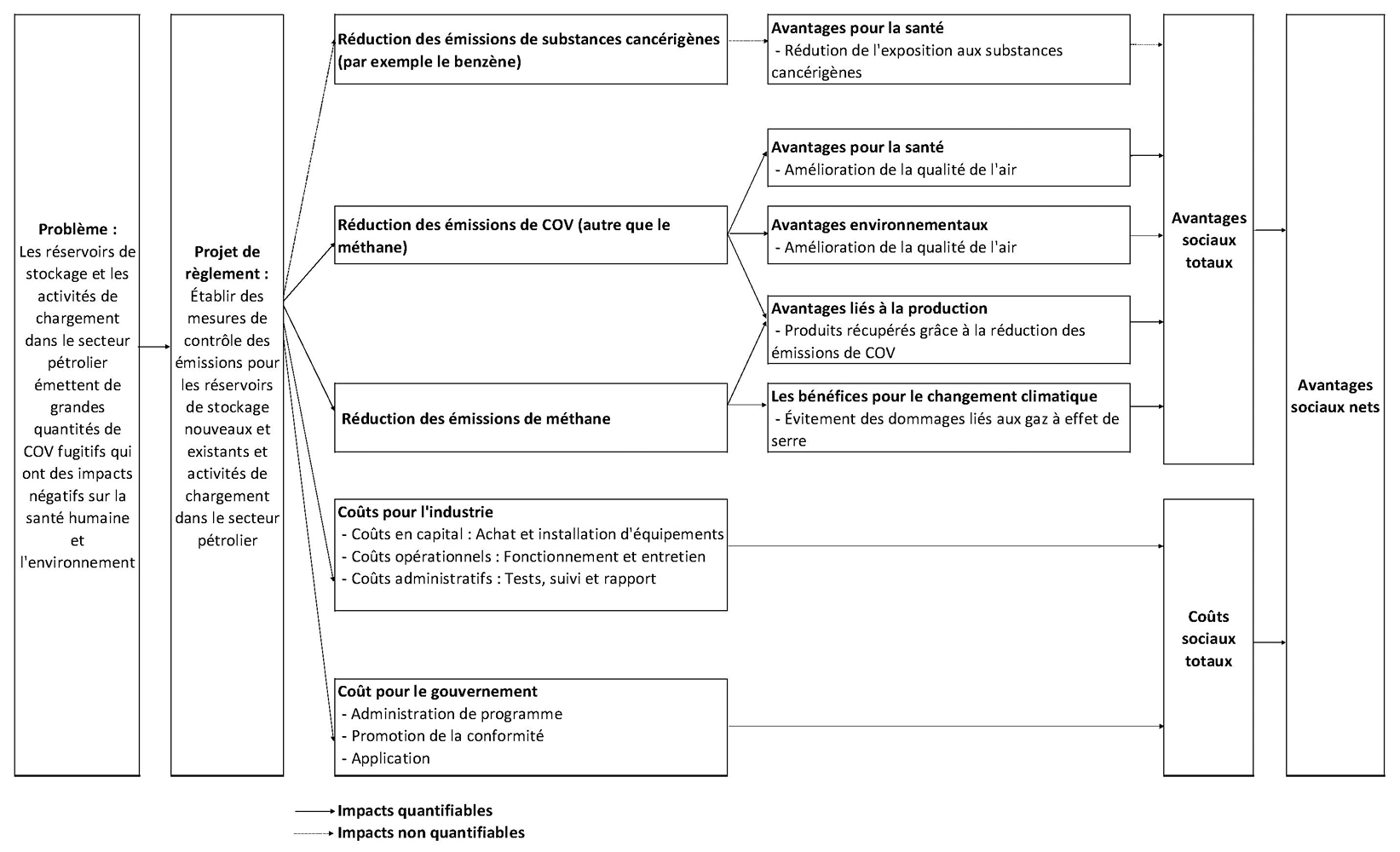
Figure 1 : Modèle logique du projet de règlement - Version textuelle
Le modèle logique souligne le problème des réservoirs de stockage et des opérations de chargement dans le secteur pétrolier, qui sont responsables de l'émission de grandes quantités de composés organiques volatils (COV). Ces émissions ont des impacts néfastes sur la santé humaine et l'environnement. Ainsi, le règlement proposé établirait des mesures de contrôle des émissions pour les réservoirs de stockage nouveaux et existants et les opérations de chargement dans le secteur pétrolier. Ce règlement réduirait les émissions de certaines substances cancérigènes, comme le benzène, ce qui entraînerait des bienfaits pour la santé caractérisés par une exposition réduite à ces cancérigènes. La réduction des émissions de COV autres que le méthane améliorerait la qualité de l’air, entraînant ainsi des avantages à la fois pour la santé et pour l’environnement. La réduction des émissions de méthane produirait des avantages en matière de production grâce aux installations récupérant les produits et se traduirait par des avantages en matière de changement climatique grâce aux dommages évités liés aux gaz à effet de serre. L'industrie assumerait des coûts en capital initiaux pour l'achat de l'équipement et ses coûts d'installation, des coûts pour le fonctionnement et l'entretien, ainsi que des coûts administratifs (c'est-à-dire les tests, le suivi et la production de rapports). Le gouvernement assumerait des coûts d'administration du programme, de promotion de la conformité et d'application. Enfin, le modèle indique que certains impacts quantifiables résultent du règlement proposé, tandis que d'autres restent non quantifiables.
Données et hypothèses
La modélisation des avantages, des coûts et des émissions repose sur des recherches approfondies et de vastes consultations auprès de parties concernées. Les données sont tirées d’un éventail de publications du gouvernement canadien et de gouvernements étrangers, de bases de données, d’articles universitaires et de documents produits par l’industrie. Plus précisément, de multiples fournisseurs et entrepreneurs ont été contactés afin de confirmer les exemples de coûts à débourser pour la modernisation des réservoirs et les systèmes de contrôle des vapeurs. Des représentants de l’industrie ont également été consultés au sujet des principales hypothèses et données, et leurs commentaires ont été intégrés à l’analyse afin d’améliorer les estimations concernant les inventaires d’équipement ainsi que les coûts d’inspection, de réparation et d’administration.
Voici les principales sources d’information : Statistique Canada; l’Inventaire national des rejets de polluants; le Programme du Réseau national de surveillance de la pollution atmosphérique; le document AP-42, Fifth Edition, Volume 1, Compilation of Air Pollutant Emissions Factors from Stationary Sources (disponible en anglais seulement); l’Association canadienne des carburants; l’Association canadienne des producteurs pétroliers; la plateforme Oil Sands Magazine (disponible en anglais seulement); le rapport de Kent Group Ltd. intitulé 2016 Report – Canada’s Downstream Logistical Infrastructure: Refining, Biofuel Plants, Pipelines, Terminals, Bulk Plants & Cardlocks (PDF, disponible en anglais seulement) [le rapport de 2016 – L’infrastructure logistique en aval du Canada : Raffinage, usines de biocarburants, pipelines, terminaux, dépôts routiers et installations Cardlock]; les renseignements recueillis par le Ministère en vertu de la LCPE; et l’initiative Clean Air Sarnia and Area (disponible en anglais seulement).
Modèles d’estimation
Un modèle d’analyse coûts-avantages (ACA) a été élaboré afin de quantifier les avantages et les coûts, établir leur valeur pécuniaire et estimer les émissions fugitives de COV (décrites plus en détail ci-dessous) dans les scénarios réglementaire et de référence. Une fois les estimations des émissions fugitives de COV faites, le modèle énergie-émissions-économie du Canada (E3MC) et le modèle Global Environnemental Multi-échelle - Modélisation de la qualité de l’Air et de la CHimie (GEM-MACH) du Ministère ont été utilisés pour déterminer les changements dans les concentrations dans l’air ambiant entre les deux scénarios. Le modèle de l’Outil d’évaluation des bénéfices liés à la qualité de l’air (OEBQA) du ministère de la Santé a ensuite été utilisé pour estimer les effets de ces changements sur la santé. De même, le Modèle d’évaluation de la qualité de l’air 2 (MEQA2) du Ministère a été utilisé pour estimer les avantages pour l’environnement. Ces modèles font l’objet d’un examen par des pairs.
Le modèle d’ACA, élaboré par le Ministère, a été utilisé pour estimer les émissions de COV en estimant d’abord le nombre de réservoirs et de rampes de chargement. Puis, les coefficients d’émission associés aux réservoirs ont été estimés pour les scénarios réglementaire et de référence. Ensuite, les émissions fugitives de COV dans les scénarios réglementaire et de base ont été calculées en multipliant le nombre de réservoirs et de rampes de chargement par leurs coefficients d’émission. Enfin, les émissions différentielles de COV (réductions des émissions) ont été calculées d’après les différences entre les émissions de COV dans le scénario de référence et le scénario réglementaire.
Le modèle nommé E3MC, élaboré par le Ministère, a été utilisé pour préparer les données de référence sur la qualité de l’air qui alimentent le modèle GEM-MACH. Il s’agit d’un modèle pour l’ensemble de l’économie qui prend en compte les interactions entre l’environnement et l’économie. Il comporte deux composantes : Énergie 2020 et le modèle Informetrica. Énergie 2020 est un modèle intégré nord-américain multirégional et multisectoriel qui simule l’offre, le prix et la demande pour tous les combustibles. Le modèle Informetrica est un modèle macroéconomique de l’économie canadienne utilisé pour examiner les décisions relatives à la consommation, aux investissements, à la production et au commerce. Les données de référence sur la qualité de l’air proviennent du modèle Énergie 2020. Ces données de référence contiennent diverses estimations relatives aux polluants atmosphériques, comme les COV, les particules, le dioxyde de soufre, les oxydes d’azote, etc.
Le modèle GEM-MACH, également élaboré par le Ministère, est un système de modélisation de la qualité de l’air qui génère des données sur les changements dans les concentrations de polluants atmosphériques en se fondant sur les réductions des émissions de COV estimées par le modèle d’ACA. Il remplace l’ancien Système régional unifié de modélisation de la qualité de l’air et fournit une représentation détaillée de la chimie atmosphérique et des processus météorologiques ainsi qu'une résolution plus précise. Le domaine de prévision du modèle couvre la majeure partie du Canada, la zone continentale des États-Unis et le nord du Mexique. La version 3.0 du modèle GEM-MACH, qui est en vigueur depuis 2019, a été utilisée dans le cadre de cette analyse. Le modèle a généré des données qui démontrent les effets différentiels (c’est-à-dire les différences entre le scénario de référence et le scénario réglementaire) pour l’ozone, les particules de moins de 10 micromètres, le monoxyde de carbone et la portée visuelle. Il n’y avait cependant aucun effet apparent sur les particules fines (PM2,5), le dioxyde de soufre et le dioxyde d’azote. ,
L’OEBQA, un modèle élaboré par le ministère de la Santé, a été utilisé afin d’estimer les avantages pour la santé humaine (c’est-à-dire les incidences de l’évitement des effets néfastes sur la santé et la valeur en dollars de la réduction des dommages en matière de santé) découlant des changements modélisés dans les concentrations de polluants atmosphériques générés par le modèle GEM-MACH. Le modèle tient compte des changements dans les concentrations de polluants atmosphériques ainsi que des données sur les populations canadiennes, des taux sur l’occurrence des problèmes de santé et des fonctions concentration-réponse pour estimer le nombre de cas de morbidité et de décès prématuré. Par ailleurs, l’OEBQA estime la valeur économique de ces effets sur la santé en tenant compte des éventuelles conséquences sociales, économiques et pour le bien-être public des résultats en matière de santé, dont les coûts médicaux, la réduction de la productivité en milieu de travail, la douleur et la souffrance ainsi que les effets d’une hausse du risque de mortalité.
Le MEQA2 a été utilisé afin d’estimer les avantages pour l’environnement en se fondant sur les changements modélisés dans les concentrations de polluants atmosphériques générés par le modèle GEM-MACH. Il s’agit d’un outil informatique de simulation conçu pour évaluer les coûts ou les avantages environnementaux associés à un changement dans la qualité de l’air. Dans le cadre de cette analyse, la qualité de l’air de référence pour une année modélisée a été comparée à la qualité de l’air qui sera obtenue grâce au projet de règlement en vue d’estimer les effets différentiels sur l’environnement (les avantages pour l’environnement). Les effets différentiels ont ensuite été évalués du point de vue pécuniaire. Il existe trois types de répercussions sur l’environnement dans le cadre du MEQA2 : les changements à la productivité des cultures en raison du taux d’ozone pendant l’été; les changements à la visibilité causés par les particules; et la salissure des surfaces des immeubles en raison des particules grossières. L’évaluation de ces trois types de répercussions permet d’obtenir les avantages pour l’environnement du projet de règlement.
Scénario de référence
Dans le scénario de référence, les installations réglementées continueraient de satisfaire aux exigences réglementaires actuelles ou d’appliquer les pratiques volontaires de contrôle des émissions de COV. Cela comprend les instruments volontaires du CCME ainsi que les mesures provinciales ou municipales obligatoiresréférence 24. Les installations réglementées qui sont actuellement assujetties aux exigences réglementaires déjà en vigueur figurent dans le tableau 6.
| Province / territoire | Champ d’application | Villes | Nombre d’installations | Détails du champ d’application |
|---|---|---|---|---|
| T.N.L. | À l’échelle de la province | Toutes | 14 | Contrôle des vapeurs et conception, inspection et entretien des réservoirs de stockage |
| Qc | À l’échelle de la province | Toutes | 27 | Conception des réservoirs de stockage |
| Qc | Municipalité de Montréal | Montréal | 7 | Contrôle des vapeurs et conception, inspection et entretien des réservoirs de stockage |
| Qc | Municipalité de Montréal | Montréal-Est | 2 | Contrôle des vapeurs et conception, inspection et entretien des réservoirs de stockage |
| Ont. | À l’échelle de la province | Toutes | 61 | Contrôle des vapeurs et conception, inspection et entretien des réservoirs de stockage |
| C.B. | Municipalité de Metro Vancouver | Vancouver | 1 | Contrôle des vapeurs émises pendant le chargement d’essence |
| C.B. | Municipalité de Metro Vancouver | North Vancouver | 1 | Contrôle des vapeurs émises pendant le chargement d’essence |
| C.B. | Municipalité de Metro Vancouver | Burnaby | 6 | Contrôle des vapeurs émises pendant le chargement d’essence |
| Autre | s.o. | s.o. | 124 | Aucune pratique provinciale ni municipale |
| Canada | s.o. | s.o. | 243 | Pratiques du CCME |
Scénario réglementaire
Dans le scénario réglementaire, toutes les installations réglementées seraient tenues de mettre en œuvre les exigences relatives à l’équipement de contrôle des émissions, à l’inspection et à la tenue de documents, comme le précise la section « Description ». Les réservoirs et l’équipement de chargement déjà en service avant la date de publication finale seront soumis à une période de mise en œuvre progressive qui s’échelonnera sur un à sept ans. Les réservoirs et l’équipement de chargement qui entreront en service après la date de la publication finale seront immédiatement assujettis à toutes les exigences.
Avantages supplémentaires
L’objectif premier du projet de règlement est d’améliorer la santé humaine. En plus de cela, le projet de règlement générerait des avantages connexes dans les domaines de l’environnement, de la lutte aux changements climatiques et de la récupération de produits.
Le projet de règlement réduirait les émissions de COV d’environ 494 kt au cours de la période d’analyse. Cette réduction se produirait au fil de la période d’analyse, comme l’illustre la figure 2. La réduction des émissions de COV devrait améliorer la qualité de l’air et, par le fait même, entraîner des avantages pour la santé et l’environnement. Un autre avantage connexe du projet de règlement serait une réduction des émissions de méthane d’environ 8 kt au cours de la période d’analyse. La réduction des émissions de méthane devrait se traduire par une réduction de GES et ainsi réduire les dommages causés par les changements climatiques.
Figure 2 : Émissions de COV (à l’exclusion du méthane) dans le scénario de référence et le scénario réglementaire
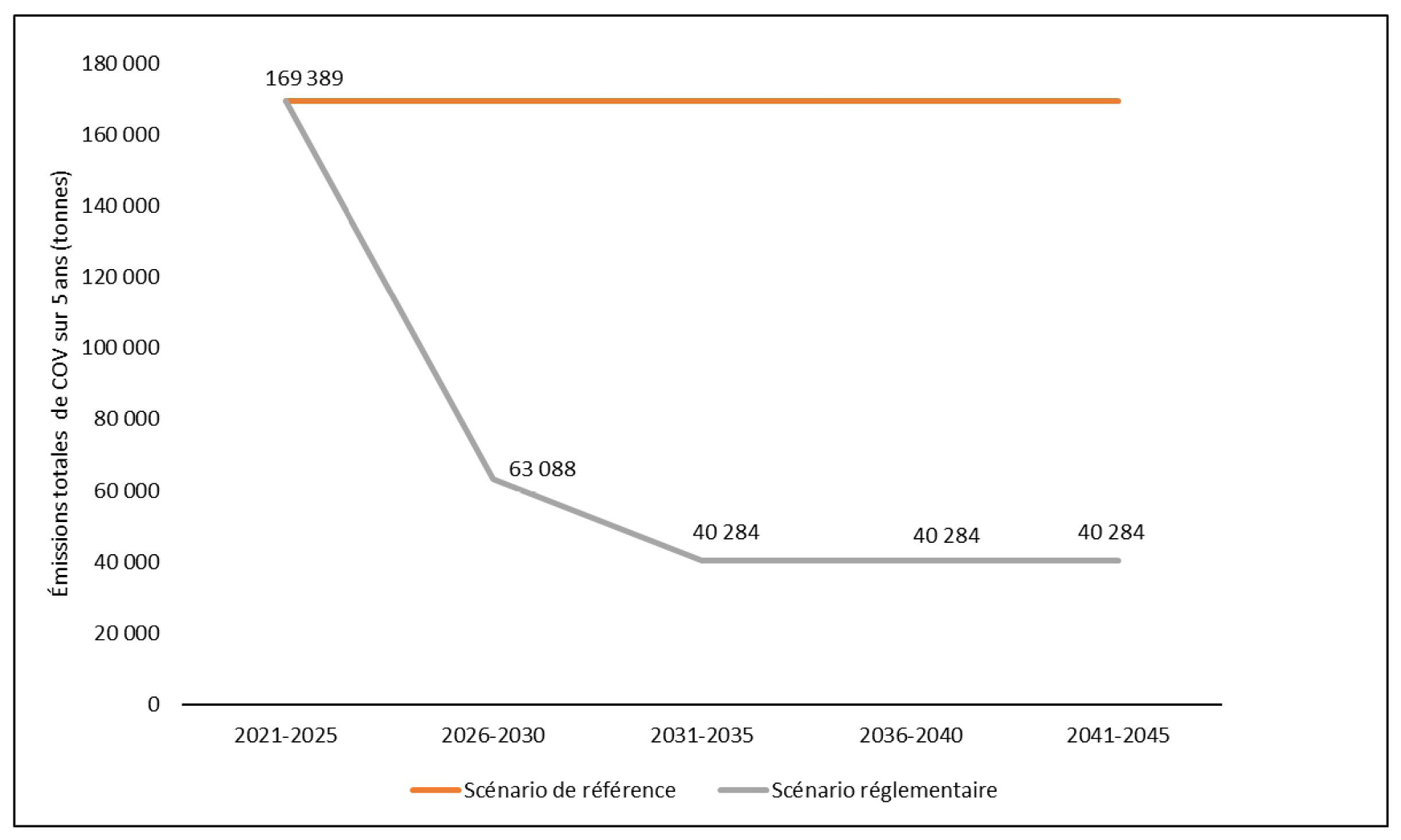
Figure 2 : Émissions de COV (à l’exclusion du méthane) dans le scénario de référence et le scénario réglementaire - Version textuelle
La figure 2 présente les émissions de COV, à l’exclusion des émissions de méthane, dans les scénarios de référence et réglementaire. Bien que les rejets de COV contiennent des émissions de méthane, celles-ci doivent être exclues de la quantification des COV, car le méthane est un gaz à effet de serre,. À la suite des consultations avec l'industrie, les émissions de COV sont supposées constantes à 33 878 tonnes par annuée sur la période d'analyse (2024-2045) dans le scénario de référence. À la suite de la mise en œuvre du règlement proposé, les émissions de COV diminuent à 15 658 tonnes en 2026 et à 8 057 tonnes en 2031, puis restent constantes par la suite en raison d'une conformité totale attendue.
Globalement, le projet de règlement entraînerait des avantages totaux estimés à 1,43 milliard de dollars pour la population canadienne et l’industrie durant la période d’analyse, soit 87,5 millions de dollars en dollars annualisés. Des avantages précis, notamment en matière de santé, d’environnement, de lutte aux changements climatiques et de production, sont examinés ci-dessous.
Avantages pour la santé
On s’attend à une amélioration de la qualité de l’air découlant de la réduction de COV dans les concentrations ambiantes de matières particulaires (PM2,5) et d’ozone troposphérique, et de la réduction de rejet de COV cancérigènes, y compris le benzène. Par conséquent, les réductions d’émissions de COV estimées découlant du projet de règlement réduiraient les effets nuisibles sur la santé de la population vivant au Canada, ce qui se traduirait par des bienfaits sur la santé de la population.
Avantages pour la santé découlant de la réduction de rejets de COV
Des recherches approfondies menées au Canadaréférence 25 et ailleurs dans le monde démontrent que toute augmentation de l’exposition à la pollution atmosphérique augmente le risque d’effets nuisibles sur la santé des habitants : augmentation de symptômes respiratoires, développement de maladies, mort prématurée et autres. Le lien établi entre l’exposition à chacun des polluants (par exemple PM2,5 ou ozone troposphérique) et la variation du risque associée ont été quantifiés pour chaque effet sur la santé. L’Outil d’évaluation des bénéfices liés à la qualité de l’air (OEBQA) du ministère de la Santé tient compte de ces relations et des données sur les populations canadiennes pour estimer l’incidence de maladies, le nombre de décès prématurés et d’autres effets associés à une variation de la pollution atmosphérique. L’OEBQA attribue aussi une valeur financière à ces effets sur la santé en considérant les conséquences sociales, économiques et de bien-être public possibles, y compris les coûts médicaux, la réduction de la productivité au travail, la douleur, la souffrance et l’impact des variations sur le risque de mortalité.
La modélisation de la qualité de l’air est effectuée à partir de l’année 2031, moment où les réductions entreprises à compter de 2026 seront pleinement mises en œuvre. Le ministère de la Santé s’appuie sur les résultats de la modélisation de 2031 pour estimer les effets sur la santé associés à chaque année durant la période d’analyse. Plus précisément, le ministère de la Santé a extrapolé à partir des valeurs de 2031 les valeurs des autres années en tenant compte de la variation de la population, des niveaux de référence de maladies et de mortalité et des réductions estimées d’émissions de COV.
Les émissions de COV contribuent à la formation de PM2,5 secondaires et d’ozone troposphérique. On estime qu’au cours de la période d’analyse, l’amélioration de la qualité de l’air découlant du projet de règlement entraînera une diminution du nombre de morts prématurées de l’ordre de 150. De plus, on s’attend à ce que l’amélioration de la qualité de l’air réduise de 31 000 le nombre de jours de symptômes d’asthme chez les asthmatiques âgés de 5 à 19 ans et de 91 000 le nombre de jours d’activité restreinte chez les non-asthmatiques. La valeur totale actualisée des bienfaits sur la santé résultant de ces améliorations est estimée à 1,05 milliard de dollars (en dollars canadiens de 2022) pour l’ensemble de la période d’analyse.
Comme le montre le tableau 7, les avantages globaux pour la santé découlant du projet de règlement seraient les plus importants en Colombie-Britannique, au Québec, en Alberta et en Ontario. Les avantages provinciaux tiennent non seulement compte des réductions d’émissions, mais aussi des différentes conditions atmosphériques et de la réduction de l’exposition de la population à ces polluants. En chiffres absolus, les provinces qui affichent le plus d’effets bénéfiques sur la santé sont celles qui comptent le plus d’habitants et présentent les plus hauts taux d’exposition au sein de la population. De plus, la direction du vent ainsi que les conditions atmosphériques jouent un rôle crucial dans l’évolution et le déplacement des polluants atmosphériques et dans l’exposition humaine. Les réductions des émissions dans les installations situées en amont de zones fortement peuplées par rapport à la direction du vent peuvent avoir des retombées plus importantes que des réductions de même ampleur dans les installations en région éloignée ou situées en aval des grandes agglomérations. Par conséquent, il se peut que les avantages sur la santé ne soient pas directement proportionnels aux réductions d’émissions par province.
Environ 51 % des avantages pour la santé résultant de la réduction des rejets de COV sont attribuables à la diminution de la concentration ambiante de PM2,5, tandis que 48 % sont attribuables à la réduction de l’ozone troposphérique. Moins de 1 % sont attribuables à la réduction d’autres polluants étudiés dans le modèle du ministère de la Santé (OEBQA), y compris le dioxyde d’azote.
| Province | Réduction dans les décès prématurés (nombre) | Réduction dans les jours de symptômes d’asthme chez les asthmatiques de 5 à 19 ans | Réduction dans les jours d’activité restreinte chez les non-asthmatiques | Retombées économiques des bienfaits sur la santé liés à la réduction de PM2,5 (en millions de dollars de 2022 actualisés à 2 %) | Retombées économiques des bienfaits sur la santé liés à la réduction annuelle et estivale d’ozone troposphérique (en millions de dollars de 2022 actualisés à 2 %) | Valeur totale des avantages liés à la réduction de tous les polluants (en millions de dollars de 2022 actualisés à 2 %) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qc | 42 | 7 800 | 23 000 | 155,1 | 144,5 | 302,5 |
| Ont. | 24 | 5 200 | 12 000 | 66,7 | 100,5 | 167,4 |
| Alb. | 31 | 8 600 | 26 000 | 134,6 | 89,3 | 223,9 |
| C.-B. | 39 | 7 900 | 23 000 | 130,4 | 148,6 | 281,4 |
| Autre | 10 | 1 900 | 7 000 | 48,8 | 25 | 73,9 |
| Canada | 150 | 31 000 | 91 000 | 535,5 | 507,9 | 1 049,0 |
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.
Les valeurs qui figurent dans le tableau présentent les retombées économiques en fonction des possibles effets sur le bien-être de la population associés aux coûts de traitement, à la perte de la productivité, à la douleur, à la souffrance et à la variation du risque de mortalité. Pour voir une explication complète de ces valeurs, consulter la version 3.0 du Guide de l’utilisateur de l’OEBQAréférence 26.
Avantages sur la santé découlant de la réduction de rejets de COV provenant des dépôts routiers
En plus des avantages monétaires estimés à l’aide de l’OEBQA, on s’attend à ce que le projet de règlement réduise d’environ 8 kt les émissions totales de COV provenant des dépôts routiers. L’emplacement de ces installations n’étant pas connu, leurs réductions d’émissions n’ont pas été incluses dans la modélisation des répercussions associées à la qualité de l’air (impacts sur la santé et sur l’environnement). La réduction d’émissions de COV provenant des dépôts routiers devrait néanmoins améliorer encore davantage la qualité de l’air environnant.
Avantages sur la santé découlant de la réduction de substances cancérigènes
Le projet de règlement réduirait les émissions de substances toxiques comme le benzène, un agent cancérigène connu chez les humains. Le ministère de la Santé recommande de réduire le plus possible l’exposition à de tels agents cancérigènes. Bien que les avantages associés à ces réductions n’aient pas été quantifiés, ils devraient normalement contribuer à augmenter globalement les effets bénéfiques estimés plus hauts.
Avantages environnementaux
Les émissions de COV peuvent mener à la formation de matières particulaires et d’ozone qui nuisent à la végétation, aux sols, à l’eau, à la faune, aux matériaux et à la qualité globale des écosystèmes. L’exposition chronique à l’ozone peut nuire au rendement des récoltes, dégrader la végétation, réduire la croissance des arbres et causer des décès prématurés et des maladies au sein du bétail. La visibilité amoindrie associée aux particules en suspension et au smog peut nuire à la qualité de vie résidentielle, au tourisme et aux effets bénéfiques des activités de plein air. Le dépôt de matières particulaires est également associé aux souillures et aux dommages structurels, des effets susceptibles de faire augmenter la facture de nettoyage et d’entretien. On s’attend à ce que le projet de règlement réduise les coûts économiques associés aux industries agroalimentaire et forestière, ce qui se traduira par des avantages environnementaux.
En utilisant le MEQA2, le Ministère a évalué les retombées environnementales que l’amélioration de la qualité de l’air entraînera sur la souillure, la visibilité et la productivité des récoltes dans le contexte du projet de règlement, en comparant un scénario de référence et un scénario réglementaire. Les indicateurs économiques permettant d’évaluer ces effets sont respectivement les coûts évités pour les ménages, la modification du bien-être des ménages et la modification du revenu des ventes pour les producteurs agricoles. La modélisation de la qualité de l’air a été effectuée à partir de l’année 2031, moment où les réductions entreprises à compter de 2026 seront pleinement mises en œuvre. Le Ministère s’est appuyé sur les résultats de la modélisation de 2031 pour estimer les effets associés à chaque année durant la période d’analyse. Plus spécifiquement, le Ministère a extrapolé à partir des valeurs de 2031 l’impact environnemental des autres années en tenant compte de la variation de la population et des réductions estimées d’émissions de COV pour chaque année.
La valeur actuelle totale des avantages environnementaux découlant du projet de règlement est estimée à 14,2 millions de dollars pour la période d’analyse. Le tableau 8 présente les avantages environnementaux cumulatifs répartis selon l’impact et la province ou le territoire. C’est l’Alberta qui en tirera le plus d’avantages, ce qui est logique puisque c’est dans cette province que les émissions seront le plus réduites. Il s’agit là d’estimations conservatrices dans la mesure où le MEQA2 n’évalue que l’impact sur la souillure, la visibilité et la productivité agricole. Puisque les émissions de polluants peuvent voyager sur de grandes distances, les avantages environnementaux dans certaines provinces peuvent être attribuables à des réductions d’émissions dans les provinces adjacentes.
| Province/territoire | Souillure/Coûts évités pour les ménages | Visibilité/Modification du bien-être des ménages | Productivité des récoltes/Modification du revenu des ventes pour les producteurs agricoles | Total |
|---|---|---|---|---|
| T.-N.-L. | 0 | 0,02 | 0 | 0,02 |
| Î.-P.-É | 0 | 0,04 | 0 | 0,05 |
| N.-É. | 0,03 | 0,14 | 0 | 0,18 |
| N.-B. | 0 | 0,02 | 0 | 0,03 |
| Qc | 0,59 | 1,68 | 0,42 | 2,68 |
| Ont. | 0,24 | 0,13 | 1,64 | 2,01 |
| Man. | 0,15 | 0,32 | 0,18 | 0,65 |
| Sask. | 0,08 | 0,17 | 0,41 | 0,65 |
| Alb. | 1,47 | 3,05 | 0,50 | 5,03 |
| C.-B. | 0,94 | 1,93 | 0 | 2,88 |
| Yn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.N.-O. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canada | 3,52 | 7,49 | 3,18 | 14,19 |
Remarque : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués. Les estimations d’avantages inférieures à 10 000 $ sont indiquées comme « 0 ».
Au cours de la période d’analyse, les coûts de nettoyage évités par les ménages devraient s’élever à environ 3,5 millions de dollars. Il faut considérer que les estimations de ces avantages sont prudentes, car elles ne tiennent pas compte des coûts de nettoyage évités dans les secteurs commercial et industriel.
En fonction de la volonté de payer pour améliorer la visibilité et apporter des modifications à la qualité de l’air, le MEQA2 estime le changement monétaire en matière de bien-être correspondant à différents niveaux de deciviewsréférence 27. Les améliorations du bien-être qui découlent d’une meilleure visibilité dans le secteur résidentiel sont d’environ 7,5 millions de dollars au cours de la période d’analyse.
La réduction des émissions de COV diminue les concentrations ambiantes d’ozone troposphérique, ce qui pourrait accroître le rendement des cultures. Les avantages nationaux tirés d’une augmentation de la productivité des cultures (exprimés en valeur courante de chiffre d’affaires au cours de la période d’analyse) devraient s’élever à environ 3,2 millions de dollars et être principalement enregistrés en Ontario.
En outre, la réduction des émissions de COV pourrait avoir d’autres avantages environnementaux. Par exemple, la réduction combinée des concentrations d’ozone et de matière particulaire pourrait favoriser la santé des écosystèmes forestiers, tandis que les améliorations de visibilité pourraient renforcer l’appréciation des loisirs et accroître les revenus du tourisme. En outre, une réduction des niveaux d’ozone troposphérique et de matière particulaire pourrait réduire les risques de maladie ou de mort prématurée chez les populations d’espèces sauvages ou de bétail vulnérables, ce qui permettrait d’éviter des coûts de traitement ou de réduire les pertes économiques dans l’industrie agroalimentaire. Toutefois, en raison du manque de données ou de limites méthodologiques, ces avantages n’ont pas été quantifiés par le MEQA2.
Avantages pour la production
Les émissions par évaporation qui résultent des activités d’entreposage et de chargement entraînent le rejet d’hydrocarbures liquides (par exemple pétrole brut et essence) dans l’atmosphère sous forme de vapeurs de COV. Par conséquent, les installations subissent des pertes économiques de produits liquides d’hydrocarbures. L’installation, l’inspection et l’entretien de systèmes de contrôle des vapeurs sur les réservoirs de stockage (par exemple les plafonds flottants) et les rampes de chargement (par exemple les unités de contrôle des vapeurs) permettraient de récupérer ces produits tout au long du réseau de distribution. Cette méthode procurerait certains avantages économiques aux installations d’entreposage et de chargement.
Les avantages pour la production qui sont tirés des produits récupérés ont d’abord été calculés en estimant les volumes de produits récupérés (pétrole brut et essence) à partir des différentes installations concernées par le projet de règlement. Les tableaux 9 et 10 présentent les estimations des volumes de produits récupérés.
| Province/territoire | 2024-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2041-2045 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T.-N.-L. | 0 | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 45 602 |
| Î.-P.-É. | 0 | 1 028 | 1 028 | 1 028 | 1 028 | 4 110 |
| N.-É. | 0 | 3 689 | 5 096 | 5 096 | 5 096 | 18 977 |
| N.-B. | 0 | 1 368 | 5 038 | 5 038 | 5 038 | 16 481 |
| Qc | 0 | 10 059 | 12 049 | 12 049 | 12 049 | 46 206 |
| Ont. | 0 | 8 595 | 21 403 | 21 403 | 21 403 | 72 803 |
| Man. | 0 | 3 261 | 4 661 | 4 661 | 4 661 | 17 243 |
| Sask. | 0 | 5 395 | 10 246 | 10 246 | 10 246 | 36 132 |
| Alb. | 0 | 22 419 | 30 632 | 30 632 | 30 632 | 114 314 |
| C.-B. | 0 | 8 635 | 10 487 | 10 487 | 10 487 | 40 096 |
| Yn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.N.-O. | 0 | 559 | 559 | 559 | 559 | 2 236 |
| Nt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canada | 0 | 76 407 | 112 598 | 112 598 | 112 598 | 414 202 |
Remarque : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.
| Province/territoire | 2024-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2041-2045 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T.-N.-L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Î.-P.-É. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.-É. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.-B. | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 |
| Qc | 0 | 6 | 13 | 13 | 13 | 45 |
| Ont. | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 19 |
| Man. | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Sask. | 0 | 62 | 76 | 76 | 76 | 291 |
| Alb. | 0 | 97 | 141 | 141 | 141 | 521 |
| C.-B. | 0 | 17 | 18 | 18 | 18 | 71 |
| Yn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.N.-O. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Nt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canada | 0 | 184 | 261 | 261 | 261 | 968 |
Remarque : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.
Les avantages pour la production (le montant en dollars des produits récupérés) ont été estimés en multipliant le volume des produits récupérés par les prix prévus de ces produits obtenus à partir de l’E3MCréférence 28. Pour l’essence, le volume par province a été multiplié par le prix provincial. Toutefois, pour le pétrole brut, les volumes par province ont été multipliés par le prix moyen du pétrole brut lourd et léger du Canada, car il n’a pas été possible de faire la différence entre le pétrole brut lourd et léger (remarque : les prix ne sont pas disponibles à l’échelon provincial). Les tableaux 11 et 12 présentent les prix moyens prévus pour les carburants utilisés dans cette estimation. Les prix ont été calculés à partir d’un prix de gros hors taxes sur les carburants. On a prévu une augmentation des prix de l’essence selon le modèle E3MC, tandis qu’on a présumé que les prix du pétrole brut resteraient constants au fil des ans.
| Province/territoire | 2024-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2041-2045 |
|---|---|---|---|---|---|
| T.-N.-L. | 0,90 | 0,91 | 0,93 | 0,94 | 0,94 |
| Î.-P.-É. | 0,83 | 0,84 | 0,86 | 0,87 | 0,88 |
| N.-É. | 0,79 | 0,80 | 0,81 | 0,82 | 0,83 |
| N.-B. | 0,80 | 0,81 | 0,83 | 0,84 | 0,85 |
| Qc | 0,85 | 0,86 | 0,88 | 0,88 | 0,89 |
| Ont. | 0,81 | 0,82 | 0,84 | 0,84 | 0,85 |
| Man. | 0,84 | 0,85 | 0,87 | 0,88 | 0,89 |
| Sask. | 0,86 | 0,87 | 0,89 | 0,89 | 0,90 |
| Alb. | 0,83 | 0,84 | 0,86 | 0,86 | 0,87 |
| C.-B. | 0,99 | 1,00 | 1,02 | 1,03 | 1,04 |
| Yn | 1,20 | 1,21 | 1,24 | 1,25 | 1,26 |
| T.N.-O. | 1,08 | 1,09 | 1,12 | 1,13 | 1,14 |
| Nt | 1,20 | 1,21 | 1,24 | 1,25 | 1,26 |
| Type de pétrole brut | 2024-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2041-2045 |
|---|---|---|---|---|---|
| Brut lourd du Canada | 62,41 | 62,41 | 62,41 | 62,41 | 62,41 |
| Brut léger du Canada | 76,99 | 76,99 | 76,99 | 76,99 | 76,99 |
| Moyenne du pétrole canadien | 69,70 | 69,70 | 69,70 | 69,70 | 69,70 |
Les avantages pour la production de pétrole brut récupéré ont été estimés à 53 millions de dollars, tandis que ceux provenant de l’essence récupérée ont été estimés à 289 millions de dollars au cours de la période d’analyse, pour un total de 343 millions de dollars en produits récupérés (tableau 13).
| Province/territoire | 2024-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2041-2045 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T.-N.-L. | 0 | 9,6 | 8,9 | 8,1 | 7,4 | 33,9 |
| Î.-P.-É. | 0 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 2,8 |
| N.-É. | 0 | 2,7 | 3,5 | 3,2 | 2,9 | 12,2 |
| N.-B. | 0 | 1,1 | 3,7 | 3,4 | 3,1 | 11,2 |
| Qc | 0 | 8,4 | 9,6 | 8,8 | 8,0 | 34,7 |
| Ont. | 0 | 6,6 | 15,3 | 14,0 | 12,8 | 48,7 |
| Man. | 0 | 2,6 | 3,6 | 3,3 | 3,0 | 12,4 |
| Sask. | 0 | 8,3 | 12,1 | 11,0 | 10,0 | 41,3 |
| Alb. | 0 | 23,6 | 30,2 | 27,5 | 25,1 | 106,4 |
| C.-B. | 0 | 9,1 | 10,0 | 9,2 | 8,4 | 36,6 |
| Yn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.N.-O. | 0 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 2,1 |
| Nt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canada | 0 | 73,3 | 98,1 | 89,5 | 81,6 | 342,5 |
Remarque : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.
L’analyse suppose que : (1) les produits récupérés sont exportés et brûlés à l’étranger et, par conséquent, ne contribuent pas aux émissions nationales de GES (car ils ne font pas partie de la consommation nationale); (2) même si les produits récupérés sont brûlés localement, ils remplacent les mêmes produits et que, par conséquent, leur combustion n’entraîne pas d’émissions supplémentaires de GES.
Avantages liés aux changements climatiques
Étant donné que les hydrocarbures légers dissous dans le pétrole brut peuvent comporter du méthane, qui peut s’évaporer du pétrole brut au cours des activités d’entreposage et de chargement, la réduction des rejets fugitifs de COV provenant de l’entreposage et du chargement de pétrole brut permettrait également de réduire les émissions de méthane. Le méthane est un GES qui contribue au réchauffement planétaire. Les avantages liés aux changements climatiques qui découlent de la réduction des émissions de méthane ont été calculés à partir du coût social du méthane. La première étape consistait à estimer la réduction annuelle des émissions de méthane réalisée grâce au projet de règlement. Les émissions de méthane annuelles ont ensuite été combinées avec les valeurs actualisées du coût social du méthane pour estimer les avantages des réductions annuelles des émissions de méthane. Le tableau 14 présente les estimations de réduction d’émissions de méthane.
Le projet de règlement réduira les émissions de méthane d’environ 8 kt pendant la période d’analyse, ce qui entraînera des avantages en matière de changements climatiques (réduction des dommages liés aux changements climatiques) d’environ 24,3 millions de dollars.
| Province/territoire | 2024-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2041-2045 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T.-N.-L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Î.-P.-É. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.-É. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.-B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| Qc | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
| Ont. | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| Man. | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 |
| Sask. | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 2.2 |
| Alb. | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 4.1 |
| C.-B. | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |
| Yn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.-N.-O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canada | 0 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 7.8 |
Remarque : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.
Coûts supplémentaires
Dans l’ensemble, le projet de règlement entraînerait un coût total d’environ 1,09 milliard de dollars pour l’industrie et le gouvernement au cours de la période d’analyse, soit 67 millions de dollars annualisés. Une analyse des éléments de coûts se trouve ci-dessous.
Coûts pour l’industrie
Afin de se conformer au projet de règlement, l’industrie devra engager des coûts d’immobilisation et de fonctionnement (coûts liés à la conformité). De plus, afin de prouver la conformité au projet de règlement, l’industrie devra aussi engager des dépenses liées aux tests, à la surveillance et aux rapports (coûts administratifs). Les coûts totaux pour l’industrie sont estimés à 1,08 milliard de dollars pendant la période d’analyse.
Coûts des immobilisations
En raison du projet de règlement, l’industrie devra engager des dépenses pour installer de l’équipement de contrôle des émissions sur les grands réservoirs hors sol à pression atmosphérique et sur l’équipement de chargement des camions, des trains et des navires. En fonction des caractéristiques des hydrocarbures liquides entreposés et de la taille des réservoirs, l’industrie devra engager des dépenses pour équiper les réservoirs d’un système de contrôle des vapeurs, d’un toit flottant interne, d’un toit flottant externe ou d’une soupape de décompression. L’industrie devra aussi procéder à des dépenses pour équiper les rampes de chargement de systèmes de contrôle des vapeurs, en fonction des caractéristiques du produit traité et du débit des rampes. Les coûts des immobilisations devront probablement être engagés dès 2026 puisque les installations réglementées auront de deux à sept ans pour installer l’équipement de contrôle des émissions.
Les principaux coûts en immobilisations pour les réservoirs en lien avec le projet de règlement comprennent le remplacement complet des joints d’étanchéité du toit flottant, la modernisation des réservoirs à toit fixe en installant un nouveau toit flottant interne et l’installation d’un système de contrôle des vapeurs pour les réservoirs à toit fixeréférence 29. De même, les principaux coûts en immobilisations pour les opérations de chargement en lien avec le projet de règlement comprennent l’installation de systèmes de retour en boucle des vapeurs pour les grands dépôts routiers et l’installation de systèmes de contrôle des vapeurs ou de destruction des vapeurs aux rampes de chargement des camions, des trains et des naviresréférence 30
La première étape de l’estimation des coûts des immobilisations pour l’équipement consistait à compiler les coûts par unité pour le nouvel équipement de contrôle des émissions à installer (une seule fois) sur les réservoirs et les rampes de chargement qui contiennent des produits pétroliers liquides. La deuxième étape consistait à répertorier et documenter les réservoirs et les rampes de chargement ayant besoin de nouvel équipement à l’aide des données rapportées, des données recueillies par le Ministère en vertu de la LCPE, des renseignements disponibles ouvertement et de l’imagerie satellite. La troisième étape consistait à obtenir les coûts des immobilisations au niveau des installations en multipliant le coût par unité de l’équipement par le nombre de chaque type de réservoir ou de rampe de chargement ayant besoin d’un nouvel équipement. La quatrième étape consistait à obtenir les coûts totaux des immobilisations en agrégeant les coûts des immobilisations au niveau des installations. Le tableau 15 illustre les coûts estimatifs de l’équipement par unité. Ces coûts ont été estimés par le Ministère en utilisant des méthodes d’ingénierie pondérées avec l’objectif de refléter le coût total après l’installation pour un site typique. Les données ont été obtenues directement auprès des vendeurs d’équipement de contrôle des émissions et des manufacturiers de réservoirs, puis ont été validées par des intervenants intéressés du secteur du pétrole et du gaz.
| Catégorie | Exigence réglementaire | Type de carburant | Coûts non récurrents pour les immobilisations (en dollars de 2022) |
|---|---|---|---|
| Réservoirs | Remplacement complet du joint d’étanchéité du toit flottant (réservoir de 26 m de diamètre) | Essence / pétrole brut | 516 556 $ |
| Modernisation d’un réservoir à toit fixe par l’installation d’un nouveau toit flottant interne (réservoir de 26 m de diamètre) | Essence | 885 524 $ | |
| Modernisation de l’unité de contrôle des vapeurs pour les réservoirs de liquide à haute teneur en benzène équipés d’un toit flottant interne | Benzène | 5 088 811 $ | |
| Installation d’un système de retour en boucle des vapeurs dans un grand dépôt routier | Essence | 241 084 $ | |
| Rampes de chargement | Système de contrôle des vapeurs à un petit terminal pour les camions ou les trains (< 150 000 m3/année) | Essence / pétrole brut | 2 361 397 $ |
| Système de contrôle des vapeurs à un terminal de taille moyenne pour les camions ou les trains (< 450 000 m3/année) | Essence / pétrole brut | 4 014 375 $ | |
| Système de contrôle des vapeurs à un grand terminal pour les camions ou les trains (> 450 000 m3/année) | Essence / pétrole brut | 8 737 169 $ | |
| Système de contrôle des vapeurs à une rampe de chargement des navires (approximativement 1 500 000 m3/année) | Essence / pétrole brut | 13 637 068 $ |
Les coûts totaux des immobilisations estimés pour l’installation de l’équipement de contrôle des émissions sur les réservoirs et les opérations de chargement sont d’environ 828 millions de dollars de 2026 à 2030 (voir tableau 16), dont une partie importante, soit environ 695 millions de dollars, devrait être encourue en 2026. Ces coûts peuvent varier en fonction de la province, et ils devraient être les plus élevés en Alberta, suivie de l’Ontario, du Québec, de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan, du Manitoba, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador, puis de l’Île-du-Prince-Édouard (dans cet ordre). L’installation de l’équipement de contrôle des émissions visant les réservoirs hors sol devrait coûter 330 millions de dollars, tandis que le coût de l’installation de cet équipement pour les opérations de chargement devrait s’élever à 498 millions de dollars.
| Province/territoire | Coût pour l’équipement de contrôle des émissions sur les réservoirs | Coût pour l’équipement de contrôle des émissions sur les rampes de chargement | Coût total |
|---|---|---|---|
| T.-N.-L. | 2,5 | 17,0 | 19,4 |
| Î.-P.-É. | 0,5 | 3,9 | 4,4 |
| N.-É. | 1,7 | 26,3 | 28 |
| N.-B. | 6,7 | 4,8 | 11,4 |
| Qc | 37,7 | 97,9 | 135,6 |
| Ont. | 84,5 | 62,2 | 146,7 |
| Man. | 12,5 | 28,4 | 40,9 |
| Sask. | 37,2 | 52,2 | 89,5 |
| Alb. | 116,0 | 99,2 | 215,2 |
| C.-B. | 28,0 | 90,5 | 118,5 |
| Yn | 0 | 0 | 0 |
| T.-N.-O. | 2,8 | 15,4 | 18,2 |
| Nt | 0 | 0 | 0 |
| Canada | 330,1 | 497,7 | 827,9 |
Remarque : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.
Coûts de fonctionnement
Le projet de règlement exigerait que les membres de l’industrie inspectent régulièrement leurs réservoirs, leurs rampes de chargement ainsi que leur équipement de contrôle des émissions, en plus de procéder aux réparations nécessaires. Des tests de limite inférieure d’explosivité seraient requis pour les réservoirs équipés d’un toit flottant interne et une inspection de l’espace autour du joint d’étanchéité serait requise pour les réservoirs équipés d’un toit flottant externe. Ces coûts de fonctionnement débuteront probablement en 2026 puisque les installations réglementées auraient de deux à sept ans pour installer l’équipement de contrôle des émissions.
La première étape du calcul des coûts de fonctionnement a été l’estimation du nombre d’heures de main-d’œuvre qualifiée requises pour inspecter, réparer et entretenir l’équipement de contrôle des émissions installé sur les réservoirs et les rampes de chargement. Deuxièmement, les fréquences annuelles de la réalisation de ces activités au cours de l’année ont été estimées. Troisièmement, le salaire horaire de la main-d’œuvre qualifiée a été estimé. Quatrièmement, les coûts annuels du fonctionnement de l’équipement ont été estimés en multipliant le nombre d’heures de travail requis pour chaque activité par les fréquences annuelles de l’activité et le salaire horaire, puis les résultats pour les diverses activités ont été agrégés. Cinquièmement, les coûts annuels de fonctionnement au niveau des installations ont été obtenus en multipliant les coûts annuels de fonctionnement de l’équipement par le nombre de chaque type de réservoir ou de rampe de chargement où un nouvel équipement serait installé. Sixièmement, le total des coûts de fonctionnement annuels a été obtenu en agrégeant les coûts de fonctionnement annuels au niveau des installations. Le tableau 17 résume les coûts de fonctionnement annuels de l’équipement pour les réservoirs et les rampes de chargement. Ces coûts ont été estimés en utilisant des données obtenues directement auprès des vendeurs d’équipement de contrôle des émissions et des entreprises offrant des services d’inspection, de réparation et d’entretien, avant d’être validées par des intervenants intéressés du secteur du pétrole et du gaz.
| Catégorie | Exigence réglementaire | Produit | Coût de fonctionnement annuel (en dollars de 2022) |
|---|---|---|---|
| Réservoirs | Accroissement graduel des coûts de fonctionnement et d’entretien des réservoirs après l’installation d’un toit flottant, y compris 3 semaines-personnes de main-d’œuvre par année pour les inspections et l’entretien, et l’augmentation du coût des pièces pour l’instrumentation et les systèmes auxiliaires | Essence/pétrole brut | 20 294 $ |
| Limite inférieure d’explosivité et inspection visuelle du toit flottant interne sur un site comprenant entre 15 et 20 réservoirs | Essence/pétrole brut | 22 669 $ | |
| Système de contrôle des vapeurs sur un réservoir | Benzène | 100 832 $ | |
| Système de retour en boucle des vapeurs | Essence | 11 335 $ | |
| Rampes de chargement | Unités de contrôle des vapeurs à un petit terminal pour les camions ou les trains (< 150 000 m3/année) | Essence/pétrole brut | 94 928 $ |
| Unités de contrôle des vapeurs à un terminal de taille moyenne pour les camions ou les trains (< 450 000 m3/année) | Essence/pétrole brut | 100 832 $ | |
| Unités de contrôle des vapeurs à un grand terminal pour les camions ou les trains (> 450 000 m3/année) | Essence/pétrole brut | 106 735 $ | |
| Unités de contrôle des vapeurs à une rampe de chargement des navires (approximativement 1 500 000 m3/année) | Essence/pétrole brut | 130 349 $ |
Les estimations des coûts annuels sont fondées sur les grandes hypothèses suivantes :
- Un taux moyen de la main-d’œuvre de 100 $/h. Ce taux inclut les coûts indirects, comme les outils, les véhicules et l’équipement.
- Intervalle entre les inspections des réservoirs :
- Intervalle de 20 ans pour l’inspection interne
- Intervalle de 20 ans pour le remplacement des joints d’étanchéité du toit flottant d’un réservoir
- Intervalle de 5 ans pour l’inspection externe
- Intervalle de 1 an pour la mesure de l’espace entre le joint d’étanchéité secondaire sur les toits flottants externes
- Détermination de la limite inférieure d’explosivité et inspection visuelle mensuelle pour les toits flottants internes
- Intervalle entre les inspections des rampes de chargement :
- Intervalle de 1 an pour le test de rendement
- Intervalle de 1 an pour la détection des fuites
- Inspection visuelle mensuelle
Les coûts de fonctionnement totaux pour les réservoirs et les opérations de chargement sont estimés à 247 millions de dollars pendant la période d’analyse (Tableau 18)référence 31. Comme pour les coûts des immobilisations, les coûts de fonctionnement peuvent varier en fonction de la province, et ils devraient être plus élevés en Alberta, suivi de l’Ontario, du Québec, de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan, du Manitoba, de la Nouvelle-Écosse, de Terre-Neuve-et-Labrador, du Nouveau-Brunswick et puis de l’Île-du-Prince-Édouard (dans cet ordre). Les coûts liés à l’inspection, à la réparation et à l’entretien de l’équipement de contrôle des émissions installé sur les réservoirs sont estimés à 103 millions de dollars (Tableau 19), et à 144 millions de dollars pour les opérations de chargement (Tableau 20).
| Province ou territoire | 2024-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2041-2045 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T.-N.-L. | 0,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 3,7 |
| Î.-P.-É. | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,6 |
| N.-É. | 0,0 | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,6 | 7,0 |
| N.-B. | 0,0 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 5,0 |
| Qc | 0,0 | 8,7 | 10,0 | 9,1 | 8,2 | 36,0 |
| Ont. | 0,0 | 8,5 | 11,2 | 10,1 | 9,2 | 39,0 |
| Man. | 0,0 | 3,4 | 4,1 | 3,7 | 3,4 | 14,5 |
| Sask. | 0,0 | 7,8 | 9,7 | 8,8 | 7,9 | 34,2 |
| Alb. | 0,0 | 15,8 | 21,1 | 19,1 | 17,3 | 73,4 |
| C.-B. | 0,0 | 6,7 | 8,0 | 7,3 | 6,6 | 28,6 |
| Yn | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| T.-N.-O. | 0,0 | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 4,0 |
| Nt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Canada | 0,0 | 55,9 | 70,1 | 63,5 | 57,5 | 247,0 |
Remarque : La somme des chiffres peut ne pas correspondre aux totaux en raison d’arrondissements.
| Province ou territoire | 2024-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2041-2045 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T.-N.-L. | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| Î.-P.É. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| N.-É. | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 |
| N.-B. | 0,0 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 2,0 |
| Qc | 0,0 | 3,3 | 3,9 | 3,5 | 3,2 | 13,9 |
| Ont. | 0,0 | 5,1 | 7,3 | 6,6 | 6,0 | 24,9 |
| Man. | 0,0 | 0,8 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 4,0 |
| Sask. | 0,0 | 2,2 | 3,3 | 3,0 | 2,7 | 11,3 |
| Alb. | 0,0 | 7,5 | 11,6 | 10,5 | 9,5 | 39,2 |
| C.-B. | 0,0 | 1,4 | 1,9 | 1,7 | 1,6 | 6,6 |
| Yn | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| T.-N.-O. | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,6 |
| Nt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Canada | 0,0 | 21,0 | 30,1 | 27,3 | 24,7 | 103,1 |
Remarque : La somme des chiffres peut ne pas correspondre aux totaux en raison d’arrondissements.
| Province ou territoire | 2024-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2041-2045 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T.-N.-L. | 0,0 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 3,5 |
| Î.-P.É. | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 1,5 |
| N.-É. | 0,0 | 1,6 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 6,6 |
| N.-B. | 0,0 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 3,0 |
| Qc | 0,0 | 5,4 | 6,2 | 5,6 | 5,0 | 22,1 |
| Ont. | 0,0 | 3,4 | 3,9 | 3,5 | 3,2 | 14,1 |
| Man. | 0,0 | 2,6 | 2,9 | 2,7 | 2,4 | 10,5 |
| Sask. | 0,0 | 5,6 | 6,4 | 5,8 | 5,2 | 22,9 |
| Alb. | 0,0 | 8,3 | 9,5 | 8,6 | 7,8 | 34,2 |
| C.-B. | 0,0 | 5,3 | 6,1 | 5,5 | 5,0 | 22,0 |
| Yn | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| T.-N.-O. | 0,0 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 3,4 |
| Nt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Canada | 0,0 | 34,9 | 40,0 | 36,2 | 32,8 | 143,9 |
Remarque : La somme des chiffres peut ne pas correspondre aux totaux en raison d’arrondissements.
Autres coûts de conformité
Les autres coûts de conformité, qui ne sont pas classés comme des coûts des immobilisations ou de fonctionnement dans les sections précédentes, s’élèveraient à 2,8 millions de dollars au cours de la période d’analyse. Cela comprend un coût initial de 0,6 million de dollars pour les parties réglementées afin d’établir un programme d’inspection et des coûts permanents de 2,2 millions de dollars associés à l’assistance aux vérificateurs et aux activités d’application du gouvernement, ainsi qu’à la préparation et à la soumission des rapports sur les réparations et les pannes. Une ventilation détaillée de ces coûts est présentée dans le tableau 21.
| Catégorie de coûts | 2024-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2041-2045 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coûts initiaux | 595 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595,682 |
| Mise sur pied du programme d’inspection | 595 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 682 |
| Coûts permanents | 220 715 | 571 955 | 518 038 | 469 203 | 424 971 | 2 204 882 |
| Appui à la vérification et aux mesures d’application de la réglementation | 220 715 | 515 015 | 466 465 | 422 492 | 382 664 | 2 007 351 |
| Préparation et présentation des rapports de réparations et de pannes | 0 | 56 940 | 51 573 | 46 711 | 42 307 | 197 531 |
| Total | 816 397 | 571 955 | 518 038 | 469 203 | 424 971 | 2 800 564 |
Coûts administratifs
Le projet de règlement devrait entraîner environ 5,9 millions de dollars de coûts administratifs supplémentaires pour l’industrie durant la période d’analyse. Cela comprend des coûts ponctuels inférieurs à 0,1 million de dollars encourus par les parties réglementées afin de se familiariser avec les exigences réglementaires et de produire et soumettre des rapports d’enregistrement. Cela comprend également des coûts annuels permanents d’environ 5,9 millions de dollars pendant la période d’analyse pour conserver les résultats des inspections, conserver une liste de l’équipement, des substances et des rapports sur le débit. Une ventilation de ces coûts est présentée au tableau 22.
| Catégorie de coûts | 2024-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2041-2045 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coûts initiaux | 63 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 253 |
| Familiarisation avec les obligations réglementaires | 37 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 312 |
| Enregistrement | 25 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 941 |
| Coûts permanents | 646 923 | 1 509 527 | 1 367 225 | 1 238 338 | 1 121 601 | 5 883 615 |
| Tenue à jour des résultats d’inspection | 323 461 | 754 764 | 683 613 | 619 169 | 560 801 | 2 941 808 |
| Tenue à jour des listes d’équipement et des registres de substances et de débit | 323 461 | 754 764 | 683 613 | 619 169 | 560 801 | 2 941 808 |
| Total | 710 176 | 1 509 527 | 1 367 225 | 1 238 338 | 1 121 601 | 5 946 868 |
Coûts pour le gouvernement
Le projet de règlement engendrerait des coûts pour le gouvernement fédéral du point de vue de l’administration des programmes, de la promotion de la conformité et de l’application de la réglementation. Les coûts totaux pour le gouvernement sont estimés à environ 10 millions de dollars sur la période d’analyse.
Administration du programme
L’administration des programmes est essentielle à la mise en œuvre et à la gestion du projet de règlement. Les principales activités comprennent la tenue à jour du contenu du site Web, le traitement et l’analyse des rapports fournis par les exploitants, la mesure du rendement du programme et la supervision de l’approbation et l’entretien des permis dans le cadre des systèmes de permis optionnels prévus par le projet de règlement. Ces systèmes prévoient notamment des permis pour l’utilisation de toits flottants comme alternative aux systèmes de contrôle des vapeurs pour certains réservoirs contenant des liquides à haute concentration de benzène, des permis pour de nouveaux équipements de contrôle des émissions de substitution et des permis pour des méthodes d’essai de rechange afin de déterminer les propriétés des substances. Les coûts totaux d’administration du programme sont estimés à environ 4,6 millions de dollars sur la période d’analyse.
Promotion de la conformité
La promotion de la conformité comprend les activités réalisées dans le but de faire connaître et comprendre les exigences réglementaires. Il s’agit notamment de l’élaboration, de la publication et de la diffusion de matériel promotionnel, comme des foires aux questions ou des fiches d’information, la tenue de séances d’information, la réponse aux demandes de renseignements ou d’éclaircissements, le suivi des demandes de renseignements, l’envoi de lettres de rappel, la publication d’annonces dans les revues spécialisées et les magazines d’association et la participation à des conférences d’association. Les activités de promotion de la conformité devraient être peu nombreuses, car les exploitants sont essentiellement de grandes entreprises qui disposent des ressources et de la capacité nécessaires pour bien comprendre d’elles-mêmes leurs obligations réglementaires. Ces coûts seraient annuels et sont estimés à environ 0,8 million de dollars sur la période d’analyse.
Coûts liés à l’application de la réglementation
L’application de la réglementation comprend les mesures requises pour amener les exploitants non conformes à se conformer. Plus particulièrement, l’application du projet de règlement engendrera des coûts supplémentaires pour le gouvernement fédéral en ce qui a trait à la formation, à l’évaluation du renseignement stratégique, aux inspections, aux enquêtes et aux mesures visant à traiter les infractions alléguées. Le gouvernement fédéral devrait assumer des coûts liés à l’application de la réglementation se chiffrant à 4,4 millions de dollars sur la période d’analyse. Cela inclut un coût ponctuel de 0,65 million de dollars pour la formation des agents d’application et la réalisation des travaux d’évaluation du renseignement stratégique. Cela inclut aussi des coûts récurrents totaux de 3,75 millions de dollars sur la période d’analyse pour les inspections, les enquêtes et les mesures visant à traiter les infractions alléguées.
Coûts et avantages
Les résultats de l’ACA sont résumés dans les tableaux 23 à 25. Les avantages totaux sont estimés à environ 1,43 milliard de dollars, tandis que les coûts totaux sont estimés à environ 1,09 milliard de dollars Les avantages nets du projet de règlement sont estimés à environ 337 millions de dollars.
L’analyse des avantages montre que le projet de règlement générerait 1,05 milliard de dollars en avantages pour la santé ainsi que 14 millions de dollars en avantages pour l’environnement. Les autres avantages comprennent les avantages liés à la production découlant des produits récupérés (343 millions de dollars) et les avantages en matière de changements climatiques découlant des réductions des émissions de méthane (24 millions de dollars). En raison du manque de données, les avantages associés à la réduction des rejets de substances cancérigènes ne sont pas quantifiés ni monétisés.
L’analyse des coûts montre que l’industrie devrait assumer des coûts liés à la conformité à hauteur de 1,08 milliard de dollars pour appliquer les exigences réglementaires proposées. Cela inclut 828 millions de dollars en coûts des immobilisations, 247 millions de dollars en coûts de fonctionnement et 2,8 millions de dollars en autres coûts de conformité. En plus des coûts liés à la conformité, l’industrie et le gouvernement devraient assumer des coûts administratifs de près de 6 millions de dollars et de 10 millions de dollars, respectivement.
- Nombre d’années : 22 (2024 à 2045)
- Année de référence pour l’établissement des coûts : 2022
- Année de référence de la valeur actuelle : 2024
- Taux d’actualisation : 2 %
| Partie intéressée touchée | Description de l’avantage | 2024-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2041-2045 | Total | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canadiens | Avantages pour la santé | 0,0 | 226,3 | 270,2 | 275,4 | 277,2 | 1 049,0 | 59,4 |
| Avantages environnementaux | 0,0 | 3,3 | 3,8 | 3,6 | 3,4 | 14,2 | 0,8 | |
| Avantages en matière de changements climatiques | 0,0 | 4,9 | 6,2 | 6,5 | 6,8 | 24,3 | 1,4 | |
| Industrie | Avantages liés à la production | 0,0 | 73,3 | 98,1 | 89,5 | 81,6 | 342,5 | 19,4 |
| Toutes les parties intéressées | Avantages totaux | 0,0 | 307,7 | 378,3 | 375,0 | 369,0 | 1 430,0 | 81,0 |
Remarque : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.
| Partie intéressée touchée | Description des coûts | 2024-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2041-2045 | Total | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Industrie | Coûts des immobilisations | 0,0 | 827,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 827,9 | 46,9 |
| Coûts de fonctionnement | 0,0 | 55,9 | 70,1 | 63,5 | 57,5 | 247,0 | 14,0 | |
| Autres coûts de conformité | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 2,8 | 0,2 | |
| Coûts administratifs | 0,7 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 5,9 | 0,3 | |
| Gouvernement | Administration des programmes | 0,5 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 4,6 | 0,3 |
| Promotion de la conformité | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 0,0 | |
| Application de la réglementation | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 4,4 | 0,2 | |
| Toutes les parties intéressées | Coûts totaux | 3,2 | 888,2 | 74,1 | 67,1 | 60,8 | 1 093,5 | 61,9 |
Remarque : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.
| Toutes les parties intéressées | 2024-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2041-2045 | Total | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avantages totaux | 0,0 | 307,7 | 378,3 | 375,0 | 369,0 | 1 430,0 | 81,0 |
| Coûts totaux | 3,2 | 888,2 | 74,1 | 67,1 | 60,8 | 1 093,5 | 61,9 |
| Répercussions nettes (avantages-coûts) | -3,2 | -580,5 | 304,2 | 307,9 | 308,2 | 336,5 | 19,1 |
Remarque : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.
Impacts quantifiés (non monétisés) et qualitatifs
- Avantages pour la santé et l’environnement découlant des améliorations de la qualité de l’air attribuables à la réduction des rejets de COV des dépôts routiers (réductions des émissions de COV quantifiées, mais non monétisées)
- Avantages pour la santé associés à la réduction de l’exposition aux substances cancérigènes comme le benzène (réductions des émissions de substances cancérigènes quantifiées, mais non monétisées)
Analyse distributionnelle
Les coûts liés à la conformité et les réductions des COV varient selon la province et le territoire ainsi que le type d’installation. Les résultats de cette analyse sont présentés aux tableaux 26 et 27.
Parmi les provinces, l’Alberta, l’Ontario, la Colombie-Britannique et la Saskatchewan représenteraient 85,3 % des coûts liés à la conformité. Les mêmes provinces représenteraient également 80,4 % des réductions des émissions de COV. L’Alberta devrait assumer la plus grande partie des coûts liés à la conformité et des réductions d’émissions de COV, car la province est celle qui possède la plus grande partie de la production de pétrole brut et de la capacité de raffinage au Canadaréférence 32.
Parmi les différents types d’installations réglementées, les terminaux principaux, les terminaux de pétrole brut et les raffineries représentent 83,7 % des coûts liés à la conformité. Par ailleurs, les mêmes types d’installations combinés représentent 85 % des réductions des émissions de COV. Les terminaux principaux ont les coûts liés à la conformité et les réductions d’émissions de COV les plus élevés, car ils constituent le type d’installation le plus répandu, et stockent et chargent généralement de grands volumes de produits volatils (surtout de l’essence).
| Province ou territoire | Total des coûts liés à la conformité (en millions $) | Total des coûts liés à la conformité (%) | Total des réductions des émissions de COV (kt) | Total des réductions des émissions de COV (%) |
|---|---|---|---|---|
| T.-N.-L. | 23,1 | 2,2 | 34,2 | 6,9 |
| Î.-P.-É. | 5,9 | 0,6 | 3,1 | 0,6 |
| N.-É. | 35,0 | 3,3 | 17,8 | 3,6 |
| N.-B. | 16,5 | 1,5 | 17,3 | 3,5 |
| Qc | 171,6 | 16,0 | 44,7 | 9,1 |
| Ont. | 185,8 | 17,3 | 64,5 | 13,1 |
| Man. | 55,4 | 5,2 | 22,3 | 4,5 |
| Sask. | 123,7 | 11,5 | 73,2 | 14,8 |
| Alb. | 288,5 | 26,8 | 170,7 | 34,6 |
| C.-B. | 147,1 | 13,7 | 43,6 | 8,8 |
| Yn | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| T.-N.-O. | 22,1 | 2,1 | 2,3 | 0,5 |
| Nt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Canada | 1 074,9 | 100 | 493,6 | 100 |
Remarque : Les pourcentages étant arrondis, leur somme pourrait ne pas totaliser 100 %.
| Type d’installation | Total des coûts liés à la conformité (en millions $) | Total des coûts liés à la conformité (%) | Total des réductions des émissions de COV (kt) | Total des réductions des émissions de COV (%) |
|---|---|---|---|---|
| Terminal principal | 391,1 | 36,4 | 178,0 | 36,1 |
| Terminal de pétrole brut | 329,7 | 30,7 | 126,8 | 25,7 |
| Raffinerie | 178,6 | 16,6 | 114,9 | 23,3 |
| Terminal de raffinerie | 64,4 | 6,0 | 36,3 | 7,4 |
| Installation chimique | 59,6 | 5,5 | 8,6 | 1,7 |
| Usine de traitement | 43,8 | 4,1 | 21,3 | 4,3 |
| Dépôt routier | 7,6 | 0,7 | 7,7 | 1,6 |
| Total | 1 074,9 | 100 | 493,6 | 100 |
Remarque : Les pourcentages étant arrondis, leur somme pourrait ne pas totaliser 100 %.
Analyse de compétitivité
Les réservoirs de stockage et les opérations de chargement sont répandus dans la chaîne de valeur du pétrole et du gaz et dans le secteur chimique. Par conséquent, l’impact sur la compétitivité peut être analysé sous trois angles principaux :
- Carburants / produits raffinés : Cette catégorie englobe la production et la distribution de carburant, tous les réservoirs d’essence, et les réservoirs de brut dans les raffineries. Elle devrait supporter la majeure partie des coûts réglementaires totaux, soit environ 58 %.
- Pétrole brut : Cette catégorie comprend les usines de valorisation et la plupart des réservoirs et terminaux de pétrole brut qui devraient supporter 37 % des coûts totaux.
- Pétrochimie : Ce secteur représente une part moins importante, mais significative, des coûts réglementaires estimés, soit 5 % des coûts totaux.
Chacun de ces secteurs est vaste et complexe, le stockage et le chargement représentant une part importante mais relativement mineure des budgets d’immobilisations et des coûts de fonctionnement et de maintenance. Les coûts différentiels nets pour l’industrie, après déduction de la valeur de la récupération des produits, sont estimés à 741 millions de dollars. Ces coûts devraient être principalement assumés au cours des cinq premières années suivant la mise en œuvre du projet de règlement. Afin de contextualiser ces coûts par rapport aux dépenses d’exploitation globales de l’industrie, une analyse a été menée sur les états financiers d’un échantillon de sociétés cotées en bourse qui exploitent des installations réglementées, représentant environ 50 % des coûts de conformité. En supposant que ces coûts soient répartis uniformément entre 2026 et 2030, ils représenteraient 0,2 % de la moyenne annuelle des dépenses d’exploitation ou de la marge brute moyenne du secteur pour la période allant de 2018 à 2022. Cette analyse indique que les coûts de conformité ne devraient pas avoir d’incidence significative sur la compétitivité ou la rentabilité des secteurs concernés, à savoir les opérations de chargement de produits pétroliers, le stockage de pétrole brut ou la production pétrochimique.
On observe une tendance au regroupement aux terminaux urbains de grande taille et aux dépôts routiers, et celle-ci devrait se poursuivre. Le projet de règlement exclut les installations de très petite taille et offre une plus grande marge de manœuvre et des options à plus faible coût pour les terminaux de petite ou de moyenne taille; toutefois, il se pourrait que certaines installations réglementées ferment leurs portes si les investissements en capitaux supplémentaires devant être faits ne sont pas appuyés par une bonne analyse de rentabilisation. Toutefois, la décision d’une entreprise de fermer une installation réglementée serait plus probable si l’installation était déjà, pour d’autres raisons, susceptible d’être fermée à l’avenir. Comme indiqué ci-dessus, les coûts de conformité représentent une fraction relativement modeste des dépenses d’exploitation annuelles (ou correspondent à la variation annuelle des dépenses d’immobilisations des installations concernées).
Le degré de répercussion des coûts de production sur les consommateurs est incertain. La répercussion des coûts dépend de divers facteurs, tels que le degré de concurrence sur les marchés locaux, les augmentations de prix réglementées dans certaines juridictions, les contraintes de distribution, l’équilibre entre la demande régionale de produits pétroliers et la capacité de production locale dans ces régions, et les taux de changeréférence 33. Dans un scénario de répercussion totale des coûts (c’est-à-dire lorsque tous les coûts de mise en conformité sont répercutés sur les consommateurs), l’augmentation correspondante des prix à la consommation devrait être faible. La répercussion potentielle des coûts s’est avérée la plus élevée dans la partie 2026-2030 de la période d’analyse, en raison de la concentration des coûts des immobilisations en début de période, lorsqu’elle s’élevait à 0,0025 $/litre (ou 0,25 ¢/litre) d’essence vendue, et à moins de 0,0002 $/litre (ou 0,02 ¢/litre) pour le diesel et d’autres produits. Sur la base des ventes d’essence aux consommateurs en 2019référence 34, soit 1 153 litres par habitant à l’échelle nationale et 1 783 litres par habitant en Saskatchewan, la province où la consommation par habitant est la plus élevée, l’impact potentiel maximal sur les consommateurs a été déterminé à 2,85 $ par personne et par an en moyenne, et à 4,40 $ par personne et par an en Saskatchewan. Il est probable que les valeurs réelles seront inférieures à ces estimations, car la concurrence du marché empêchera l’industrie de répercuter tous les coûts de conformité.
Analyse de sensibilité
L’analyse de sensibilité permet de tenir compte dans l’ACA des effets des changements dans les variables incertaines sur les résultats du projet de règlement. Deux types d’analyse ont été effectués, soit une analyse de sensibilité partielle et une analyse par la méthode de Monte-Carlo.
Une analyse de sensibilité partielle a été réalisée dans le but d’examiner l’incidence de variables clés sur les avantages nets du projet de règlement tout en gardant les autres variables constantes. L’analyse a été effectuée avec une seule variable et avec des variables multiples. Les principales variables prises en considération étaient le taux d’actualisation (0 %, 3 %, 7 %), les frais d’immobilisations (+/-20 %) et les prévisions des prix du carburant (+/-20 %). Le taux d’actualisation tient compte des préférences temporelles pour la consommation (la consommation d’aujourd’hui est préférable à la consommation future) ou la valeur temporelle de l’argent (les gens préfèrent payer plus tard et recevoir des avantages plus vite). Ainsi, un taux d’actualisation plus élevé générerait une valeur actuelle plus faible tant pour les avantages que pour les coûts, engendrant moins d’avantages nets. Bien que les coûts des immobilisations fassent partie des coûts liés à la conformité, les prix du carburant sont utilisés dans le calcul de la valeur des produits récupérés (avantages liés à la production). Cela signifie que l’augmentation des coûts des immobilisations réduirait les avantages nets, tandis que l’augmentation des prix du carburant accroîtrait les avantages nets.
Comme le montre le tableau 28, le fait de changer les coûts des immobilisations ou les prix du carburant ne modifie pas la conclusion selon laquelle le projet de règlement produirait des avantages nets pour les Canadiens. Toutefois, l’application d’un taux d’actualisation supérieur à 6,3 %, sans que les autres variables soient changées, fait en sorte que le projet de règlement aurait un coût net. Le projet de règlement atteint le seuil de la rentabilité (c’est-à-dire produit des avantages nets approchant de 0 $) quand le taux d’actualisation est à 3,4 %, le coût des immobilisations est 20 % plus élevé et le prix du carburant est 20 % plus bas.
| Variables | Avantages totaux | Coûts totaux | Avantages nets |
|---|---|---|---|
| Cas central | 1 430,0 | 1 093,5 | 336,5 |
| Taux d’actualisation de 7 % | 851,4 | 898,4 | -47,0 |
| Taux d’actualisation de 3 % | 1 278,6 | 1 046,8 | 231,8 |
| Taux d’actualisation de 0 % | 1 812,0 | 1 203,1 | 608,9 |
| Coûts des immobilisations 20 % plus élevés | 1 430,0 | 1 259,1 | 170,9 |
| Coûts des immobilisations 20 % plus bas | 1 430,0 | 927,9 | 502,1 |
| Prix du carburant 20 % plus bas | 1 361,5 | 1 093,5 | 268,0 |
| Prix du carburant 20 % plus élevés | 1 498,5 | 1 093,5 | 405,0 |
| Taux d’actualisation de 7 %, coûts des immobilisations 20 % plus élevés et prix du carburant 20 % plus bas | 810,7 | 1 046,2 | -235,6 |
| Taux d’actualisation de 3 %, coûts des immobilisations 20 % plus élevés et prix du carburant 20 % plus bas | 1 217,4 | 1 208,6 | 8,8 |
| Taux d’actualisation de 0 %, coûts des immobilisations 20 % plus bas et prix du carburant 20 % plus élevés | 1 898,7 | 1 029,4 | 869,3 |
Une analyse par la méthode de Monte-Carlo a également été réalisée afin d’évaluer ensemble la sensibilité de trois variables clés (taux d’actualisation, coûts des immobilisations et prix du carburant). Ce type d’analyse repose sur une simulation sur ordinateur et consiste en un échantillonnage aléatoire répété de variables clés qui sont considérées comme étant sujettes à l’incertitude. Ce processus permet d’obtenir les valeurs escomptées et les probabilités statistiques. Il est donc possible de voir la probabilité que le résultat (comme des avantages nets) se produise quand toutes les variables peuvent varier simultanément. Cette simulation comptait 10 000 itérations, chacune ayant produit une valeur escomptée de l’avantage net. Une distribution triangulaire a été appliquée pour le taux d’actualisation (0 % minimum, 2 % moyen, 7 % maximum), tandis qu’une distribution PERT a été appliquée aux changements dans les coûts en capital et les prix du carburant (-20 % minimum, 0 % plus probable, 20 % maximum). Les résultats de l’analyse par la méthode de Monte-Carlo ont permis de conclure que le projet de règlement engendrerait un avantage net moyen de 249 M$, avec une probabilité de 90 % que l’avantage net se chiffre entre 5 M$ et 509 M$. De plus, il y aurait 95 % de chances que le projet de règlement engendre au moins un avantage net pour les Canadiens ainsi que 5 % de chances qu’il engendre un coût net.
Lentille des petites entreprises
L’analyse effectuée selon la lentille des petites entreprises a permis de conclure que le projet de règlement aurait des répercussions sur les petites entreprises. D’après les consultations réalisées au sujet du document de discussion relatif à l’approche proposée, on estime que trois petites entreprisesréférence 35 pourraient être touchées par le projet de règlement. D’autres analyses pourraient être requises si d’autres petites entreprises sont repérées pendant les consultations de la Gazette du Canada.
Les exigences en matière d’équipement du projet de règlement sont fondées sur une analyse détaillée tenant compte des coûts, de la taille, de la portée, des risques pour la santé et des avantages. Selon les estimations, les options à plus faible coût respectent les budgets d’immobilisations et d’entretien des installations réglementées. Une lentille de rentabilité a été utilisée afin de sélectionner les exigences appropriées pour les diverses catégories d’installations dans le but de réduire au minimum l’incidence sur les petites entreprises quand les risques associés aux émissions sont faibles. Les estimations et les analyses étaient fondées sur les valeurs déclarées par l’industrie, les soumissions des fournisseurs ainsi que les pratiques et les méthodes standard de l’industrie.
Le coût associé aux exigences du projet de règlement augmente selon la taille de l’installation réglementée et l’équipement connexe. Les installations de petite taille seraient autorisées à utiliser des mesures moins coûteuses comme la combustion des vapeurs ou l’équilibrage des vapeurs. Celles-ci permettraient quand même de contrôler les risques d’émissions de COV tout en offrant plus d’options pour remplir les exigences du projet de règlement. Un seuil de débit variable est utilisé pour déterminer l’applicabilité, ce qui réduit ou élimine la portée pour les petites installations qui représentent un risque minimal d’émissions de COV.
Le projet de règlement exclut les installations qui stockent, chargent et déchargent des volumes de liquides pétroliers volatils inférieurs à un certain seuil, généralement autour de 2 000 000 litres standard de capacité de stockage et 20 000 000 litres standard en chargement et en déchargement par année. Ces exclusions feraient en sorte que le projet de règlement ne s’appliquerait pas à la plupart des petites entreprises qui stockent et chargent des liquides pétroliers volatils.
Résumé de la lentille des petites entreprises
- Nombre de petites entreprises touchées : 3
- Nombre d’années : 22 (2024 à 2045)
- Année de référence pour l’établissement des coûts : 2022
- Année de référence de la valeur actuelle : 2024
- Taux d’actualisation : 2 %
| Activité | Valeur annualisée | Valeur actuelle |
|---|---|---|
| Mise sur pied du programme d’inspection | 363 $ | 6 405 $ |
| Préparation et présentation des rapports de réparations et de pannes | 1 281 $ | 22 621 $ |
| Appui à la vérification et aux mesures d’application de la réglementation | 64 $ | 1 127 $ |
| Total des coûts liés à la conformité | 1 708 $ | 30 153 $ |
| Activité | Valeur annualisée | Valeur actuelle |
|---|---|---|
| Enregistrement | 18 $ | 320 $ |
| Tenue à jour des résultats d’inspection | 1 922 $ | 33 931 $ |
| Tenue à jour des listes d’équipement et des registres de substances et de débit | 1 922 $ | 33 931 $ |
| Total des frais administratifs | 3 862 $ | 68 182 $ |
| Total | Valeur annualisée | Valeur actuelle |
|---|---|---|
| Coûts totaux (toutes les petites entreprises touchées) | 5 569 $ | 98 335 $ |
| Coût par petite entreprise touchée | 1 856 $ | 32 778 $ |
Règle du « un pour un »
La règle du un pour un s’applique, car l’ajout d’un nouveau titre réglementaire engendrerait une augmentation du fardeau administratif sur les entreprises. Les coûts administratifs pour les exploitants comprendraient les coûts associés aux tests, à la surveillance et à la production de rapports visant à démontrer la conformité avec le projet de règlement. Plus précisément, il s’agirait de coûts nécessaires pour que les parties réglementées se familiarisent avec leurs obligations réglementaires, préparent et présentent des rapports d’enregistrement, maintiennent les résultats d’inspection, maintiennent des listes d’équipement et des registres de substances et de débit, préparent et présentent des rapports sur les réparations et les pannes et contribuent aux activités de vérification et d’application de la réglementation. Cela nécessiterait six heures en temps de la haute direction (à 61,80 $ l’heure) en coûts initiaux (engagés en 2024) pour la familiarisation avec les obligations réglementaires, pour chaque raffinerie, usine de traitement et installation et tous les propriétaires de terminaux, terminaux portuaires et dépôts routiers. De plus, chaque installation réglementée aurait besoin de 2 heures en temps de personnel (à 42,96 $ l’heure) en coûts initiaux pour l’enregistrement de l’installation. Enfin, chaque installation réglementée aurait besoin de 24 heures en temps de personnel (à 42,96 $ l’heure) — ou 32 heures en temps de personnel pour les raffineries, les usines de traitement et les installations chimiques — tous les ans pour le maintien des registres des résultats d’inspection, des listes d’équipement et des registres de substances et de débit. Le tableau 1 illustre le nombre d’installations réglementées utilisées dans ces calculs.
En dollars constants de 2012 (l’année de référence) et en fonction d’une période de 10 ans à partir de l’année d’enregistrement (c’est-à-dire 2024 à 2033) ainsi que d’un taux d’actualisation de 7 %, l’augmentation moyenne annualisée du fardeau administratif pour les entreprises touchées est estimée à 119 963 $ ou une moyenne de 416,54 $ par entreprise, calculée à l’aide du Calculateur des coûts réglementaires du Secrétariat du Conseil du Trésor. Cela représente un « ajout » en vertu de la règle d’après la Politique sur la limitation du fardeau réglementaire sur les entreprises.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Toutes les politiques canadiennes pertinentes, y compris les mesures volontaires, les règlements fédéraux et les mesures provinciales ou municipales, ont été examinées en détail. Des exigences ont été cernées dans les provinces de l’Ontario, du Québec et de Terre-Neuve-et-Labrador ainsi que dans les municipalités de Montréal et du Grand Vancouver.
La réglementation fédérale des États-Unis (contenue dans le Code of Federal Regulations des États-Unisréférence 36) a été examinée en détail et une analyse sommaire des exigences de chaque État a été réalisée. Les discussions informelles ayant eu lieu avec des représentants de l’Environmental Protection Agency des États-Unis ont montré que le projet de règlement ne suscitait pas de préoccupations.
Il a été déterminé que le projet de règlement suit de près la politique des États-Unis (les États-Unis réglementent ces sources d’émissions à l’aide d’exigences semblables depuis les années 1980). Il suit également de près les exigences provinciales et municipales au Canada (inspirées en grande partie des exigences des États-Unis et des codes du CCME à titre volontaire). Le projet de règlement diffère de ces exigences de certaines façons qui optimisent la gestion des risques sanitaires, réduisent les coûts pour l’industrie ou actualisent les exigences de performance, en particulier des exigences plus strictes dans le cas des réservoirs de liquide à haute teneur en benzène, de différents seuils de dimensions de l’équipement, des considérations d’installations rurales et éloignées, et de différentes procédures d’inspection et de réparation.
On a relevé d’autres politiques internationales dans des régions, notamment l’Europe, qui ressemblaient généralement aux politiques existantes aux États-Unis et au Canada. Ces politiques internationales n’ont pas été analysées en détail puisqu’il a été déterminé que l’avantage de la conformité serait minime, vu que l’industrie au Canada n’utilise pas les normes internationales et qu’il n’y a pas d’intégration importante d’infrastructures pétrolières ou de production d’équipement avec d’autres pays à part les États-Unis.
Les discussions avec Transports Canada ont fait ressortir une obligation de notifier l’Organisation maritime internationale que les émissions de COV doivent être réglementées. Les exigences de cette notification sont répertoriées dans la règle 15 de l’annexe VI de MARPOL et elle doit être soumise au moins six mois avant la date d’entrée en vigueur.
Évaluation environnementale stratégique
Le projet de règlement se traduirait par une réduction des rejets de COV et de benzène dans l’atmosphère. Les réductions des rejets de COV et l’amélioration de la qualité de l’air devraient contribuer à des améliorations de la santé humaine et de la qualité de l’environnement. Il y aurait également une réduction fortuite des émissions de GES, essentiellement des réductions des émissions de méthane.
La réduction des émissions de COV est estimée à environ 494 kt au cours de la période analytique, tandis que la réduction des émissions de méthane est estimée à 8 kt au cours de la période analytique.
Le projet de règlement contribuerait directement à l’atteinte du but de la Stratégie fédérale de développement durable 2022-2026, à savoir « améliorer l’accès au logement abordable, à l’air pur, aux transports, aux parcs et aux espaces verts, ainsi qu’au patrimoine culturel au Canada » en réduisant les émissions de COV et de benzène (substances dont le risque pour la santé humaine est établi) à l’intérieur et autour des zones habitées. Le projet de règlement contribuerait également à l’atteinte du but de la Stratégie fédérale de développement durable de « prendre des mesures relatives aux changements climatiques et leurs impacts » et de l’Objectif 13, « Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques », du Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies en réduisant les émissions de GES, essentiellement le méthane.
La plupart des répercussions sur la santé humaine du projet sont censées être directes et bénéfiques grâce à une qualité de l’air améliorée. Les éventuels effets indirects sur la santé humaine et les conditions socioéconomiques issus des avantages environnementaux seront probablement modestes, mais bénéfiques également. Aucun effet négatif important sur la santé humaine ou l’environnement n’a été recensé.
Analyse comparative entre les sexes plus
Le présent projet est susceptible de concerner plus de 700 lieux dans l’ensemble des provinces et des territoires (sauf le Nunavut), y compris des lieux situés dans des ports, des zones éloignées et à proximité de populations urbaines. Une analyse préliminaire indique que les travailleurs dans ces lieux, notamment les préposés à l’inspection et à l’entretien ainsi que les personnes qui vivent tout près, seraient visés par le présent projet.
Les pratiques d’entretien et d’inspection pour le présent projet sont bien définies et sont bien alignées sur les pratiques existantes d’inspection et d’entretien de cet équipement. Par conséquent, on ne s’attend pas à ce que le projet nuise aux travailleurs dans ces lieux. Les exploitants et les préposés à l’inspection et à l’entretien pourraient s’attendre à des effets positifs sur la santé du présent projet de l’exposition réduite à des substances cancérogènes, y compris au benzène. Dans l’ensemble, les travailleurs du secteur de l’énergie (y compris les travailleurs des installations touchées) sont principalement des adultes âgés de 24 à 64 ans (91 %), tandis que 24 % sont des femmes et 5,7 % sont des Autochtonesréférence 37.
Plusieurs groupes de population sont particulièrement vulnérables aux effets nocifs de l’exposition à l’ozone troposphérique et aux PM2,5. Parmi ces groupes, les personnes les plus actives à l’extérieur, les enfants, les personnes âgées et les personnes ayant déjà un problème respiratoire ou cardiaque. Des risques sanitaires existent même à de faibles niveaux de concentration d’ozone troposphérique et de PM2,5; le présent projet devrait donc avoir une incidence positive sur ces groupes les plus menacés par des effets négatifs sur la santé de l’ozone troposphérique et des PM2,5.
Le benzène est reconnu comme un agent cancérogène pour les humains. Les effets non cancérigènes de l’exposition au benzène à court terme pourraient constituer un risque accru pour les femmes enceintes et leurs fœtus en développement. Les nourrissons et les enfants risquent d’être plus touchés par les concentrations de benzène en raison des écarts dans les fréquences respiratoires et le poids corporel. Les effets positifs du projet profiteront donc davantage aux femmes enceintes et à leurs fœtus en développement ainsi qu’aux nourrissons et aux enfants en raison d’une réduction de l’exposition au benzène.
Les populations qui vivent à proximité de certains lieux, surtout dans des zones densément peuplées, pourraient s’attendre à des effets positifs sur la santé de l’amélioration de la qualité de l’air associée au présent projet. Ces effets pourraient inclure des répercussions positives pour différents groupes particulièrement vulnérables aux effets néfastes comme les Canadiens à faible revenu, les aînés canadiens, les femmes (dont les femmes enceintes), les enfants et les Autochtones, ainsi que des effets positifs pour les Canadiens en général. Des cas spécifiques où les groupes vulnérables étaient surreprésentés au sein de la population vivant à proximité des sites touchés ont été identifiés au cours de l’élaboration du projet de règlement. Au moment de la publication, aucune analyse n’était disponible pour déterminer si les groupes vulnérables sont surreprésentés dans l’ensemble de la population canadienne vivant à proximité des sites touchés.
Un environnement plus sain lié aux améliorations de la qualité de l’air et à une réduction de l’exposition aux substances toxiques comme le benzène grâce au présent projet contribuerait à protéger les populations vulnérables des effets négatifs sur le plan de l’état de santé de la pollution atmosphérique. Cet environnement réduirait le risque d’effets cumulatifs de certains polluants de l’air sur les populations situées près d’installations visées par le présent projet.
Justification
Les COV sont un polluant précurseur à la formation d’ozone troposphérique et de particules, principaux composants du smog. L’exposition à l’ozone troposphérique et aux particules a des effets nocifs sur la santé humaine. Elle entraîne des résultats négatifs sur le plan respiratoire et cardiaque et augmente le risque de décès prématuré. Des niveaux d’ozone troposphérique plus élevés risquent également de diminuer la productivité des cultures. Les rejets de COV des réservoirs de stockage et des opérations de chargement sont susceptibles de contenir des composés cancérogènes (par exemple du benzène) qui constituent des risques pour les Canadiens près de ces installations. En outre, les effets non cancérigènes de l’exposition à court terme au benzène pourraient constituer un risque accru pour les femmes enceintes et leurs fœtus en développement. Fondée sur des données récentes de surveillance de l’air extérieur ambiant, l’exposition à l’inhalation d’émissions de benzène est particulièrement préoccupante pour les populations dans certains lieux dont les concentrations dans l’air sont élevées.
Le fait de munir les réservoirs de stockage et les rampes de chargement d’équipement de contrôle des émissions atmosphériques conjugué à de solides programmes d’inspection et d’entretien est une pratique exemplaire reconnue de contrôle des rejets de COV par évaporation de ces installations. La plupart sont munies de nombreux réservoirs qui stockent des produits pétroliers liquides volatils dotés de régulateurs de vapeur (par exemple des toits flottants) et certaines installations sont équipées de rampes de chargement dotées de systèmes de contrôle des émissions de vapeurs. Ces régulateurs d’émissions de vapeurs se fondent généralement sur les codes et lignes directrices du CCME à titre volontaire et portent sur la diminution des rejets de COV des réservoirs et du chargement de camions-citernes. Or, d’importants points à améliorer ont été répertoriés et certains réservoirs et bon nombre de rampes de chargement demeurent en activité sans que ces contrôles des émissions de vapeurs soient en vigueur. Qui plus est, même de faibles concentrations d’agents cancérogènes dans les produits pétroliers liquides volatils risquent d’avoir des effets nocifs sur la santé humaine.
Le projet de règlement a été élaboré pour s’attaquer à ces problèmes. Une gamme plus étendue de réservoirs et de rampes de chargement seraient munis de systèmes plus efficaces de récupération des vapeurs qui limitent autant que possible les rejets de COV. Aussi, les exploitants procéderaient à des inspections plus fréquentes des réservoirs à toit flottant. Ces mesures réduiraient encore les rejets de COV, dont ceux de benzène. Les exploitants seraient également tenus d’exploiter des réservoirs de façons précises et de surveiller et de réparer l’équipement de contrôle des émissions atmosphériques dans des délais précis pour limiter autant que possible les rejets de COV.
Le projet de règlement a pour objet de s’aligner, lorsqu’il y a lieu, sur les exigences réglementaires d’autres administrations, y compris celles des provinces et des États-Unis. De plus, le projet de règlement apporterait la certitude réglementaire à l’industrie et aux autres parties intéressées, ce qui créerait une égalisation des conditions de concurrence et les inciterait à planifier et à investir dans l’avenir avec confiance.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Le projet de règlement entrerait en vigueur à la date de son enregistrement. L’adoption du projet de règlement suivrait une approche graduelle, obligeant les installations réglementées à prioriser les équipements dont les émissions sont les plus élevées. Dans les installations réglementées, on serait tenu de rendre conformes chaque année un certain pourcentage des réservoirs de stockage et des rampes de chargement existants. Les réservoirs qui renferment des liquides dont le contenu en benzène est particulièrement élevé (dépasse 20 % selon le poids) seraient assujettis à des délais de mise en œuvre plus courts.
En général, une période d’un à trois ans serait autorisée pour mettre l’équipement en conformité, en fonction de son état antérieur et du risque d’émissions. Dans les cas où une forte proportion des réservoirs ou des rampes de chargement existants nécessitent l’installation d’équipement de contrôle des émissions atmosphériques, une période maximale de sept ans pourrait être autorisée dans le cas des réservoirs et de cinq ans dans le cas des rampes de chargement.
La version finale du Règlement devrait être publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada en 2024référence 38.
Promotion de la conformité
Les activités de promotion de la conformité sont destinées à inciter la communauté réglementée, composée uniquement de grandes entreprises, à obtenir la conformité. Dès la publication du Règlement, et à l’entrée en vigueur des nouvelles exigences dans les années à venir, les activités de promotion de la conformité pourraient inclure ce qui suit :
- affichage de renseignements (par exemple foire aux questions) sur le site Web du ministère;
- envoi d’avis par courriel ou par la poste aux parties intéressées pour faire ressortir les dates limites auxquelles les installations réglementées seraient tenues de prendre certaines mesures (par exemple présentation d’un rapport annuel);
- préparation de conférences téléphoniques ou de webinaires en vue d’examiner les exigences réglementaires et les formulaires de notification auprès des parties intéressées;
- réponse aux demandes de renseignements ou de précisions;
- offre d’un document d’orientation plus détaillé sur la conformité et l’application.
Une fois l’ensemble des exigences en vigueur, les activités de promotion de la conformité se limiteraient peut-être à répondre aux demandes et à en assurer le suivi. Une promotion de la conformité supplémentaire pourrait être exigée lorsque, après une évaluation des activités promotionnelles, la conformité au Règlement est jugée faible.
Application
Le projet de règlement serait conçu en vertu de la LCPE, de sorte que les agents de l’autorité, au moment de vérifier la conformité au Règlement une fois en vigueur, appliqueraient la Politique de conformité et d’application de la LCPEréférence 39. Cette politique établit le train de mesures possibles à prendre en cas d’infractions présumées : avertissements, directions, ordres d’exécution en matière de protection de l’environnement, contraventions, ordres ministériels, injonctions, poursuites pénales et mesures de rechange en matière de protection de l’environnement (lesquelles peuvent remplacer une poursuite pénale, une fois que des accusations ont été portées à la suite d’une infraction présumée à la LCPE). De plus, la Politique explique les situations dans lesquelles le Ministère recourra à des poursuites civiles par la Couronne pour le recouvrement des coûts.
Pour vérifier la conformité, les agents de l’autorité peuvent mener une inspection. Une inspection peut révéler une infraction présumée, qui peut aussi être révélée par le personnel technique du Ministère, ou par des plaintes reçues de la population. Chaque fois qu’une infraction possible à l’un des règlements est constatée, les agents de l’autorité peuvent enquêter.
Lorsque, à l’issue d’une inspection ou d’une enquête, les agents de l’autorité relèvent une infraction présumée, ils se baseront sur les facteurs suivants, la ligne de conduite appropriée :
- La nature de l’infraction présumée : Il convient notamment de déterminer la gravité des dommages, s’il y a eu une action délibérée de la part du contrevenant, s’il s’agit d’une récidive et s’il y a eu tentative de dissimuler de l’information ou de contourner, d’une façon ou d’une autre, les objectifs ou exigences de la LCPE;
- L’efficacité du moyen employé pour obliger le contrevenant présumé à obtempérer : Le but est de faire respecter la LCPE dans les meilleurs délais tout en empêchant les récidives. Il sera tenu compte notamment du dossier du contrevenant pour l’inobservation de la LCPE, de sa volonté de coopérer avec les agents de l’autorité et de la preuve que des correctifs ont été apportés;
- La cohérence : Les agents de l’autorité tiendront compte de ce qui a été fait dans des cas semblables en décidant des mesures à prendre pour faire respecter la LCPE.
Le projet de règlement nécessite également l’apport de modifications simultanées au Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Ce règlement désigne des dispositions dans divers règlements de la LCPE assujettis à un régime d’amendes plus élevées à la suite de poursuites judiciaires fructueuses en cas d’infraction entraînant un préjudice ou un risque de préjudice à l’environnement, ou d’entrave à l’autorité.
Normes de service
Le Ministère, dans son application du projet de règlement, donnerait suite rapidement aux présentations et aux demandes de la part de la communauté réglementée en tenant compte de la complexité et de la complétude de la demande. De plus, le Ministère a l’intention de préparer des fiches de renseignements et/ou un document d’orientation technique pour décrire les renseignements et le mode de présentation nécessaires à suivre pour présenter un plan ou un rapport.
Personnes-ressources
Magda Little
Directrice
Division du pétrole, du gaz et de l’énergie de remplacement
Environnement et Changement climatique Canada
Courriel : covsecteurpetrolier-vocpetroleumsector@ec.gc.ca
Matthew Watkinson
Directeur exécutif
Division de l’analyse réglementaire et de la valuation
Environnement et Changement climatique Canada
Courriel : ravd-darv@ec.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1)référence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b, que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 93(1)référence c, de l’article 286.1référence d et du paragraphe 330(3.2)référence e de cette loi, se propose de prendre le Règlement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (stockage et chargement de liquides pétroliers volatils), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter au ministre de l’Environnement, dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de règlement ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333référence f de la même loi. Ceux qui présentent des observations sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. Ceux qui présentent leurs observations par tout autre moyen, ainsi que ceux qui présentent un avis d’opposition, sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à Magda Little, directrice, Pétrole, gaz et énergie de remplacement, Énergie et transports, Direction générale de la protection de l’environnement, ministère de l’Environnement, 351, boulevard Saint-Joseph, Gatineau (Québec) K1A 0H3 (courriel : covsecteurpetrolier-vocpetroleumsector@ec.gc.ca).
Quiconque fournit des renseignements au ministre peut en même temps présenter une demande de traitement confidentiel aux termes de l’article 313référence g de cette loi.
Ottawa, le 19 février 2024
La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon
TABLE ANALYTIQUE
Règlement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (stockage et chargement de liquides pétroliers volatils)
Définitions et interprétation
1 Définitions
Champ d’application
- 2 Installations non assujetties
- 3 Équipement — application
Dispositions générales
En service
- 4 Réservoirs
- 5 Réservoirs en service intermittent
- 6 Système de contrôle des vapeurs
Désignation
- 7 Réservoirs
- 8 Rampes de chargement
- 9 Processus de désignation
- 10 Réservoirs existants
Identification de l’équipement
11 Identifiant
Volume intérieur du réservoir
12 Volume intérieur
Exigences pour l’échantillonnage et les essais
Propriétés des liquides
- 13 Phases non miscibles
- 14 Essence
Méthodes d’échantillonnage des liquides
- 15 Échantillonnage de pétroles bruts ou autres
- 16 Professionnel qualifié
Méthodes d’essai
- 17 Pression de vapeur réelle
- 18 Concentration de benzène
- 19 Concentration de COV — liquides
- 20 Concentration de COV — vapeur
- 21 Détecteur de gaz combustibles — exigences
- 22 Professionnel qualifié
Méthodes d’essai de rechange
- 23 Demande au ministre
- 24 Rejet de la demande
- 25 Approbation de la demande
- 26 Début de l’utilisation de la méthode
- 27 Publication des méthodes de rechange approuvées
Exigences relatives au contrôle des émissions de COV
Équipement de contrôle des émissions
- 28 Équipement de contrôle des émissions
- 29 Formation requise
Réservoirs
- 30 Équipement de contrôle des émissions
- 31 Système de contrôle des vapeurs
- 32 Réservoir de liquide pétrolier volatil
- 33 Petit réservoir de liquide pétrolier volatil
- 34 Position de l’entrée du liquide
Rampes de chargement
- 35 Systèmes de contrôle des vapeurs
- 36 Position de l’entrée du liquide
Réservoirs de liquide à haute concentration de benzène existants — permis
- 37 Demande de permis
- 38 Conditions de délivrance du permis
- 39 Annulation du permis
Conception et utilisation de l’équipement de contrôle des émissions
Systèmes de contrôle des vapeurs — chargement d’essence — camions
40 Norme
Systèmes de contrôle des vapeurs — exigences générales
- 41 Spécifications de conception
- 42 Conception, utilisation et entretien
- 43 Dispositif de surveillance continue
- 44 Procédures d’utilisation uniformisées
- 45 Fonctionnement de façon continue
- 46 Périodes d’entretien
- 47 Performance — émissions
- 48 Performance — systèmes existants
- 49 Système de contrôle des vapeurs temporaire
- 50 Exempt de fuites
- 51 Raccords compatibles
Toits flottants internes
- 52 Installation
- 53 Flottaison à la surface du liquide
- 54 À flot
- 55 Joints exposés
- 56 Enceinte continue et étanche à la vapeur
- 57 Interstice entre le joint et la paroi du réservoir
- 58 Ouvertures
- 59 Rebords
- 60 Matériaux
Toits flottants externes
- 61 Installation
- 62 Flottaison à la surface du liquide
- 63 À flot
- 64 Joints exposés
- 65 Enceinte continue et étanche à la vapeur
- 66 Interstice entre le joint et la paroi du réservoir
- 67 Ouvertures
- 68 Rebords
- 69 Matériaux
Évents à pression-dépression
- 70 Exigences
- 71 Ventilation
Équipements de contrôle des émissions de substitution
- 72 Demande de permis
- 73 Délivrance
- 74 Conditions du permis
- 75 Renseignements supplémentaires
- 76 Annulation
Exigences : inspection, essais et réparation
Systèmes de contrôle des vapeurs
Inspections et essais
- 77 Inspection — tous les trente jours
- 78 Essais de performance — défectuosités
- 79 Essai de performance — adaptations
- 80 Retour en boucle des vapeurs — essai
- 81 Dossiers
Réparation
82 Réparation — délai
Toits flottants internes et toits flottants externes
Inspection du toit flottant interne
- 83 Tous les trente jours
- 84 Inspection
- 85 Pourcentage LIE de référence
- 86 Inspection — tous les vingt ans
Inspection du toit flottant externe
- 87 Tous les trente jours
- 88 Inspection — tous les ans
- 89 Inspection — tous les cinq ans
- 90 Inspection — tous les vingt ans
- 91 Mesure des interstices de joints
- 92 Certificat d’inspecteur
- 93 Dossiers
Autres exigences
- 94 Intervalles d’inspection réduits
- 95 Rapport au ministre
Inspections sur les réservoirs existants effectuées avant l’entrée en vigueur du présent règlement
- 96 Délais d’inspections
- 97 Défectuosités
Réparation
- 98 Réparation — réservoir hors service
- 99 Réparation — réservoir en service
Plan de réduction des émissions de COV
100 Nettoyage du réservoir ou remplacement d’un joint
Évents à pression-dépression
Inspection
101 Évent à pression-dépression
Réparation
102 Défectuosité détectée
Plan de réparation prolongé
103 Motifs
Inventaire
104 Inventaire
Tenue de dossiers
Dossiers
- 105 Réservoirs
- 106 Rampes de chargement
- 107 Mesures et calculs
- 108 Formation suivie
- 109 Demandes du ministre — dossiers
Conservation
110 Six ans
Enregistrement de l’installation
111 Rapport d’enregistrement
Application différée — réservoirs et rampes de chargements existants
Report
- 112 Toits flottants
- 113 Premier anniversaire — réservoirs existants
- 114 Troisième anniversaire — réservoirs existants
Période supplémentaire
- 115 Désignation
- 116 Quatrième année — réservoirs
- 117 Cinquième année — réservoirs
- 118 Sixième année — réservoirs
- 119 Septième année — réservoirs
- 120 Huitième année — aucun réservoir
- 121 Modification connexe au Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Entrée en vigueur
122 Enregistrement
ANNEXE 1
Conditions de contrôle
1
Procédure
2
ANNEXE 2
Conditions de contrôle
1
Procédure
2
ANNEXE 3
Facteur de chargement total
1
Facteur de chargement journalier total
2
Règlement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (stockage et chargement de liquides pétroliers volatils)
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- ASTM
- L’ASTM International, auparavant connue sous le nom de American Society for Testing and Materials. (ASTM)
- bâtiment occupé
- Structure située à l’extérieur des limites du terrain d’une installation, qui est utilisée comme résidence, lieu de travail, service de garde d’enfants, centre social ou communautaire, ou établissement d’enseignement ou de soins, notamment les maisons mobiles et les bâtiments transportables, à l’exclusion d’autres structures mobiles telles que les tentes, les roulottes ou les bateaux-maisons. (occupied building)
- centre de population
- S’entend au sens qui lui est donné par Statistique Canada dans sa publication intitulée Dictionnaire, Recensement de la population, 2021, qui compte une population de plus de 20 000 habitants. (population centre)
- chargement
- Tout transfert de liquides ayant un potentiel de déplacement des vapeurs du récipient récepteur — notamment le transfert de liquides pétroliers volatils dans des réservoirs de véhicules et des réservoirs à toit fixe — à l’exception du transfert de liquides pétroliers volatils dans des réservoirs à toit flottant ou des pipelines et celui de carburants dans des réservoirs de carburant de véhicules. (loading)
- composé organique volatil ou COV
- Composé participant à des réactions photochimiques atmosphériques qui n’est pas exclu à l’article 60 de la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (volatile organic compound or VOC)
- équipement de contrôle des émissions
- Équipement, y compris les systèmes de contrôle des vapeurs et les toits flottants, utilisé pour limiter les émissions de COV provenant des réservoirs et des rampes de chargement. (emissions control equipment)
- équipement de traitement du pétrole
- Équipement utilisé pour la séparation, la transformation ou la modification physiques ou chimiques du pétrole, notamment les colonnes de distillation, les réacteurs et les cokeurs, à l’exclusion de l’équipement utilisé uniquement pour le stockage, la manipulation ou le mélange du pétrole, comme les pompes, les réservoirs ou les pipelines. (petroleum processing equipment)
- essence
- Selon le cas :
- a) tout combustible vendu ou présenté comme de l’essence;
- b) tout distillat du pétrole, ou tout mélange de distillats du pétrole, de produits oxygénés ou d’additifs, qui convient au fonctionnement d’un moteur à allumage par bougies et qui possède les caractéristiques ci-après, selon la méthode d’essai applicable indiquée dans la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.5-2021, intitulée Essence automobile :
- (i) une pression de vapeur d’au moins 35 kPa,
- (ii) un indice antidétonant d’au moins 80,
- (iii) une température de distillation d’au moins 35 °C et d’au plus 70 °C à laquelle 10 % du carburant s’est évaporé,
- (iv) une température de distillation d’au moins 60 °C et d’au plus 120 °C à laquelle 50 % du carburant s’est évaporé. (gasoline)
- évent pression-dépression
- Dispositif permettant le rejet de gaz dans l’environnement en cas de surpression ou de vide à l’intérieur d’un réservoir à toit fixe. (pressure-vacuum vent)
- exploitant
- S’agissant d’une installation, la personne qui l’exploite, qui en a la charge ou qui en assure la gestion ou le contrôle. (operator)
- facteur de chargement
- Valeur numérique représentant les émissions de COV qui proviennent d’une rampe de chargement. (loading factor)
- fuite de vapeur
- Tout rejet de vapeur, à l’exception des rejets pour lesquels un instrument de surveillance portatif est utilisé pour déterminer que la concentration de COV à la source est inférieure à l’une des concentrations suivantes, selon le cas :
- a) si le rejet est détecté au plus tard le 31 décembre 2026, 10 000 parties par million en volume (ppmv);
- b) si le rejet est détecté après le 31 décembre 2026, 1 000 ppmv. (vapour leak)
- fuite de liquide
- Fuite de trois gouttes de liquide par minute ou plus se formant à la source. (liquid leak)
- installation
- Ensemble de bâtiments, autres structures et équipements fixes qui participent au stockage ou au chargement de liquides pétroliers volatils qui sont situés sur un seul terrain, ou sur plusieurs terrains ayant au moins un exploitant en commun, qui sont reliés par de la tuyauterie et qui se trouvent à une distance de cinq kilomètres, au plus, l’un de l’autre, mesurée entre les limites du terrain. (facility)
- joint primaire
- Joint de rebord, installé le plus près de la surface du liquide sur un toit flottant doté de plus d’un joint de rebord, ou le joint de rebord sur un réservoir qui n’a qu’un seul joint de rebord. (primary seal)
- joint secondaire
- Joint de rebord installé au-dessus du joint primaire sur un toit flottant doté de deux joints de rebord ou plus. (secondary seal)
- limite inférieure d’explosivité ou LIE
- La concentration la plus faible dans l’air d’un gaz ou d’une vapeur combustibles qui peut s’enflammer à une température et à une pression données. (lower explosive limit or LEL)
- liquide
- Tout type de liquide, notamment les liquides pétroliers volatils. (liquid)
- liquide pétrolier volatil
- Tout pétrole ou tout mélange qui en contient qui, à la fois :
- a) est à l’état liquide à une température de 20 °C et à une pression absolue de 101,325 kPa;
- b) contient 10 % ou plus en poids de COV;
- c) a une pression de vapeur réelle supérieure à 10 kPa, ou une pression de vapeur réelle supérieure à 3,5 kPa si la concentration de benzène est supérieure à 2 % en poids. (volatile petroleum liquid)
- m3 normalisé
- Mètre cube de fluide mesuré à une température de 15 °C et à une pression absolue de 101,325 kPa. (standard m3 )
- pétrole
- Tout hydrocarbure naturel tel que le gaz naturel, les condensats de gaz naturel, le pétrole brut ou le bitume, tout dérivé d’hydrocarbure de ces substances, tel que les combustibles, les huiles lubrifiantes, les produits pétrochimiques ou l’asphalte, ainsi que leurs analogues synthétiques ou semi-synthétiques. (petroleum)
- poteau de guidage
- Structure placée dans un réservoir muni d’un toit flottant afin d’empêcher celui-ci de tourner à l’intérieur du réservoir, ou afin de surveiller ou d’échantillonner le liquide qui est à l’intérieur du réservoir. (guide pole)
- pourcentage de la limite inférieure d’explosivité ou pourcentage LIE
- Rapport entre la concentration observée d’un gaz ou d’une vapeur combustibles et la limite inférieure d’explosivité de ce gaz ou de cette vapeur, exprimé en pourcentage. (lower explosive limit percentage or LEL%)
- pression de vapeur réelle ou PVR
- Pression partielle absolue exercée sur les parois closes du récipient qui contient un liquide par les molécules de gaz au-dessus de ce liquide, lorsque le liquide et sa vapeur sont en équilibre. (true vapour pressure or TVP)
- professionnel qualifié
- Scientifique ou technologue qui est spécialisé dans une science ou une technologie appliquées qui sont liées à sa tâche ou sa fonction, dont l’ingénierie, la technologie du génie ou la chimie, et qui est inscrit auprès de l’organisation professionnelle appropriée. (qualified professional)
- rampe de chargement
- Ensemble de l’équipement, de la tuyauterie et de l’appareillage utilisés pour le chargement de liquides pétroliers volatils. (loading rack)
- réservoir
- Réservoir, cuve, conteneur ou récipient utilisés pour contenir des liquides, peu importe leur forme ou matériau de construction. (tank)
- réservoir de liquide à haute concentration de benzène
- Réservoir désigné en application de l’alinéa 7a). (high benzene tank)
- réservoir de véhicule
- Réservoir fixé ou intégré à un véhicule, notamment un réservoir à carburant. (vehicle tank)
- spécifications de conception
- Dossiers et documents relatifs à tout équipement ou instrument qui établissent ses normes de fabrication, de construction, d’utilisation ou d’entretien pour qu’il remplisse sa fonction et atteigne le niveau de performance attendu. Vise notamment les données techniques, les normes, les spécifications sur les matériaux, les spécifications manufacturières, les listes de vérification pour la mise en opération, les fiches de données et les procédures d’emploi. (design specifications)
- système de contrôle des vapeurs
- Tout système qui capte toutes les vapeurs émises par les réservoirs ou lors des activités de chargement et qui empêche leur rejet dans l’environnement, notamment le système de récupération des vapeurs, le système de destruction des vapeurs et le système de retour en boucle des vapeurs. (vapour control system)
- système de destruction des vapeurs
- Système de contrôle des vapeurs qui détruit les vapeurs par combustion, oxydation thermique ou autre. (vapour destruction system)
- système de récupération des vapeurs
- Système de contrôle des vapeurs qui capte les vapeurs en vue de leur emploi. (vapour recovery system)
- système de retour en boucle des vapeurs
- Système de contrôle des vapeurs qui achemine les vapeurs déplacées pendant les activités de chargement du réservoir récepteur au réservoir source et qui empêche leur rejet dans l’environnement. (vapour balancing system)
- toit fixe
- Toit fixé de façon permanente sur un réservoir. (fixed roof)
- toit flottant
- Structure flottant à la surface d’un liquide, et supportée par ce liquide, et visant à limiter les pertes de vapeur de ce liquide dans l’environnement. (floating roof)
- toit flottant externe
- Toit flottant installé dans un réservoir sans toit fixe de sorte que la surface supérieure de ce toit flottant est exposée aux conditions atmosphériques. (external floating roof)
- toit flottant interne
- Toit flottant qui est installé dans un réservoir muni d’un toit fixe, de sorte que la surface supérieure du toit flottant est protégée contre les conditions atmosphériques. (internal floating roof)
- vapeur
- Tout type de vapeur ou de gaz contenant des COV, notamment les vapeurs provenant de liquides pétroliers volatils. (vapour)
- véhicule
- Machine conçue pour être mobile, notamment les camions, les wagons porte-rails, les navires, les barges de transport ou les remorques, mais non conçue — ni modifiée — pour servir de dispositif stationnaire permanent de stockage de liquides. (vehicle)
Incorporation par renvoi
(2) Dans le présent règlement, tout renvoi à un document s’entend de ce document compte tenu de ses modifications successives.
Dispositions incompatibles
(3) Les dispositions du présent règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles de tout document qui y est incorporé par renvoi.
Champ d’application
Installations non assujetties
2 (1) Le présent règlement ne s’applique pas aux installations suivantes :
- a) les installations où les liquides pétroliers sont stockés ou chargés exclusivement aux fins de vente au détail de carburant à l’installation;
- b) les installations de pétrole et de gaz en amont, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont), à l’exception des installations suivantes :
- (i) les installations qui séparent les liquides de gaz naturel en leurs diverses composantes ou en fractions,
- (ii) les installations d’exploitation de sables bitumineux, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques,
- (iii) les installations où le pétrole brut ou le condensat sont reçus par pipeline, camion, wagon porte-rails ou navire, stocké dans des réservoirs, puis distribué par pipeline, camion, wagon porte-rails ou navire, à l’exclusion des installations qui reçoivent directement de l’effluent extrait de puits dans le but de séparer et de mesurer les liquides pétroliers tels que le pétrole brut et le condensat;
- c) les installations en mer situées à plus de cinq kilomètres du rivage;
- d) les installations situées sur un terrain dont les limites se trouvent à plus de cent kilomètres de tout centre de population, si elles satisfont aux conditions suivantes :
- (i) les rampes de chargement à l’installation ne chargent pas de liquides pétroliers volatils dont la concentration de benzène est supérieure à 1 % en poids,
- (ii) la somme des volumes intérieurs des réservoirs utilisés à l’installation utilisés pour stocker des liquides pétroliers volatils est inférieure à 5 000 m3,
- (iii) le volume total des liquides pétroliers volatils chargés à l’installation ne dépasse pas 30 000 m3 normalisés au cours d’une année civile,
- (iv) le volume total des liquides pétroliers volatils chargés à l’installation ne dépasse pas 2 000 m3 normalisés au cours d’une journée;
- e) les installations où chaque réservoir qui stocke des liquides pétroliers volatils et où chaque rampe de chargement qui charge des liquides pétroliers volatils sont situés à plus de trois cents mètres de tout bâtiment occupé, si elles satisfont aux conditions suivantes :
- (i) les réservoirs à l’installation ne stockent pas et les rampes de chargement à l’installation ne chargent pas de liquides pétroliers volatils dont la PVR dépasse 76 kPa ou dont la concentration de benzène est supérieure à 1 % en poids,
- (ii) la somme des volumes intérieurs des réservoirs utilisés à l’installation pour stocker des liquides pétroliers volatils est inférieure à 2 000 m3,
- (iii) le volume total des liquides pétroliers volatils chargés à l’installation ne dépasse pas 25 000 m3 normalisés au cours d’une année civile,
- (iv) le volume total des liquides pétroliers volatils chargés à l’installation ne dépasse pas 500 m3 normalisés au cours d’une journée;
- f) les installations qui satisfont aux conditions suivantes :
- (i) les réservoirs à l’installation de stockent pas et les rampes de chargement à l’installation ne chargent pas de liquides pétroliers volatils dont la PVR dépasse 76 kPa ou dont la concentration de benzène est supérieure à 1 % en poids,
- (ii) la somme des volumes intérieurs des réservoirs utilisés à l’installation pour stocker des liquides pétroliers volatils est inférieure à 500 m3,
- (iii) le volume total des liquides pétroliers volatils chargés à l’installation ne dépasse pas 1 000 m3 normalisés au cours d’une année civile;
- g) les installations qui utilisent uniquement les réservoirs et les rampes de chargement visés aux alinéas 3(1)a) à c) et uniquement les récipients visés au paragraphe 3(2).
Installations de valorisation — application
(2) Il est entendu que le présent règlement s’applique aux installations qui valorisent au moyen de procédés liés à la distillation du pétrole brut ou du bitume, ou de mélanges de pétrole brut ou de bitume avec d’autres composés d’hydrocarbures.
Distance des bâtiments occupés
(3) Pour l’application du présent règlement, la distance entre un réservoir ou une rampe de chargement et un bâtiment occupé est la distance minimale entre tout point situé sur le périmètre du réservoir ou de la rampe de chargement et tout point situé sur le périmètre du bâtiment.
Équipement — application
3 (1) Le présent règlement s’applique à tous les réservoirs et à toutes les rampes de chargement d’une installation, sauf :
- a) aux réservoirs dont le volume intérieur est inférieur à 4 m3;
- b) aux réservoirs de véhicules;
- c) aux réservoirs et aux rampes de chargement assujettis au Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) et munis d’un système de contrôle des vapeurs qui satisfait aux exigences de ce règlement.
Récipients sous pression
(2) Le présent règlement ne s’applique pas aux récipients sous pression qui fonctionnent sans rejet dans l’environnement dans des conditions normales de fonctionnement, y compris pendant le remplissage et la vidange du récipient et lors de changements aux conditions ambiantes.
Dispositions générales
En service
Réservoirs
4 (1) Un réservoir est considéré comme étant en service à compter du jour où il contient un liquide pétrolier volatil pour la première fois.
Ne contient pas
(2) Malgré le paragraphe (1), un réservoir est considéré comme ne pas contenir de liquide pétrolier volatil si, selon le cas :
- a) il a été nettoyé de façon à éliminer un liquide volatil pétrolier, de la vapeur, ainsi que toute boue et toute matière pétrolière solide, et que la valeur du pourcentage LIE à l’intérieur du réservoir est inférieure à 10 sans ventilation mécanique;
- b) un liquide autre qu’un liquide pétrolier volatil a été introduit dans le réservoir et que, à la fois :
- (i) l’échantillonnage du liquide à l’intérieur du réservoir indique qu’il ne s’agit pas d’un liquide pétrolier volatil,
- (ii) la valeur du pourcentage LIE à l’intérieur du réservoir est inférieure à 10 sans ventilation mécanique.
Réservoirs hors service
(3) Un réservoir est considéré comme étant hors service lorsqu’il ne contient pas de liquide pétrolier volatil.
Réservoirs en service intermittent
5 (1) L’exploitant peut désigner au plus trois réservoirs comme réservoirs en service intermittent — à une même installation — si ces réservoirs sont en service pendant moins de trois cents heures au total par année civile et si ces réservoirs appartiennent à l’une des catégories visées aux alinéas 7c) ou d).
Variations des propriétés
(2) Si les propriétés du liquide contenu dans un réservoir varient de sorte qu’il est considéré, à certains moments, comme étant un liquide pétrolier volatil, une analyse statistique ou technique doit être effectuée pour démontrer qu’il est prévu que ce réservoir soit en service pendant moins de trois cents heures par année civile avant de le désigner réservoir à service intermittent.
Non assujetti aux exigences
(3) Les réservoirs désignés réservoirs en service intermittent ne sont pas assujettis aux exigences sur le contrôle des émissions prévues aux articles 32 et 33.
Avis au ministre — trente jours
(4) L’exploitant avise le ministre au moins trente jours avant la date à laquelle il désigne un réservoir comme réservoir à service intermittent, sauf si la désignation a été effectuée dans l’année suivant la date de l’entrée en vigueur du présent règlement, auquel cas aucun avis n’est nécessaire aux termes du présent paragraphe.
Système de contrôle des vapeurs
6 Un système de contrôle des vapeurs est considéré comme étant en service à compter du jour où il est utilisé à l’installation pour la première fois.
Désignation
Réservoirs
7 L’exploitant désigne chaque réservoir qui est en service à l’installation selon l’une des catégories suivantes :
- a) réservoir de liquide à haute concentration de benzène, auquel cas le réservoir peut contenir tout liquide pétrolier volatil;
- b) réservoir de liquide très volatil, auquel cas le réservoir peut contenir un liquide pétrolier volatil seulement si la concentration de benzène de ce liquide ne dépasse pas 20 % en poids;
- c) réservoir de liquide pétrolier volatil, auquel cas le réservoir peut contenir un liquide pétrolier volatil, seulement si la PVR de ce liquide ne dépasse pas 76 kPa et la concentration de benzène de ce liquide ne dépasse pas 20 % en poids;
- d) petit réservoir de liquide pétrolier volatil, auquel cas le réservoir doit satisfaire aux conditions suivantes :
- (i) doit avoir a un volume intérieur inférieur à 100 m3 et, si le réservoir a une forme cylindrique verticale qui permet l’installation d’un toit flottant, un diamètre intérieur est inférieur à 5 m,
- (ii) peut contenir un liquide pétrolier volatil seulement si la PVR de ce liquide ne dépasse pas 76 kPa et la concentration de benzène de ce liquide ne dépasse pas 20 % en poids.
Rampes de chargement
8 (1) L’exploitant désigne chaque rampe de chargement qui sert à charger des liquides pétroliers volatils à l’installation selon l’une des catégories suivantes :
- a) rampe de chargement de liquide à haute concentration de benzène, auquel cas la rampe de chargement peut servir à charger tout liquide pétrolier volatil;
- b) rampe de chargement de liquide pétrolier volatil, auquel cas la rampe de chargement peut servir à charger un liquide pétrolier volatil seulement si la concentration de benzène de ce liquide ne dépasse pas 20 % en poids;
- c) rampe de chargement à faible débit, auquel cas la rampe de chargement peut servir à charger un liquide pétrolier volatil seulement si la concentration de benzène de ce liquide ne dépasse pas 20 % en poids et si les conditions ci-après sont réunies :
- (i) la rampe, et tout réservoir à toit fixe qui reçoit des liquides pétroliers volatils à partir d’elle, sont situés à plus de trois cents mètres de tout bâtiment occupé, et leurs facteurs de chargement sont les suivants :
- (A) le facteur de chargement total à l’installation, calculé conformément à la méthode prévue à l’article 1 de l’annexe 3, ne dépasse pas 1,
- (B) le facteur de chargement journalier total à l’installation, calculé conformément à la méthode prévue à l’article 2 de l’annexe 3, ne dépasse pas 1,
- (ii) la rampe est située à plus de cent kilomètres d’un centre de population et à plus de deux kilomètres de tout bâtiment occupé, et ses facteurs de chargement sont les suivants :
- (A) le facteur de chargement total, calculé conformément à la méthode prévue à l’article 1 de l’annexe 3 ne dépasse pas 2,
- (B) le facteur de chargement journalier total à l’installation, calculé conformément à la méthode prévue à l’article 2 de l’annexe 3 ne dépasse pas 2.
- (i) la rampe, et tout réservoir à toit fixe qui reçoit des liquides pétroliers volatils à partir d’elle, sont situés à plus de trois cents mètres de tout bâtiment occupé, et leurs facteurs de chargement sont les suivants :
Rampes de chargement à faible débit
(2) Une rampe de chargement désignée rampe de chargement à faible débit en application de l’alinéa (1)c) n’est pas assujettie aux exigences sur le contrôle des émissions prévues à l’article 35.
Processus de désignation
9 L’exploitant attribue une désignation aux réservoirs ou aux rampes de chargement en mettant à jour l’inventaire établi conformément à l’article 104 et en indiquant la catégorie auquel il appartient dans les dossiers tenus conformément aux articles 105 et 106.
Réservoirs existants
10 (1) Les réservoirs qui sont en service avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, et qui sont désignés en application de l’article 7 dans un délai d’un an suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, sont considérés comme étant des réservoirs existants.
Rampes de chargement existantes
(2) Les rampes de chargement qui servent à charger des liquides pétroliers volatils avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, et qui sont désignées en application du paragraphe 8(1) dans un délai d’un an suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, sont considérées comme étant des rampes de chargement existantes.
Systèmes de contrôle des vapeurs existants
(3) Le système de contrôle des vapeurs qui est en service à l’installation avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement est considéré comme étant un système de contrôle des vapeurs existant.
Identification de l’équipement
Identifiant
11 (1) L’exploitant veille à ce qu’un identifiant soit attribué à chaque réservoir, à chaque rampe de chargement et à chaque système de contrôle des vapeurs à son installation.
Marquage de l’équipement
(2) L’identifiant est marqué sur le réservoir, la rampe de chargement ou le système de contrôle des vapeurs ou indiqué sur un plan du site de manière à ce que chaque réservoir, chaque rampe de chargement et chaque système de contrôle des vapeurs puisse être identifié à tout moment.
Dossiers, demandes, avis, rapports
(3) L’identifiant est inclus dans tout dossier tenu relativement aux réservoirs, aux rampes de chargement ou aux systèmes de contrôle des vapeurs, ainsi que dans toute demande présentée à leur égard, dans tout avis fourni et dans tout rapport transmis au ministre conformément au présent règlement.
Volume intérieur du réservoir
Volume intérieur
12 (1) Le volume intérieur d’un réservoir est la somme du volume de tous les espaces internes du réservoir pouvant être occupés par un liquide pétrolier volatil.
Espaces scellés
(2) Le volume des espaces qui ont été scellés pour empêcher la pénétration de vapeur ou de liquide, notamment l’espace au-dessus d’un toit flottant interne, n’est pas inclus dans le calcul du volume intérieur du réservoir.
Réservoirs reliés
(3) Deux réservoirs ou plus reliés par un espace commun ou une tuyauterie commune, dans lesquels de la vapeur ou du liquide peuvent circuler et qui ne sont pas maintenus fermés ou isolés dans des conditions normales de fonctionnement, sont considérés comme étant un seul réservoir ayant un volume intérieur égal à la somme du volume intérieur des réservoirs et de celui de l’espace commun ou du volume intérieur de la tuyauterie commune.
Réservoir divisé en compartiments distincts
(4) Si un compartiment d’un réservoir est scellé pour prévenir la pénétration de vapeur ou de liquide d’un autre endroit dans le réservoir, ce compartiment est considéré comme un réservoir distinct avec un volume intérieur distinct.
Toit flottant ou volume intérieur variable
(5) Le volume intérieur d’un réservoir muni d’un toit flottant interne, ou dont le volume intérieur est variable, est calculé au niveau nominal de remplissage de liquide le plus élevé du réservoir.
Exigences pour l’échantillonnage et les essais
Propriétés des liquides
Phases non miscibles
13 (1) Pour l’application du présent règlement, la concentration de COV, la PVR ou la concentration de benzène de liquides ayant plusieurs phases non miscibles est la valeur la plus élevée de la concentration de COV, de la PVR ou de la concentration benzène d’une seule phase non miscible de ces liquides.
Échantillons
(2) S’il est impossible de déterminer l’une ou l’autre de ces valeurs, l’un ou l’autre des échantillons ci-après est utilisé :
- a) si une phase non miscible n’est pas en quantité suffisante pour former une couche distincte d’une autre phase plus abondante, un échantillon bien mélangé des deux phases;
- b) si une phase non miscible forme une émulsion stable dans une autre phase et qu’il est impossible d’obtenir un échantillon de la phase pure, un échantillon de l’émulsion.
Essence
14 Pour l’application du présent règlement, toute essence est considérée comme ayant une concentration de 100 % en poids de COV, une PVR de 65 kPa et une concentration de benzène de 1 % en poids.
Méthodes d’échantillonnage des liquides
Échantillonnage de pétroles bruts ou autres
15 (1) L’échantillonnage de pétroles bruts, de condensats de gaz naturel et d’autres hydrocarbures naturels et l’échantillonnage d’autres liquides qui contiennent ou qui sont soupçonnés de contenir des composants d’hydrocarbures qui forment un gaz ou de la vapeur dans des conditions ambiantes est effectué selon la méthode établie dans la norme ASTM D3700–21, intitulée Standard Practice for Obtaining LPG Samples Using a Floating Piston Cylinder.
Pression insuffisante
(2) Malgré le paragraphe (1), si la pression au point d’échantillonnage est insuffisante pour permettre le prélèvement des échantillons, l’échantillonnage est effectué selon la méthode établie dans la norme ASTM D8009–22, intitulée Standard Practice for Manual Piston Cylinder Sampling for Volatile Crude Oils, Condensates, and Liquid Petroleum Products.
Liquide trop visqueux
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), si le liquide est trop visqueux pour permettre l’utilisation de l’une ou l’autre des méthodes prévues à ces paragraphes, l’échantillonnage est effectué selon la méthode établie dans la norme ASTM D4057–22, intitulée Standard Practice for Manual Sampling of Petroleum and Petroleum Products.
Autres liquides
(4) L’échantillonnage d’autres liquides que ceux visés au paragraphe (1) est effectué selon l’une ou l’autre des méthodes prévues aux paragraphes (1) à (3).
Contenants d’échantillons
(5) Le contenant de tout échantillon doit demeurer scellé après le prélèvement et ne peut être ouvert qu’aux fins d’essais conformément à la méthode d’essai applicable.
Professionnel qualifié
16 Tout échantillonnage doit être effectué par un professionnel qualifié ayant suivi une formation relative à l’exécution de cette fonction et portant sur les exigences pertinentes du présent règlement, au plus douze mois avant d’effectuer un échantillonnage pour la première fois.
Méthodes d’essai
Pression de vapeur réelle
17 (1) La PVR des liquides est déterminée selon l’une ou l’autre des méthodes d’essai suivantes :
- a) la méthode ASTM D2879–18, intitulée Standard Test Method for Vapor Pressure-Temperature Relationship and Initial Decomposition Temperature of Liquids by Isoteniscope;
- b) la méthode ASTM D6377–20, intitulée Standard Test Method for Determination of Vapor Pressure of Crude Oil : VPCRx (Expansion Method).
Rapport vapeur-liquide
(2) Le rapport vapeur-liquide de 0,1 est utilisé pour déterminer la PVR selon la méthode visée à l’alinéa (1)b).
Température
(3) Les températures ci-après sont utilisées aux fins de détermination de la PVR selon l’une des méthodes d’essai visées au paragraphe (1) :
- a) si le liquide est stocké ou chargé à température ambiante, 20 °C;
- b) si le liquide est chauffé ou refroidi artificiellement, la température moyenne mensuelle de fonctionnement la plus élevée observée au cours des douze mois précédents.
Concentration de benzène
18 La concentration de benzène des liquides est déterminée selon l’une ou l’autre des méthodes d’essai suivantes :
- a) la méthode ASTM D3606–21, intitulée Standard Test Method for Determination of Benzene and Tolu-ene in Spark Ignition Fuels by Gas Chromatography;
- b) la méthode ASTM D4367–02, intitulée Standard Test Method for Benzene in Hydrocarbon Solvents by Gas Chromatography;
- c) la méthode ASTM D5134–21, intitulée Standard Test Method for Detailed Analysis of Petroleum Naphthas through n-Nonane by Capillary Gas Chromatography;
- d) la méthode ASTM D5580–21, intitulée Standard Test Method for Determination of Benzene, Toluene, Ethylbenzene, p/m-Xylene, o-Xylene, C9 and Heavier Aromatics, and Total Aromatics in Finished Gasoline by Gas Chromatography;
- e) la méthode ASTM D5769–22, intitulée Standard Test Method for Determination of Benzene, Toluene, and Total Aromatics in Finished Gasoline by Gas Chromatography/Mass Spectrometry;
- f) la méthode ASTM D6229–06, intitulée Standard Test Method for Trace Benzene in Hydrocarbon Solvents by Capillary Gas Chromatography;
- g) la méthode ASTM D7504–21, intitulée Standard Test Method for Trace Impurities in Monocyclic Aromatic Hydrocarbons by Gas Chromatography and Effective Carbon Number;
- h) la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.0 no 14.3-2022, intitulée Méthodes d’essai des produits pétroliers et produits connexes : méthode normalisée d’identification des constituants de l’essence automobile par chromatographie en phase gazeuse.
Concentration de COV — liquides
19 La concentration de COV des liquides est déterminée selon l’une ou l’autre des méthodes d’essai suivantes :
- a) la méthode établie dans la norme ASTM E169–16, intitulée Standard Practices for General Techniques of Ultraviolet-Visible Quantitative Analysis;
- b) la méthode établie dans la norme ASTM E260–96, intitulée Standard Practice for Packed Column Gas Chromatography.
Concentration de COV — vapeur
20 (1) Tout instrument utilisé pour déterminer la présence de COV sous forme de gaz ou de vapeur, y compris aux fins de détection de fuites de vapeur, doit être de l’un des types suivants :
- a) un instrument de surveillance portatif qui répond aux exigences du paragraphe 5(1) du Règlement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (secteur pétrolier);
- b) un instrument optique de visualisation des gaz qui répond aux exigences des paragraphes 5(2) et 5(3) de ce règlement;
- c) un détecteur de gaz combustible utilisant un capteur à billes catalytiques qui répond aux exigences prévues à l’article 21 du présent règlement.
Instrument — pourcentage LIE
(2) L’instrument utilisé pour déterminer le pourcentage LIE doit être du type visé aux alinéas (1)a) ou c).
Instrument — gaz ou vapeur
(3) L’instrument utilisé pour déterminer si une émission de gaz ou de vapeur constitue une fuite de vapeur doit être du type visé à l’alinéa (1)a).
Concentration de COV équivalente
(4) Si le pourcentage LIE est calculé à partir d’une mesure obtenue avec un instrument de surveillance portatif produisant un résultat en unités de concentration volumique, une concentration de COV de 140 ppmv en volume est considérée comme correspondant à un pourcentage LIE de 1.
Dossiers
(5) L’exploitant tient, pour chaque instrument à l’installation, les dossiers contenant les renseignements ci-après et tout document à l’appui :
- a) les spécifications de conception de l’instrument;
- b) les résultats de tous les étalonnages ou essais effectués sur l’instrument, la date à laquelle ils ont été effectués et le nom de la personne qui les a effectués.
Détecteur de gaz combustibles — exigences
21 (1) Le détecteur de gaz combustible qui utilise un capteur à billes catalytiques doit satisfaire aux exigences suivantes :
- a) il doit être étalonné chaque jour avant l’emploi, conformément à ses spécifications de conception, avec un gaz d’étalonnage et, si nécessaire, avec des facteurs de correction des résultats, le gaz et les facteurs étant adaptés à la composition prévue du gaz ou de la vapeur;
- b) il doit produire un résultat directement en pourcentage LIE;
- c) il doit avoir une plage de sortie qui s’étend au moins de 1 à 100 % de LIE;
- d) il doit avoir une exactitude de sortie de plus ou moins 5 % de la lecture ou de plus ou moins 2 % de LIE, la valeur de la lecture la plus élevée étant retenue, lorsqu’il est utilisé avec la composition prévue du gaz ou de la vapeur.
Détecteur de gaz combustibles — milieux
(2) Le détecteur de gaz combustible qui utilise un capteur à billes catalytiques ne doit pas être utilisé dans les milieux suivants :
- a) une atmosphère contenant moins de 10 % d’oxygène en volume;
- b) une atmosphère contenant des substances susceptibles d’empoisonner le catalyseur;
- c) tout autre milieu dans lequel, selon les spécifications de conception du détecteur, il pourrait ne pas fournir un résultat exact.
Professionnel qualifié
22 Tout essai de liquides ou de vapeurs doit être effectué par un professionnel qualifié ayant suivi une formation relative à l’exécution de cette fonction et portant sur les exigences pertinentes du présent règlement, au plus douze mois avant d’effectuer un essai pour la première fois.
Méthodes d’essai de rechange
Demande au ministre
23 (1) L’exploitant peut présenter une demande au ministre afin d’utiliser une méthode d’essai de rechange que celles exigées aux articles 17 à 19 pour, selon le cas :
- a) tester une substance dont les propriétés n’entrent pas dans le champ d’application des méthodes d’essai prévues;
- b) réaliser des essais automatisés ou continus qui ne peuvent être réalisés par les méthodes d’essai prévues;
- c) obtenir une exactitude ou une précision supérieures à l’une des méthodes d’essai prévues.
Conditions — méthode d’essai de rechange
(2) La méthode d’essai de rechange doit satisfaire aux conditions suivantes :
- a) elle mesure les mêmes propriétés physiques que celles que mesure l’une ou l’autre des méthodes d’essai exigées aux articles 17 à 19;
- b) elle est équivalente ou supérieure, notamment en ce qui concerne sa précision et son exactitude, dans tous les cas où elle serait utilisée, à celles des méthodes d’essai exigées aux articles 17 à 19.
Délai
(3) La demande est présentée au moins soixante jours avant la date d’utilisation prévue de la méthode d’essai de rechange.
Renseignements
(4) La demande contient les renseignements suivants :
- a) les fins auxquelles l’exploitant souhaite utiliser une méthode d’essai de rechange au titre du paragraphe (1);
- b) la preuve que les conditions visées au para-graphe (2) ont été remplies;
- c) le nom et la description de la méthode d’essai de rechange;
- d) une description des situations où la méthode d’essai de rechange serait utilisée, y compris toute limite ou restriction sur le moment de l’utilisation.
Équivalence de la méthode
(5) Pour l’application de l’alinéa (4)b), l’exploitant évalue l’équivalence de la méthode d’essai de rechange avec les méthodes d’essai exigées aux articles 17 à 19, conformément à l’une des deux méthodes d’essai suivantes :
- a) la méthode établie dans la norme ASTM D3764–23, intitulée Standard Practice for Validation of the Performance of Process Stream Analyzer Systems;
- b) la méthode établie dans la norme ASTM D6708–21, intitulée Standard Practice for Statistical Assessment and Improvement of Expected Agreement Between Two Test Methods that Purport to Measure the Same Property of a Material.
Rejet de la demande
24 Si le ministre détermine que la méthode d’essai de rechange n’est pas équivalente aux méthodes d’essai exigées aux articles 17 à 19, il rejette la demande et en avise l’exploitant par écrit.
Approbation de la demande
25 Si le ministre détermine que la méthode d’essai de rechange est équivalente aux méthodes d’essai exigées aux articles 17 à 19, il peut approuver la demande. Il avise l’exploitant de sa décision par écrit.
Début de l’utilisation de la méthode
26 L’exploitant peut commencer à utiliser la méthode d’essai de rechange dès réception de l’avis d’approbation du ministre.
Publication des méthodes de rechange approuvées
27 (1) Le ministre peut publier une liste des méthodes d’essai de rechange approuvées, y compris les situations qui justifient leur utilisation.
Utilisation de la méthode de rechange approuvée
(2) L’exploitant peut utiliser l’une des méthodes d’essai de rechange approuvées et qui figure dans la liste publiée visée au paragraphe (1). Dans ce cas, il tient des dossiers et tout document à l’appui démontrant qu’il satisfait aux conditions d’utilisation de la méthode d’essai de rechange approuvée.
Exigences relatives au contrôle des émissions de COV
Équipement de contrôle des émissions
Équipement de contrôle des émissions
28 (1) L’exploitant veille à ce que les réservoirs désignés en application de l’article 7 et les rampes de chargement désignées en application du paragraphe 8(1), à l’installation, soient munis d’un équipement de contrôle des émissions, conformément aux exigences prévues aux articles 31 à 36, selon le cas.
Conformité
(2) L’exploitant veille à ce que l’équipement de contrôle des émissions soit conforme aux exigences en matière de conception et d’utilisation prévues aux articles 40 à 71 et aux exigences en matière d’inspection, d’essais et de réparation prévues aux articles 77 à 103, selon le cas.
Formation requise
29 L’exploitant veille à ce que l’équipement de contrôle des émissions soit utilisé, entretenu, inspecté ou réparé que par une personne ayant, au plus douze mois avant d’utiliser, d’entretenir, d’inspecter ou de réparer l’équipement, suivi une formation relative :
- a) à l’utilisation, à l’entretien et à l’étalonnage de l’équipement de contrôle des émissions et, le cas échéant, des instruments de détection des fuites, et ce, en toute sécurité;
- b) aux exigences applicables du présent règlement.
Réservoirs
Équipement de contrôle des émissions
30 L’exploitant veille à ce que tout réservoir à l’installation soit conçu, utilisé et entretenu d’une manière qui permet l’utilisation efficace de l’équipement de contrôle des émissions installé sur ce réservoir.
Système de contrôle des vapeurs
31 Sous réserve de l’article 37, l’exploitant veille à ce que chaque réservoir de liquide à haute concentration de benzène et chaque réservoir désigné réservoir de liquide très volatil en application de l’alinéa 7b) à l’installation soient munis d’un système de contrôle des vapeurs.
Réservoir de liquide pétrolier volatil
32 L’exploitant veille à ce que chaque réservoir désigné réservoir de liquide pétrolier volatil en application de l’alinéa 7c) à l’installation soit muni d’au moins un des équipements de contrôle des émissions suivants :
- a) un système de contrôle des vapeurs;
- b) un toit flottant interne;
- c) un toit flottant externe.
Petit réservoir de liquide pétrolier volatil
33 L’exploitant veille à ce que chaque réservoir désigné petit réservoir de liquide pétrolier volatil en application de l’alinéa 7d) à l’installation soit muni d’au moins un des équipements de contrôle des émissions suivants :
- a) un système de contrôle des vapeurs;
- b) un toit flottant interne;
- c) un toit flottant externe;
- d) un évent à pression-dépression.
Position de l’entrée du liquide
34 L’entrée du liquide du réservoir doit être positionnée de telle sorte que le liquide n’entre pas dans le réservoir à plus de 15 cm au-dessus du fond du réservoir, sauf si l’une ou l’autre des situations suivantes s’applique :
- a) le réservoir est muni d’un système de contrôle des vapeurs;
- b) le niveau de liquide dans le réservoir reste toujours au-dessus de l’entrée pendant son fonctionnement normale;
- c) le réservoir est un réservoir existant.
Rampes de chargement
Systèmes de contrôle des vapeurs
35 L’exploitant veille à ce que chaque rampe de chargement désignée rampe de chargement de liquide à haute concentration de benzène et rampe de chargement de liquide pétrolier volatil en application des alinéas 8(1)a) et b), soient munies des systèmes de contrôle des vapeurs suivants :
- a) s’agissant d’une rampe de chargement à une installation où le carburant est stocké soit dans des réservoirs à toit fixe dont le diamètre individuel est inférieur à cinq mètres et dont le volume est inférieur à 100 m3, soit dans des réservoirs souterrains de toute grandeur, d’un système de récupération des vapeurs, d’un système de destruction des vapeurs ou d’un système de retour en boucle des vapeurs;
- b) s’agissant d’une rampe de chargement d’essence utilisée pour les camions à une installation où plus de 250 000 m3 normalisés d’essence sont chargés par an, qui n’était pas déjà munie d’un système de destruction des vapeurs à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, d’un système de récupération des vapeurs;
- c) dans tous les autres cas, d’un système de récupération des vapeurs ou d’un système de destruction des vapeurs.
Position de l’entrée du liquide
36 L’entrée du liquide du réservoir d’un véhicule recevant des liquides pétroliers à partir d’une rampe de chargement est positionnée de telle sorte que le liquide n’entre pas dans le réservoir à plus de 15 cm au-dessus du fond du réservoir.
Réservoirs de liquide à haute concentration de benzène existants — permis
Demande de permis
37 (1) L’exploitant peut présenter au ministre une demande de permis l’autorisant à utiliser, à son installation, un toit flottant interne plutôt qu’un système de contrôle des vapeurs afin de contrôler les émissions de COV provenant de tout réservoir de liquide à haute concentration de benzène existant qui satisfait, au moment de la demande, aux critères suivants :
- a) le réservoir est situé à plus de trois cents mètres de tout bâtiment occupé;
- b) il est muni d’un toit flottant interne qui a été installé avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement;
- c) il est muni d’un toit flottant interne qui est conforme aux exigences prévues aux articles 52 à 60 et qui ne présente pas l’une ou l’autre des défectuosités visées aux paragraphes 99(5) et (6).
Délai
(2) La demande de permis est présentée au plus tard cent quatre-vingts jours après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Conditions — programme de surveillance du périmètre
(3) L’exploitant ne peut présenter une demande de permis que si, au moment de la demande, il avait établi et mis en œuvre à son installation l’un ou l’autre des programmes de surveillance du périmètre suivants :
- a) un programme régulier de surveillance du périmètre, conformément au Règlement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (secteur pétrolier);
- b) un programme modifié de surveillance du périmètre, conformément à ce règlement;
- c) un programme de rechange de surveillance du périmètre, conformément au même règlement;
- d) un programme de surveillance du périmètre, conformément à l’article 60 de la Petrochemical — Industry Standard, publiée en application du règlement de l’Ontario 419/05, intitulé Air Pollution – Local Air Quality;
- e) un programme de surveillance du périmètre conforme à toutes les exigences des méthodes publiées par l’Environmental Protection Agency des États-Unies intitulées Method 325A — Volatile Organic Compounds from Fugitive and Area Sources : Sampler Deployment and VOC Sample Collection, à l’exception de la période d’échantillonnage qui peut être comprise entre treize et quinze jours, et à un autre document intitulé Method 325B — Volatile Organic Compounds from Fugitive and Area Sources : Sampler Preparation and Analysis, les échantillons devant tous être analysés pour le benzène.
Renseignements
(4) La demande de permis contient les renseignements suivants :
- a) l’identifiant unique de chaque réservoir de liquide à haute concentration de benzène existant à l’installation que l’exploitant a l’intention d’inclure dans le permis ainsi que ceux de tous les réservoirs de liquide à haute concentration de benzène existants à l’installation;
- b) une copie des dossiers tenus conformément à l’article 105 pour chaque réservoir de liquide à haute concentration de benzène existant à l’installation;
- c) une carte ou un plan du site indiquant l’emplacement exact des réservoirs de liquide à haute concentration de benzène existants à l’installation;
- d) une description, avec indication des dates et des lieux, de tout événement susceptible d’avoir eu une incidence importante sur les niveaux de benzène ambiants à l’installation, ou à proximité de celle-ci, au cours des vingt-quatre derniers mois, y compris de toute modification aux procédés d’exploitation ou aux mesures de contrôle des émissions et de tout rejet accidentel;
- e) une description, avec indication des dates et des lieux, de tout événement susceptible de se produire au cours des douze prochains mois qui pourrait avoir une incidence importante sur les niveaux de benzène ambiants futurs à l’installation, ou à proximité de celle-ci, y compris de toute modification prévue aux procédés d’exploitation ou aux mesures de contrôle des émissions;
- f) une description du programme de surveillance du périmètre établi et mis en œuvre en application du paragraphe (3), notamment :
- (i) le type de programme établi, parmi ceux visés aux alinéas (3)a) à e),
- (ii) l’analyse utilisée pour sélectionner le périmètre, notamment la méthode utilisée, les éléments pris en considération et les calculs effectués, le cas échéant,
- (iii) le nombre de tubes d’échantillonnage et leur emplacement sur le périmètre ainsi qu’une description de l’analyse utilisée pour déterminer ce nombre et ces emplacements, notamment la méthode suivie, les éléments pris en compte et les calculs effectués, le cas échéant,
- (iv) un diagramme de l’installation comportant les limites du terrain, le périmètre, les emplacements d’échantillonnage, l’équipement de traitement du pétrole, les réservoirs, les rampes de chargement et les zones de traitement des eaux usées;
- g) toutes les données de surveillance du programme de surveillance du périmètre établi et mis en œuvre en application du paragraphe (3), notamment la concentration de benzène pour chaque période d’échantillonnage à chaque emplacement d’échantillonnage, ainsi que la concentration de benzène dans chaque blanc de terrain et chaque double échantillon, couvrant l’une ou l’autre des périodes suivantes :
- (i) si l’installation met en œuvre un programme de surveillance du périmètre depuis au moins trente-huit mois avant la date de la présentation de la demande, une période continue de trente-six mois se terminant au plus tôt soixante jours avant la date de la présentation de la demande,
- (ii) si l’installation met en œuvre un programme de surveillance du périmètre depuis moins de trente-huit mois avant la date de la présentation de la demande, une période continue débutant à la première date à laquelle les données sont disponibles mais au plus tard soixante jours après la date d’entrée en vigueur du présent règlement et se terminant au plus tôt soixante jours avant la date de la présentation de la demande.
Conditions de délivrance du permis
38 (1) Le ministre peut délivrer un permis si, à chaque emplacement d’échantillonnage du programme de surveillance du périmètre, les conditions suivantes sont réunies :
- a) les concentrations de benzène mesurées au cours d’au moins vingt-quatre des vingt-six périodes d’échantillonnage les plus récentes étaient inférieures aux valeurs suivantes :
- (i) si la période d’échantillonnage prend fin avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou pendant la première année de son entrée en vigueur, 19 µg/m3,
- (ii) si la période d’échantillonnage prend fin pendant la deuxième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, 17 µg/m3,
- (iii) si la période d’échantillonnage prend fin pendant la troisième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, 15 µg/m3,
- (iv) si la période d’échantillonnage prend fin pendant la quatrième année suivant la date d’entrée en vigueur ou durant toute année subséquente, 13 µg/m3;
- b) la moyenne arithmétique des concentrations de benzène qui ont été mesurées pendant les vingt-six périodes d’échantillonnage les plus récentes était inférieure aux valeurs suivantes :
- (i) si la période d’échantillonnage la plus récente prend fin avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou pendant la première année de son entrée en vigueur, 6,5 µg/m3,
- (ii) si la période d’échantillonnage la plus récente prend fin pendant la deuxième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, 5,5 µg/m3,
- (iii) si la période d’échantillonnage la plus récente prend fin pendant la troisième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, 4,5 µg/m3,
- (iv) si la période d’échantillonnage la plus récente prend fin pendant la quatrième année suivant la date d’entrée en vigueur ou durant toute année subséquente, 3,5 µg/m3.
Permis
(2) Le permis délivré énonce sa période de validité et indique quels réservoirs de liquide à haute concentration de benzène existants à l’installation peuvent être munis d’un toit flottant interne au lieu d’un système de contrôle des vapeurs pour contrôler les émissions de COV.
Avis — aucun permis délivré
(3) Si les conditions de délivrance du permis prévues au paragraphe (1) ne sont pas remplies, le ministre ne le délivre pas, en informe par écrit l’exploitant et donne à celui-ci la possibilité de présenter des observations écrites au sujet du refus.
Validité du permis — mise à jour des renseignements
(4) Aux fins de la validité du permis, le titulaire du permis fournit au ministre les renseignements suivants :
- a) annuellement, dans un délai de trente jours suivant la date d’anniversaire de la date de prise d’effet du permis :
- (i) une mise à jour des renseignements visés aux alinéas 37(4)a) à f),
- (ii) une mise à jour des données sur la surveillance du périmètre visées à l’alinéa 37(4)g) pour y inclure les données disponibles les plus récentes;
- b) dans un délai de trente jours suivant la date de réception par le titulaire de données établissant que les conditions visées au paragraphe (1) ne sont plus réunies, une mise à jour des données sur la surveillance du périmètre visées à l’alinéa 37(4)g) pour y inclure les données disponibles les plus récentes;
- c) dans un délai de trente jours suivant la date d’une inspection, les résultats de toute inspection effectuée sur un réservoir visé par le permis où une défectuosité visée aux paragraphes 99(5) ou (6) a été détectée.
Annulation du permis
39 (1) Le ministre annule le permis si les conditions de délivrance prévues au paragraphe 38(1) ne sont plus remplies.
Modification du permis
(2) Le ministre peut modifier le permis afin d’en exclure un réservoir si celui-ci ne remplit plus les critères prévus au paragraphe 37(1).
Émissions de benzène
(3) Le ministre peut annuler le permis ou le modifier de manière à exclure un réservoir s’il détermine que cela réduira les émissions de benzène à l’installation.
Utilisation après l’annulation ou la modification
(4) Le ministre peut permettre au titulaire du permis de continuer d’utiliser un toit flottant interne plutôt qu’un système de contrôle des vapeurs, après l’annulation ou la modification du permis, pendant les périodes suivantes :
- a) si l’annulation ou la modification concerne au plus deux réservoirs, une période d’au plus un an;
- b) si l’annulation ou la modification concerne trois réservoirs ou plus, une période d’au plus six mois multiplié par le nombre de réservoirs.
Système de contrôle des vapeurs temporaire
(5) Le ministre peut permettre au titulaire du permis de continuer d’utiliser un toit flottant interne plutôt qu’un système de contrôle des vapeurs si ce dernier installe sur le réservoir, avant la date indiquée par le ministre, un système de contrôle des vapeurs temporaire visé au paragraphe 49(1).
Rejet de benzène non lié aux réservoirs
(6) Malgré les paragraphes (1) et 38(3), le ministre peut délivrer un permis, ou en préserver la validité, si le ministre détermine que le non-respect des conditions prévues au paragraphe 38(1) s’explique au rejet de benzène à l’installation, qui n’est pas lié aux réservoirs de liquide à haute concentration de benzène existants à l’installation ou au rejet de benzène à l’extérieur de l’installation.
Avis d’annulation ou de modification
(7) Le ministre avise par écrit le titulaire du permis de toute annulation ou de toute modification du permis au moins trente jours avant la date à laquelle elle prend effet, indique les motifs de l’annulation ou de la modification, et lui donne la possibilité de présenter des observations écrites à cet égard.
Conception et utilisation de l’équipement de contrôle des émissions
Systèmes de contrôle des vapeurs — chargement d’essence — camions
Norme
40 L’exploitant veille à ce que les exigences de la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.1000-2019, intitulée Systèmes de récupération des vapeurs dans les réseaux de distribution d’essence, à l’exception de celles relatives à la tenue de documents et aux rapports, soient respectées lorsqu’un système de contrôle des vapeurs est utilisé à l’installation pour contrôler les émissions de COV de camions chargeant de l’essence.
Systèmes de contrôle des vapeurs — exigences générales
Spécifications de conception
41 L’exploitant veille à ce que chaque système de contrôle des vapeurs à l’installation soit installé, utilisé et entretenu conformément à ses spécifications de conception.
Conception, utilisation et entretien
42 S’agissant d’un système de récupération des vapeurs ou d’un système de destruction des vapeurs, l’exploitant veille à ce que le système soit conçu, utilisé et entretenu pour :
- a) collecter toutes les vapeurs rejetées par le réservoir ou la rampe de chargement, ainsi que par tout réservoir d’un véhicule recevant des liquides pétroliers volatils de la rampe de chargement;
- b) capter ou détruire les COV, conformément aux exigences de performance prévues à l’article 48, dans toutes les vapeurs collectées pour toute la gamme de débits de vapeur à l’entrée et de concentrations de COV;
- c) réduire au minimum l’accumulation des liquides dans la tuyauterie de vapeur.
Dispositif de surveillance continue
43 (1) L’exploitant veille à ce que le système de récupération des vapeurs ou le système de destruction des vapeurs soit muni d’un dispositif de surveillance continue, considéré comme faisant partie du système de contrôle des vapeurs, lequel :
- a) produit une mesure exacte de la capture ou la destruction des COV, en mesurant soit directement la concentration de COV dans les gaz d’échappement, soit d’autres paramètres physiques tels que la température de la chambre de combustion;
- b) signale l’exploitant lorsque la capture ou la destruction des COV ne satisfait pas aux exigences de performance prévues à l’article 48;
- c) fonctionne en tout temps lorsque le système de contrôle des vapeurs est en service.
Mesure exacte
(2) Une mesure générée par le dispositif de surveillance continue est considérée comme étant exacte dans les cas suivants :
- a) si le dispositif mesure la concentration de COV, il le fait avec une précision de plus ou moins 5 % de la pleine échelle;
- b) si le dispositif mesure la température, il le fait avec une précision de plus ou moins 2 °C.
Procédures d’utilisation uniformisées
44 L’exploitant conserve, par écrit, des procédures d’utilisation uniformisées pour chaque système de contrôle des vapeurs, lesquelles :
- a) sont mises à la disposition, à l’installation, de toute personne qui utilise ou entretient le système;
- b) contiennent tous les renseignements nécessaires pour utiliser et entretenir le système conformément aux exigences du présent règlement.
Fonctionnement de façon continue
45 (1) L’exploitant veille à ce que le système de contrôle des vapeurs fonctionne de façon continue lorsque le réservoir est en service ou lorsque la rampe de chargement est utilisée pour charger des liquides pétroliers volatils.
Entretien ou réparation
(2) Malgré le paragraphe (1), le fonctionnement du système de contrôle des vapeurs peut être interrompu pour une période d’entretien ou de réparation qui ne dure que 5 % des périodes, dans une année civile, où le réservoir est en service ou des périodes où la rampe de chargement est utilisée pour charger des liquides pétroliers volatils.
Rapport au ministre
(3) Si la période d’entretien ou de réparation est d’une durée continue de plus de vingt-quatre heures et qu’il est nécessaire d’utiliser le réservoir ou la rampe de chargement pendant cette période, l’exploitant transmet un rapport au ministre contenant les renseignements ci-après, dans les cinq jours suivant la date du début de l’activité d’entretien ou de réparation :
- a) une description du système de contrôle des vapeurs, y compris son identifiant;
- b) une description de l’activité d’entretien ou de réparation;
- c) la période prévue durant laquelle le système de contrôle des vapeurs ne sera pas en fonction;
- d) une description des mesures qui seront prises pour réduire les émissions de COV durant cette période.
Mise à jour du rapport
(4) L’exploitant met à jour le rapport dans les cinq jours suivant la date à laquelle l’entretien ou la réparation sont terminés et le système de contrôle des vapeurs fonctionne normalement.
Périodes d’entretien
46 Lorsqu’une période d’entretien du système de contrôle des vapeurs n’a pas été initiée en raison d’une défaillance inattendue du système et que le système n’est pas en fonction, les émissions de COV sont contrôlées, selon le cas :
- a) s’agissant d’un réservoir, par un système de contrôle des vapeurs temporaire;
- b) s’agissant d’une rampe de chargement, de l’une ou l’autre des manières suivantes :
- (i) par un système de contrôle des vapeurs temporaire,
- (ii) en limitant les chargements de manière à ce que le facteur de chargement journalier total à l’installation, calculé conformément à la méthode prévue à l’article 2 de l’annexe 3, soit inférieur à un par jour ou, si l’installation ne charge pas de liquides pétroliers volatils ayant une concentration de benzène supérieure à 1 % en poids, de manière à ce que le débit total de liquides pétroliers volatils soit inférieur à 500 m3 normalisés par jour.
Performance — émissions
47 (1) À tout moment durant son fonctionnement, le système de récupération des vapeurs ou le système de destruction des vapeurs ne doivent pas émettre plus de 10 g de COV par mètre cube de vapeur évacuée ou plus de 10 g de COV par m3 normalisé de liquide pétrolier volatil chargé et les exigences suivantes doivent être respectées :
- a) s’ils sont thermiques, le gaz à l’intérieur doit être maintenu à une température d’au moins 760 °C pendant un temps de séjour d’au moins 0,75 seconde;
- b) s’ils sont catalytiques, le gaz à l’intérieur doit être maintenu à une température d’au moins 400 °C;
- c) dans le cas du système de destruction des vapeurs, l’intensité des émissions d’oxydes d’azote (NOx) ne doit pas dépasser 50 g de NOx par gigajoule (GJ) de COV totaux et de combustible d’appoint fourni à la torche, quantifiés sur la base d’un pouvoir calorifique supérieur.
Exception — concentration de benzène
(2) Malgré le paragraphe (1), si la concentration de benzène du liquide pétrolier volatil est égale ou supérieure à 20 % en poids, le système de récupération des vapeurs ou le système de destruction des vapeurs ne doivent pas émettre plus de 10 mg de COV par mètre cube de vapeur évacuée ou plus de 10 mg de COV par m3 normalisé de liquide pétrolier volatil chargé.
Performance — systèmes existants
48 (1) Malgré le paragraphe 47(1), à tout moment durant son fonctionnement, le système de récupération des vapeurs ou le système de destruction des vapeurs existants ne doivent pas émettre plus de 35 g de COV par mètre cube de vapeur évacuée ou plus de 35 mg de COV par m3 normalisé de liquide pétrolier volatil chargé et les exigences suivantes doivent être respectées :
- a) s’ils sont thermiques, le gaz à l’intérieur doit être maintenu à une température d’au moins 760 °C pendant un temps de séjour d’au moins 0,75 seconde;
- b) s’ils sont catalytiques, le gaz à l’intérieur doit être maintenu à une température d’au moins 400 °C.
Exception — concentration de benzène
(2) Malgré le paragraphe (1), si la concentration de benzène du liquide pétrolier volatil est égale ou supérieure à 20 % en poids, le système de récupération des vapeurs ou le système de destruction des vapeurs existants ne doivent pas émettre plus de 50 mg de COV par mètre cube de vapeur évacuée ou plus de 50 mg de COV par m3 normalisé de liquide pétrolier volatil chargé.
Système de contrôle des vapeurs temporaire
49 (1) L’exploitant peut utiliser un système de contrôle des vapeurs temporaire pour un réservoir ou une rampe de chargement à l’installation pendant une période d’au plus cent trente-cinq jours ou pendant l’une des périodes applicables prévues au paragraphe 39(4).
Exigences
(2) Le système de contrôle des vapeurs temporaire doit être un système de récupération des vapeurs ou un système de destruction des vapeurs et satisfaire aux exigences de performance d’un système existant prévues à l’article 48 et à toutes les autres exigences d’un système de contrôle des vapeurs prévues au présent règlement.
Exception — ouvertures
(3) Malgré le paragraphe (2), le paragraphe 50(2) ne s’applique pas à un système de contrôle des vapeurs temporaire qui est rattaché à un réservoir muni d’un toit flottant interne.
Exempt de fuites
50 (1) L’exploitant veille à ce que le système de contrôle des vapeurs soit exempt de fuites de vapeur ou de fuites de liquides à tout moment durant son fonctionnement.
Scellé pendant le fonctionnement
(2) Les trappes d’entretien ou autres ouvertures des tuyaux, des réservoirs, des réservoirs de véhicules ou d’autres équipements qui sont reliés à l’espace vapeur doivent demeurer scellées pendant le fonctionnement du système de contrôle des vapeurs, sauf durant l’entretien, l’inspection ou la réparation des réservoirs.
Raccords compatibles
51 (1) Avant le chargement de liquides pétroliers volatils dans un réservoir de véhicule, l’exploitant veille à ce que le réservoir du véhicule soit muni de raccords d’interconnexion compatibles à ceux du système de contrôle des vapeurs utilisé lors du chargement.
Réservoirs de véhicules exempts de fuites
(2) Avant le chargement de liquides pétroliers volatils dans un réservoir de véhicule, l’exploitant veille à ce que l’exploitant du véhicule fournisse une preuve que le réservoir du véhicule est exempt de fuites de vapeur, conformément aux normes applicables, et, s’agissant d’un camion, que son réservoir a fait l’objet de l’essai annuel conformément à l’article 5.3.1 de la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.1000-2019, intitulée Systèmes de récupération des vapeurs dans les réseaux de distribution d’essence.
Toits flottants internes
Installation
52 Le toit flottant interne et ses composants — notamment les joints et les raccords — doivent être installés conformément à leurs spécifications de conception.
Flottaison à la surface du liquide
53 (1) Le toit flottant interne doit en tout temps flotter sur la surface du liquide et suivre librement les variations du niveau du liquide.
Au plus trente jours
(2) Malgré le paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (3), le toit flottant interne peut reposer sur une structure de support ou un système de suspension pendant au plus trente jours par année civile.
Plus de trente jours
(3) Le toit flottant interne peut reposer sur une structure de support ou un système de suspension pendant plus de trente jours par année civile si le diamètre du réservoir est de dix mètres ou moins et s’il est utilisé après un procédé discontinu ou semi-discontinu pour retenir temporairement du liquide à des fins de contrôle de la qualité ou d’essai.
À flot
54 (1) Le toit flottant interne à compartiments de flottaisons multiples doit pouvoir rester à flot sur la surface du liquide de l’une ou l’autre des manières suivantes :
- a) si le diamètre du toit est inférieur ou égal à six mètres, par un flotteur ou un compartiment perforé et inondé de liquide;
- b) si le toit est de type flotteur à simple pont et que son diamètre est supérieur à six mètres, par le pont et deux flotteurs adjacents perforés et inondés de liquide;
- c) si le toit est de type double pont et que son diamètre est supérieur à six mètres, par deux compartiments adjacents perforés et inondés de liquide.
Double de son poids mort
(2) Le toit flottant interne doit être en mesure de soutenir au moins le double de son poids mort, lequel comprend le poids de tous les composants du toit, ainsi que la force exercée par les joints pendant le remplissage d’un réservoir.
Joints exposés
55 Tous les joints du toit flottant interne exposés à la vapeur ou au liquide doivent posséder les qualités suivantes :
- a) être exempts de fuites de vapeur et de fuites de liquides;
- b) avoir une durée utile prévue égale à la durée utile prévue du toit.
Enceinte continue et étanche à la vapeur
56 (1) Le toit flottant interne doit être muni d’un joint de rebord qui forme une enceinte continue et étanche à la vapeur sur tout le périmètre du toit flottant, sauf là où il est en contact avec la paroi du réservoir, auquel cas il doit être conforme aux exigences sur les interstices de joints prévus au paragraphe 57(2).
Joints de rebord — types
(2) Les configurations suivantes de joints de rebord sont permises :
- a) un joint primaire et un ou plusieurs joints secondaires, de tout type;
- b) un seul joint primaire de l’un des types suivants :
- (i) un joint de mousse ou un joint rempli de liquide qui reste en contact permanent avec la surface du liquide,
- (ii) un joint mécanique à sabot constitué d’une feuille de métal incurvée conçue pour être en contact continu avec la paroi du réservoir sur une distance d’au moins 10 cm au-dessus et au-dessous de la surface du liquide et mesurant au moins 30 cm de hauteur.
Interstice entre le joint et la paroi du réservoir
57 (1) Tout espace entre le joint de rebord du toit flottant interne et la paroi du réservoir où une sonde cylindrique uniforme de 0,3 cm de diamètre peut passer librement est considéré comme étant un interstice de joints, lequel est mesuré conformément aux conditions de contrôle et à la procédure prévues à l’annexe 1.
Dimensions
(2) Tout interstice de joint doit être inférieur aux dimensions suivantes :
- a) 4 cm en tout point, jusqu’à un total cumulé de 200 cm2 par mètre de diamètre du réservoir, si le joint de rebord est un joint primaire;
- b) 1,3 cm en tout point, jusqu’à un total cumulé de 20 cm2 par mètre de diamètre du réservoir, si le joint de rebord est un joint secondaire.
Plus d’un joint secondaire
(3) Si le toit flottant interne est muni de plus d’un joint secondaire, un seul de ceux-ci doit satisfaire aux exigences sur les dimensions prévues àl’alinéa (2)b).
Ouvertures
58 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), toutes les ouvertures du pont du toit flottant interne doivent être scellées en tout temps de façon à ce qu’elles soient exemptes de fuites de vapeur et de fuites de liquides.
Ouvertures — composante mobile
(2) Les ouvertures du pont du toit flottant interne qui permettent à une composante du réservoir de suivre les changements du niveau du liquide dans le réservoir doivent être munies de l’un des dispositifs suivants :
- a) d’un manchon flexible qui forme une enceinte autour de la composante;
- b) d’un joint d’étanchéité qui est en contact avec tout le périmètre de la composante et, lorsqu’un espace à l’intérieur de la composante permet le passage de la vapeur, d’un flotteur interne.
Exceptions
(3) Les ouvertures peuvent être descellées lorsque cela est nécessaire pour éviter une pression ou un vide excessifs dans le réservoir ou pour son entretien, son inspection ou sa réparation.
Rebords
59 Le toit flottant interne doit être muni de rebords, à la périphérie du toit et autour de toutes ses ouvertures, qui sont exempts de fuites de vapeur et de fuites de liquides et qui respectent les conditions suivantes :
- a) s’étendre au moins 15 cm au-dessus du liquide, sauf pour les rebords autour des drains;
- b) s’étendre au moins 10 cm au-dessous du liquide, sauf pour les rebords autour des évents ou des brise-vides.
Matériaux
60 Les composants du toit flottant interne doivent être faits de matériaux qui possèdent les caractéristiques suivantes :
- a) ils sont imperméables aux vapeurs;
- b) ils sont compatibles chimiquement avec le liquide dans l’environnement opérationnel, de sorte qu’ils ne subissent pas de dommages qui réduisent l’efficacité en matière de contrôle des émissions du composant pendant sa durée de vie prévue;
- c) ils sont compatibles physiquement avec les conditions météorologiques à l’installation, de sorte qu’ils ne subissent pas de dommages qui réduisent l’efficacité en matière de contrôle des émissions du composant pendant sa durée de vie prévue.
Toits flottants externes
Installation
61 Le toit flottant externe et ses composants — notamment les joints et les raccords — doivent être installés conformément à leurs spécifications de conception.
Flottaison à la surface du liquide
62 (1) Le toit flottant externe doit en tout temps flotter sur la surface du liquide et suivre librement les variations du niveau du liquide.
Au plus trente jours
(2) Malgré le paragraphe (1), le toit flottant externe peut reposer sur une structure de support ou un système de suspension pendant au plus trente jours par année civile.
À flot
63 (1) Le toit flottant externe doit être de type flotteur à simple pont ou de type double pont et doit pouvoir rester à flot sur la surface du liquide dans les circonstances suivantes :
- a) si le diamètre du toit est inférieur ou égal à six mètres, par un flotteur ou un compartiment perforé et inondé de liquide;
- b) si le toit est de type flotteur à simple pont et que son diamètre est supérieur à six mètres, par le pont et deux flotteurs adjacents perforés et inondés de liquide;
- c) si le toit est de type double pont et que son diamètre est supérieur à six mètres, par deux compartiments adjacents perforés et inondés de liquide.
Pluie
(2) Le toit flottant externe doit pouvoir rester à flot sur la surface du liquide après avoir reçu, sur la surface du pont, vingt-cinq centimètres de pluie en vingt-quatre heures, les drains primaires étant désactivés, sauf si le toit est de type double pont muni de drains d’urgence conçus pour réduire l’accumulation d’eau sur le toit à un volume que le toit peut supporter de façon sécuritaire.
Joints exposés
64 Tous les joints du toit flottant externe exposés à la vapeur ou au liquide doivent posséder les qualités suivantes :
- a) être exempts de fuites de vapeur et de fuites de liquides;
- b) avoir une durée de vie prévue égale à la durée de vie du toit.
Enceinte continue et étanche à la vapeur
65 (1) Le toit flottant externe doit être muni d’un joint primaire et d’un joint secondaire qui forment une enceinte continue et étanche à la vapeur sur tout le périmètre du toit flottant, sauf là où il est en contact avec la paroi du réservoir, auquel cas ils doivent être conformes aux exigences sur les interstices de joints prévus au paragraphe 66(2).
Joints primaires — types
(2) Les joints primaires doivent être de l’un des types suivants :
- a) un joint de mousse ou un joint rempli de liquide qui reste en contact permanent avec la surface du liquide;
- b) un joint mécanique à sabot constitué d’une feuille de métal incurvée conçue pour être en contact continu avec la paroi du réservoir sur une distance d’au moins soixante centimètres au-dessus de la surface du liquide et d’au moins dix centimètres au-dessous de la surface du liquide.
Joints secondaires — types
(3) Le joint secondaire doit être du type qui peut être monté sur le rebord du toit flottant externe.
Pas considérée comme un joint secondaire
(4) Une structure périphérique qui recouvre un joint primaire ou un joint secondaire dans le but principal de le protéger de la pluie, de la neige ou des rayons ultraviolets n’est pas considérée comme étant un joint secondaire.
Interstice entre le joint et la paroi du réservoir
66 (1) Tout espace entre le joint de rebord du toit flottant externe et la paroi du réservoir est considéré comme étant un interstice de joints, lequel est mesuré conformément aux conditions de contrôle et à la procédure prévues à l’annexe 1.
Dimensions
(2) L’interstice de joints doit être inférieur aux dimensions suivantes :
- a) si le joint de rebord est un joint primaire, 4 cm en tout point, jusqu’à un total cumulé de 200 cm2 par mètre de diamètre du réservoir;
- b) si le joint de rebord est un joint secondaire, 1,3 cm en tout point, jusqu’à un total cumulé de 20 cm2 par mètre de diamètre du réservoir.
Plus d’un joint secondaire
(3) Si le toit flottant externe est muni de plus d’un joint secondaire, un seul de ceux-ci doit satisfaire aux exigences sur les dimensions prévues à l’alinéa (2)b).
Ouvertures
67 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), toutes les ouvertures du pont du toit flottant externe doivent être scellées en tout temps de façon à ce qu’elles soient exemptes de fuites de vapeur et de fuites de liquides.
Drain d’urgence
(2) Une ouverture dans le pont du toit flottant externe qui sert de drain d’urgence doit être munie d’un couvercle qui forme un enceinte autour d’au moins 90 % de la superficie de l’ouverture.
Ouvertures — composante mobile
(3) Les ouvertures du pont du toit flottant externe qui permettent à une composante du réservoir de suivre les changements du niveau du liquide dans le réservoir doivent être munies de l’un des dispositifs suivants :
- a) d’un manchon flexible qui forme une enceinte autour de la composante;
- b) d’un joint d’étanchéité qui est en contact avec tout le périmètre de la composante et, lorsqu’un espace à l’intérieur de la composante permet le passage de la vapeur, d’un flotteur interne.
Exceptions
(4) Les ouvertures peuvent être descellées lorsque cela est nécessaire pour éviter une pression ou un vide excessifs dans le réservoir ou pour son entretien, son inspection ou sa réparation.
Rebords
68 Le toit flottant externe doit être muni de rebords, à la périphérie du toit et autour de toutes ses ouvertures, qui sont exempts de fuites de vapeur et de fuites de liquides et qui s’étendent au moins 10 cm au-dessous du liquide, sauf pour les rebords autour des évents ou des brise-vides.
Matériaux
69 Les composants du toit flottant externe doivent être faits de matériaux qui possèdent les caractéristiques suivantes :
- a) ils sont imperméables aux vapeurs;
- b) ils sont compatibles chimiquement avec le liquide dans l’environnement opérationnel, de sorte qu’ils ne subissent pas de dommages qui réduisent l’efficacité en matière de contrôle des émissions du composant pendant sa durée de vie prévue;
- c) ils sont compatibles physiquement avec les conditions météorologiques à l’installation, de sorte qu’ils ne subissent pas de dommages qui réduisent l’efficacité en matière de contrôle des émissions du composant pendant sa durée de vie prévue.
Évents à pression-dépression
Exigences
70 L’évent à pression-dépression doit respecter les exigences suivantes :
- a) il doit se fermer et former un scellé exempt de fuites de vapeur et de fuites de liquides lorsqu’il n’y a pas de différence de pression entre l’intérieur du réservoir et le milieu extérieur;
- b) les réglages de décharge de la pression et du vide doivent être réglés à la pression de calcul et de vide du réservoir;
- c) il doit être installé, utilisé et calibré conformément à ses spécifications de conception.
Ventilation
71 Le réservoir ne peut être ouvert au milieu extérieur que par l’évent à pression-dépression, sauf pendant l’échantillonnage, pendant l’entretien, l’inspection ou la réparation du réservoir ou lorsque le réservoir est hors service.
Équipements de contrôle des émissions de substitution
Demande de permis
72 (1) L’exploitant peut présenter au ministre une demande de permis d’utilisation d’un autre type d’équipement de contrôle des émissions pour substituer à celui visé à l’un ou l’autre des articles 31 à 33 et 35.
Substitutions prohibées
(2) Toutefois, la demande de permis ne peut être présentée à l’égard des substitutions suivantes :
- a) celle d’un toit flottant interne ou d’un toit flottant externe à un système de contrôle des vapeurs;
- b) celle d’un évent à pression dépression à un toit flottant interne, un toit flottant externe ou un système de contrôle des vapeurs.
Renseignements
(3) La demande de permis contient les renseignements suivants :
- a) une description technique, y compris la conception schématique, de l’équipement de substitution;
- b) une description des circonstances dans lesquelles l’équipement de substitution serait utilisé, notamment :
- (i) l’adresse municipale, le nom, le cas échéant, et les coordonnées géographiques de l’installation dans laquelle l’équipement serait utilisé,
- (ii) l’identifiant et les spécifications de conception du réservoir auquel l’équipement se substituerait,
- (iii) l’identifiant, les spécifications de conception et le débit, pour l’année civile précédente, de la rampe de chargement à laquelle l’équipement se substituerait,
- (iv) les types de liquides pétroliers volatils qui pourraient être stockés dans le réservoir auquel l’équipement se substituerait,
- (v) les types de liquides pétroliers volatils qui pourraient être chargés avec la rampe de chargement à laquelle l’équipement se substituerait;
- c) une description technique des procédures et des pratiques d’entretien ou d’inspection qui seraient utilisées pour assurer l’efficacité de l’équipement de substitution en matière de contrôle des émissions, notamment leur fréquence et les critères ou paramètres objectifs qui seraient utilisés lors d’une inspection;
- d) une analyse démontrant que l’équipement de substitution contrôle les émissions de COV de manière aussi efficace que celle de l’équipement substitué visé à l’un ou l’autres des articles 31 à 33 et 35, selon le cas, et ce dans toutes les situations où l’équipement de substitution serait utilisé, appuyée de l’une ou l’autre des manières suivantes :
- (i) les résultats d’un essai relatifs aux émissions effectué avec l’équipement de substitution sur des réservoirs pleine grandeur ou des rampes de chargement pleine grandeur, ou sur des modèles réduits, dans le cadre duquel les émissions de COV sont mesurées dans des conditions environnementales et d’exploitation qui sont représentatives de celles dans lesquelles l’équipement de contrôle de substitution serait utilisé,
- (ii) une preuve démontrant que l’équipement de contrôle des émissions de substitution peut fonctionner en étant exempt de fuites de vapeur et de fuites de liquides et qu’il peut contenir entièrement les émissions de COV à la source dans des conditions normales de fonctionnement;
- e) une description de l’analyse exigée à l’alinéa d), y compris les méthodes d’essai expérimentales et leurs résultats, les données de surveillance ou de mesure à l’appui de l’analyse et les calculs.
Plusieurs installations
(4) Une demande peut porter sur plusieurs installations d’un même exploitant.
Précisions
(5) À la réception de la demande, le ministre peut exiger toute précision dont il a besoin pour l’étudier.
Avis de modification des renseignements
(6) L’exploitant avise le ministre par écrit de toute modification apportée aux renseignements fournis en application du présent article dans les cinq jours suivant la date où il est informé de la modification.
Délivrance
73 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut délivrer le permis visé au paragraphe 72(1) s’il détermine que l’exploitant a établi que l’analyse visée à l’alinéa 72(3)d) démontre que l’équipement de contrôle des émissions de substitution est aussi efficace pour contrôler les émissions de COV que l’équipement substitué, et ce, dans tous les cas où il pourrait être utilisé.
Refus
(2) Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants :
- a) il a des motifs raisonnables de croire que l’exploitant a fourni des renseignements faux ou trompeurs à l’appui de sa demande;
- b) les renseignements exigés aux termes du paragraphe 72(3) n’ont pas été fournis ou sont insuffisants pour lui permettre d’étudier la demande.
Avis de refus
(3) Si le ministre refuse de délivrer le permis, il avise par écrit l’exploitant du refus et lui donne la possibilité de présenter des observations écrites à cet égard.
Conditions du permis
74 Le ministre peut préciser dans le permis les conditions suivantes :
- a) les exigences sur la conception et l’utilisation de l’équipement de contrôle des émissions de substitution;
- b) les circonstances dans lesquelles l’équipement de substitution peut être utilisé;
- c) les exigences sur les procédures et les pratiques d’entretien, d’inspection et de réparation de l’équipement de substitution;
- d) les exigences sur la tenue de dossiers;
- e) toute autre exigence que le ministre estime nécessaire pour l’application du présent règlement.
Renseignements supplémentaires
75 Le ministre peut exiger tout renseignement supplémentaire dont il a besoin pour déterminer si les conditions visées à l’article 74 ont été remplies ou pour évaluer l’efficacité de l’équipement de contrôle des émissions de substitution.
Annulation
76 (1) Le ministre annule le permis délivré au titre du paragraphe 73(1) s’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence de l’une ou l’autre des situations suivantes :
- a) les conditions du permis visées à l’article 74 ne sont pas remplies;
- b) l’équipement de contrôle des émissions de substitution n’est pas en mesure de contrôler les émissions de COV de manière aussi efficace que l’équipement substitué;
- c) l’exploitant lui a fourni des renseignements faux ou trompeurs;
- d) l’exploitant ne s’est pas conformé aux autres exigences du présent règlement.
Avis d’annulation
(2) Avant d’annuler le permis, le ministre avise par écrit l’exploitant des motifs de l’annulation et lui donne la possibilité de présenter des observations écrites à cet égard.
Exigences : inspection, essais et réparation
Systèmes de contrôle des vapeurs
Inspections et essais
Inspection — tous les trente jours
77 (1) L’exploitant effectue, au minimum tous les trente jours, l’inspection visuelle de tous les composants du système de contrôle des vapeurs pour détecter toute fuite de vapeur et toute fuite de liquide ou toute autre défectuosité qui peut être détectée visuellement.
Inspection — tous les ans
(2) Au moins une fois par année civile, et au plus quatorze mois après la date de l’inspection précédente, l’exploitant vérifie l’étanchéité du système de contrôle des vapeurs en utilisant l’un ou l’autre des instruments de détection de fuites visés au paragraphe 20(1).
Dossiers
(3) L’exploitant tient les dossiers contenant les renseignements ci-après, et tout document à l’appui, relatifs aux inspections du système de contrôle des vapeurs :
- a) la date de l’inspection;
- b) l’identifiant du système de contrôle des vapeurs qui a fait l’objet de l’inspection;
- c) si l’inspection était visuelle ou si elle était faite à l’aide d’un instrument de détection des fuites, et le cas échéant, le type d’instrument utilisé;
- d) les résultats de l’inspection, notamment une description et l’emplacement de la fuite ou de la défectuosité qui a été observée;
- e) le nom de la personne qui a effectué l’inspection, ainsi que le nom de son employeur.
Essais de performance — défectuosités
78 L’exploitant effectue, au moins une fois par année civile, et au plus quatorze mois après la date de l’essai précédent, un essai de performance du système de contrôle des vapeurs pour détecter les défectuosités visées au paragraphe 82(3).
Essai de performance — adaptations
79 (1) Si le système de contrôle des vapeurs est un système de récupération des vapeurs ou un système de destruction des vapeurs, l’essai de performance visé à l’article 78 s’effectue conformément à la section 7 de la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.1000-2019, intitulée Systèmes de récupération des vapeurs dans les réseaux de distribution d’essence, compte tenu des adaptations suivantes :
- a) la méthode d’essai s’applique à tous les systèmes de récupération des vapeurs et à tous les systèmes de destruction des vapeurs;
- b) la mention de terminal vaut mention d’installation;
- c) la mention d’essence vaut mention de liquide pétrolier volatil;
- d) la mention de vapeurs d’essence vaut mention de vapeurs de COV;
- e) si le système de contrôle des vapeurs est utilisé pour contrôler les émissions de COV émanant d’un réservoir, la période d’essai de la performance doit être de la même durée que l’essai de performance prévu dans la norme et doit comprendre au moins une heure pendant laquelle le réservoir est rempli au taux maximal de remplissage;
- f) l’utilisation d’autres méthodes d’essai, y compris la surveillance continue des émissions, n’est pas autorisée;
- g) l’analyseur des hydrocarbures totaux doit être un dispositif distinct du dispositif de surveillance continue et les deux dispositifs doivent collecter des données de manière indépendante pendant toute la durée de l’essai;
- h) les détections de méthane et d’éthane peuvent être exclues des résultats recueillis par l’analyseur d’hydrocarbures totaux :
- (i) soit au moyen d’un dispositif d’un type qui est insensible à ces substances,
- (ii) soit par la soustraction, de la lecture de l’effet de ces substances en fonction d’un facteur d’étalonnage ou de correction établi le jour de l’essai et adapté aux conditions d’essai, y compris la température, la pression, la composition atmosphérique globale et la composition réelle du gaz ou de la vapeur;
- i) dans tous les calculs et étalonnages, les références au propane et aux propriétés du propane, y compris la densité ou la masse moléculaire, doivent être remplacées par des références à une autre substance appropriée et par les propriétés de cette substance, chaque fois que cela est nécessaire pour représenter avec précision les propriétés d’un liquide pétrolier volatil;
- j) le volume des substances qui ne sont pas des liquides pétroliers volatils n’est pas inclus dans les calculs relatifs au volume de liquide chargé;
- k) les résultats des calculs peuvent indiquer, au lieu de la masse de COV émise par litre de liquide chargé, le rendement du système de contrôle des vapeurs en matière de masse de COV émise par mètre cube de vapeur évacuée.
Dispositif de surveillance continue
(2) La mesure de la précision du dispositif de surveillance continue visée au paragraphe 43(1) est évaluée en comparant les mesures générées par le dispositif durant l’essai aux résultats de l’essai de performance visé à l’article 78.
Retour en boucle des vapeurs — essai
80 (1) Si le système de contrôle des vapeurs est un système de retour en boucle des vapeurs, l’essai visé à l’article 78 doit couvrir toute la durée du chargement d’un réservoir à un véhicule et toute la durée du chargement d’un véhicule à un réservoir.
Éléments de l’essai
(2) L’essai inclut les éléments suivants :
- a) l’utilisation d’un manomètre étalonné pour surveiller la pression à la sortie des vapeurs du réservoir du véhicule durant le chargement;
- b) l’utilisation de méthodes visuelles, auditives ou olfactives pour surveiller les évents à pression-dépression sur le réservoir du véhicule et sur le réservoir pour déterminer si l’un des évents s’ouvre durant le chargement.
Chargement durant l’essai
(3) Le chargement durant l’essai doit être effectué conformément aux procédures d’utilisation uniformisées de l’exploitant, avec des véhicules représentatifs des véhicules utilisés à l’installation, sans modifications pour améliorer le rendement du système en vue de l’essai.
Dossiers
81 L’exploitant tient les dossiers contenant les renseignements ci-après, et tout document à l’appui, relatifs aux essais de performance effectués sur le système de contrôle des vapeurs :
- a) la date de l’essai;
- b) l’identifiant du système de contrôle des vapeurs qui a fait l’objet de l’essai;
- c) la méthode d’essai suivie;
- d) les instruments utilisés pour l’essai;
- e) la méthode d’essai d’étalonnage à l’égard des instruments utilisés pour l’essai, les dates des essais d’étalonnage et les résultats de ces essais;
- f) les conditions de fonctionnement dans lesquelles l’essai a été effectué;
- g) les résultats de l’essai et toutes les données recueillies;
- h) tout écart identifié entre les résultats de l’essai et la performance établie par le dispositif de surveillance continue;
- i) le nom de la personne qui a effectué l’essai ainsi que celui de son employeur.
Réparation
Réparation — délai
82 (1) L’exploitant répare, au plus tard quinze jours après la date de sa détection, toute défectuosité du système de contrôle des vapeurs.
Délai — exception
(2) Malgré le paragraphe (1), si le fonctionnement du système de contrôle des vapeurs n’est pas requis le dernier jour de la période visée au paragraphe (1), la défectuosité doit être réparée avant que le fonctionnement du système ne soit requis de nouveau.
Défectuosités
(3) Les situations ci-après constituent des défectuosités du système de contrôle des vapeurs :
- a) les fuites de vapeur ou les fuites de liquides;
- b) s’agissant d’un système de récupération des vapeurs ou d’un système de destruction des vapeurs, la non-conformité du dispositif de surveillance continue avec les exigences prévues à l’article 43;
- c) s’agissant d’un système de récupération des vapeurs ou d’un système de destruction des vapeurs, toute performance insuffisante en matière de capture ou de destruction des COV, aux termes des articles 47 à 49, selon le cas;
- d) s’agissant d’un système de retour en boucle des vapeurs, toute pression mesurée supérieure à 4,5 kPa à la sortie des vapeurs du réservoir du véhicule;
- e) s’agissant d’un système de retour en boucle des vapeurs, l’ouverture des évents à pression-dépression durant les activités de chargement;
- f) toute autre défectuosité susceptible de réduire la performance du système de contrôle des vapeurs.
Dossiers
(4) L’exploitant tient les dossiers contenant les renseignements ci-après, et tout document à l’appui, relatifs aux réparations effectuées sur le système de contrôle des vapeurs :
- a) l’identifiant du système de contrôle des vapeurs et celui du réservoir ou de la rampe de chargement sur lequel le système de contrôle des vapeurs a été installé;
- b) la date à laquelle la défectuosité a été détectée pour la première fois;
- c) une description de la défectuosité;
- d) la date de la réparation;
- e) une description de la réparation .
Toits flottants internes et toits flottants externes
Inspection du toit flottant interne
Tous les trente jours
83 (1) L’exploitant inspecte l’espace au-dessus du toit flottant interne au moins une fois tous les trente jours, sauf si le réservoir est muni d’un système de contrôle des vapeurs.
Omission d’inspections
(2) Malgré le paragraphe (1), au plus trois inspections peuvent être omises pendant une année civile, si les conditions météorologiques ou des circonstances imprévues occasionnent des problèmes de sécurité ou d’accessibilité et rendent l’inspection pratiquement impossible.
Dossier d’inspection
(3) L’exploitant consigne la raison pour laquelle il omet une inspection en application du paragraphe (2) dans le dossier d’inspection.
Inspection
84 (1) L’inspection visée au paragraphe 83(1) comprend les éléments suivants :
- a) une inspection visuelle du toit flottant interne, en utilisant de l’éclairage supplémentaire au besoin, pour déterminer si le toit flottant présente l’une ou l’autre des défectuosités visées aux alinéas 99(5)e) ou f);
- b) la détermination de la valeur du pourcentage LIE dans l’espace au-dessus du toit conformément aux conditions de contrôle et à la procédure prévues à l’annexe 2.
Conditions de contrôle
(2) Au moins l’une des inspections visées au paragraphe 83(1) doit aussi satisfaire aux conditions de contrôle prévues à l’alinéa 1e) de l’annexe 2, par année civile.
Pourcentage LIE de référence
85 (1) L’exploitant calcule un pourcentage LIE de référence aux fins d’évaluation de la performance du toit flottant interne.
Calcul
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le pourcentage LIE de référence est la moyenne arithmétique de toutes les valeurs du pourcentage LIE déterminées dans l’espace au-dessus du toit flottant interne au cours des quatre dernières années.
Valeurs exclues
(3) Les valeurs ci-après sont exclues du calcul du pourcentage LIE de référence :
- a) les valeurs du pourcentage LIE déterminées avant le remplacement complet du joint primaire ou du joint secondaire;
- b) les valeurs du pourcentage LIE qui dépassent 20, ou 10 si la concentration de benzène du liquide pétrolier volatil dans le réservoir est égale ou supérieure à 20 % en poids;
- c) les valeurs du pourcentage LIE déterminées avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Pourcentage LIE de référence non établi
(4) Malgré le paragraphe (1), le pourcentage LIE de référence n’est pas établi si moins de douze valeurs du pourcentage LIE sont incluses dans son calcul.
Seuils maximaux
(5) Les valeurs du pourcentage LIE dans l’espace au-dessus du toit flottant interne ne doivent dans aucun cas dépasser 20 et ne doivent pas dépasser les seuils suivants :
- a) 150 % du pourcentage LIE de référence, si le pourcentage LIE de référence est supérieur à 5;
- b) 7,5, si le pourcentage LIE de référence est inférieur à 5;
- c) 10, si la concentration de benzène du liquide pétrolier volatil dans le réservoir est égale ou supérieure à 20 % en poids.
Pourcentage LIE supérieur — première inspection
(6) Sous réserve du paragraphe (7), si lors d’une première inspection, la valeur du pourcentage LIE dépasse l’un des seuils indiqués au paragraphe (5), elle signale la présence d’une défectuosité au sens des paragraphes 99(5) ou (6).
Pourcentage LIE supérieur — deuxième inspection
(7) Si lors de la première inspection, la valeur du pourcentage LIE ne dépasse pas l’un des seuils indiqués au paragraphe 99(6), une deuxième inspection peut être effectuée dans les sept jours suivant la date de la première inspection, et, si lors de cette deuxième inspection la valeur du pourcentage LIE ne dépasse pas l’un des seuils indiqués au paragraphe (5), la valeur déterminée lors de la première inspection ne signale pas la présence d’une défectuosité au sens des paragraphes 99(5) ou (6).
Inspection — tous les vingt ans
86 L’exploitant inspecte l’intérieur du réservoir et le toit flottant interne tous les vingt ans pendant que le réservoir est hors service, laquelle inspection comprend les éléments suivants :
- a) la mesure des interstices de joints conformément aux conditions de contrôle et à la procédure prévues à l’annexe 1, sauf si le joint de rebord est remplacé au moment de l’inspection;
- b) l’inspection des trappes, couvercles et autres dispositifs de contrôle des émissions, y compris les joints et les flotteurs internes, afin de repérer les déchirures, les trous, la corrosion, le gonflement, la fragilisation ou tout autre dommage qui réduiraient leur efficacité en matière de contrôle des émissions;
- c) des essais de fonctionnement du système de trappes en vue de vérifier l’étanchéité automatique après leur utilisation, s’il y a lieu;
- d) l’entretien ou le remplacement des évents et des brise-vides, ou leur mise à l’essai, en vue de s’assurer qu’ils sont en bon état de fonctionnement et qu’ils resteront fermés lorsque le toit flottant flotte sur le liquide;
- e) l’inspection visant à repérer tout défaut structurel et toute corrosion du toit flottant interne et de tout autre équipement de contrôle des émissions;
- f) l’inspection des joints du toit flottant interne en vue de détecter des fuites de vapeur ou des fuites de liquides potentielles, des ouvertures ou des dommages;
- g) l’inspection de l’intérieur des flotteurs et la détermination de la valeur du pourcentage LIE à l’intérieur des flotteurs en vue de détecter les fuites de vapeur et les fuites de liquides, s’il y a lieu;
- h) l’inspection de la barre de boulonnage sur les joints secondaires de rebord, s’il y a lieu, en vue de détecter la corrosion et les soudures cassées;
- i) des essais de fonctionnement du système de jaugeage automatique et des alarmes, s’il y a lieu;
- j) l’inspection des poteaux de guidage ou des stabilisateurs du toit flottant interne destinés à empêcher la rotation, afin de détecter la corrosion, l’usure, la déformation et l’alignement, y compris des soudures de fixation entre le poteau de guidage et la paroi du réservoir;
- k) l’inspection visuelle de l’intérieur du poteau de guidage afin de déceler toute protubérance susceptible d’endommager la flotte de contrôle des vapeurs, s’il y a lieu;
- l) l’inspection du flotteur de contrôle des vapeurs ou du couvercle situé à l’intérieur du poteau de guidage, s’il y a lieu;
- m) l’inspection visant à repérer la corrosion, l’érosion et l’amincissement du tube diffuseur de l’entrée de liquide et des supports du tube diffuseur;
- n) l’inspection de la paroi interne du réservoir afin de détecter les rainures, la corrosion, les défaillances du revêtement et les faux ronds.
Inspection du toit flottant externe
Tous les trente jours
87 (1) L’exploitant inspecte visuellement la surface supérieure du toit flottant externe au moins une fois tous les trente jours pour détecter toute défectuosité visée aux alinéas 99(5)e) à g).
Inspection sans délai
(2) Malgré le paragraphe (1), si les conditions météorologiques ou des circonstances imprévues occasionnent des problèmes de sécurité ou d’accessibilité et rendent l’inspection pratiquement impossible, l’exploitant procède à l’inspection sans délai dès que les circonstances le permettent, ce délai ne dépassant pas sept jours.
Dossier d’inspection
(3) La raison pour laquelle l’exploitant reporte une inspection en application du paragraphe (2) est consignée dans le dossier d’inspection.
Inspection — tous les ans
88 (1) L’exploitant inspecte visuellement chaque année, et au plus quatorze mois après la date de l’inspection précédente, la surface supérieure du toit flottant externe pour détecter toute défectuosité visée aux alinéas 99(5)a et c) à h), et mesure les interstices des joints secondaires conformément aux conditions de contrôle et à la procédure prévues à l’annexe 1.
Au plus deux mètres
(2) Lorsque l’inspection visuelle vise les ouvertures du pont du toit flottant externe, elle s’effectue à une distance maximale de deux mètres de chaque ouverture.
Inspection — tous les cinq ans
89 L’exploitant inspecte la partie exposée de la paroi interne du réservoir et le toit flottant externe tous les cinq ans, laquelle inspection comprend les éléments suivants :
- a) la mesure des interstices de joints primaires conformément aux conditions de contrôle et à la procédure prévues à l’annexe 1, sauf si le joint de rebord est remplacé au moment de l’inspection;
- b) l’inspection des joints primaires et secondaires, par leur retrait tout autour de la paroi interne, en vue de vérifier leur bon fonctionnement;
- c) l’inspection du joint secondaire en vue de vérifier qu’il n’est pas déformé ou que l’angle qu’il forme avec la coque n’est pas trop petit;
- d) l’inspection des trappes, couvercles et autres dispositifs de contrôle des émissions, y compris les joints et les flotteurs internes, afin de repérer les déchirures, les trous, la corrosion, le gonflement, la fragilisation ou tout autre dommage qui réduiraient considérablement leur efficacité en matière de contrôle des émissions;
- e) l’inspection de la paroi interne du réservoir en vue de détecter les rainures, la corrosion, les défaillances du revêtement et les faux ronds;
- f) l’inspection du jaugeage automatique du réservoir et du logement de la poulie inférieure en vue de détecter les fuites de vapeur et les fuites de liquides, s’il y a lieu;
- g) l’inspection de la poutre de vent en vue de détecter toute corrosion;
- h) l’inspection visuelle du toit flottant externe afin de vérifier que le drainage est adéquat;
- i) des essais de fonctionnement du système de trappes afin de vérifier l’étanchéité automatique après leur utilisation, s’il y a lieu;
- j) l’inspection des poteaux de guidage et des puits de jauge en vue de déceler un amincissement et des signes de rainurage ou d’usure, s’il y a lieu;
- k) l’inspection de la nivelance du toit flottant externe en au moins trois endroits par la mesure de la distance entre le bord du toit et un cordon de soudure horizontal situé au-dessus du toit flottant;
- l) l’inspection des drains d’urgence afin de s’assurer qu’ils sont recouverts ou scellés de manière adéquate;
- m) l’inspection de l’intérieur des flotteurs et la détermination de la valeur du pourcentage LIE à l’intérieur des flotteurs en vue de détecter les fuites de vapeur et les fuites de liquides, s’il y a lieu;
- n) l’inspection du pont supérieur du toit flottant externe en vue de détecter les défauts de peinture et la corrosion sur le toit;
- o) l’inspection de la barre de boulonnage sur les joints secondaires de rebord, s’il y a lieu, en vue de détecter la corrosion et les soudures cassées.
Inspection — tous les vingt ans
90 L’exploitant inspecte l’intérieur du réservoir et le toit flottant externe tous les vingt ans pendant que le réservoir est hors service, laquelle inspection comprend les éléments suivants :
- a) l’entretien ou le remplacement des évents et des brise-vides, ou leur mise à l’essai, pour s’assurer qu’ils sont en bon état de fonctionnement et qu’ils restent fermés lorsque le toit flottant flotte sur le liquide;
- b) l’inspection visant à repérer tout défaut structurel et toute corrosion du toit flottant externe et de tout autre équipement de contrôle des émissions;
- c) l’inspection des joints du toit flottant externe en vue de détecter des fuites de vapeur ou des fuites de liquides potentielles, des ouvertures ou des dommages;
- d) l’inspection des surfaces supérieures et inférieures du toit flottant externe en vue de vérifier qu’ils ne sont pas endommagés et qu’ils ne sont pas corrodés;
- e) l’inspection des drains sur le toit flottant externe afin de vérifier qu’ils ne sont pas endommagés, qu’ils ne sont pas corrodés et qu’ils fonctionnent correctement;
- f) l’inspection des poteaux de guidage ou des stabilisateurs du toit flottant externe destinés à empêcher la rotation, afin de détecter la corrosion, l’usure, la déformation et l’alignement, y compris des soudures de fixation entre le poteau de guidage et la paroi du réservoir;
- g) des essais de fonctionnement du système de jaugeage automatique et des alarmes, s’il y a lieu;
- h) l’inspection visuelle de l’intérieur du poteau de jauge afin de déceler toute protubérance susceptible d’endommager la flotte de contrôle des vapeurs, s’il y a lieu;
- i) l’inspection de la flotte de contrôle des vapeurs ou du couvercle à l’intérieur de la perche de jauge, s’il y a lieu;
- j) l’inspection visant à repérer la corrosion, l’érosion et l’amincissement du tube diffuseur de l’entrée de liquide et des supports du tube diffuseur;
- k) l’inspection de la paroi interne du réservoir afin de détecter les rainures, la corrosion, les défaillances du revêtement et les faux ronds.
Mesure des interstices de joints
91 L’exploitant mesure les interstices de joints, conformément aux conditions de contrôle et à la procédure prévues à l’annexe 1, dans les soixante jours suivant la date de remplacement du joint de rebord.
Certificat d’inspecteur
92 L’exploitant veille à ce que les inspections visées aux articles 86, 89 et 90 soient effectuées par une personne détenant un certificat valide intitulé API 653 – Aboveground Storage Tank Inspector de l’American Petroleum Institute.
Dossiers
93 L’exploitant tient les dossiers contenant les renseignements ci-après, et tout document à l’appui, relatifs aux inspections effectuées sur le toit flottant interne et le toit flottant externe :
- a) la date de l’inspection;
- b) l’identifiant du réservoir qui a fait l’objet de l’inspection;
- c) les activités d’inspection réalisées et la méthode suivie pour les réaliser;
- d) les résultats de l’inspection, y compris une description et l’emplacement de la défectuosité qui a été observée;
- e) les raisons pour lesquelles des inspections ont été omises par application du paragraphe 83(2) ou reportées par application du paragraphe 87(2);
- f) s’agissant du toit flottant interne, le pourcentage LIE de référence calculé en application du paragraphe 85(2);
- g) s’agissant des inspections effectuées en application des articles 86, 89 ou 90, le nom de la personne qui a effectué l’inspection et la preuve démontrant qu’elle a obtenu la certification visée à l’article 92;
- h) les mesures des interstices de joints prises en application du paragraphe 88(1) ou des articles 89 ou 91;
- i) tout intervalle d’inspection réduit au titre de l’article 94;
- j) s’agissant de toute autre inspection effectuée sur les toits flottants internes et externes, le nom de la personne qui a effectué l’inspection ainsi que celui de son employeur, s’il y a lieu.
Autres exigences
Intervalles d’inspection réduits
94 Si les spécifications de conception ou les résultats d’inspection indiquent que la durée de vie prévue d’un composant d’un toit flottant interne ou d’un toit flottant externe est plus courte que les intervalles d’inspection pertinents prévus aux articles 86, 89 ou 90, selon le cas, les intervalles d’inspection portant sur ce composant sont réduits pour correspondre à la durée de vie prévue.
Rapport au ministre
95 (1) Lorsqu’une défectuosité est détectée sur un toit flottant interne ou un toit flottant externe et que des défectuosités ont été détectées sur ce toit à au moins deux occasions au cours des vingt-quatre mois précédents la date de la détection la plus récente, l’exploitant transmet un rapport au ministre dans les trente jours suivant la détection la plus récente.
Renseignements
(2) Le rapport contient les renseignements suivants :
- a) l’identifiant du réservoir dans lequel les défectuosités ont été détectées;
- b) une description des liquides qui sont stockés dans le réservoir, notamment leur PVR et leur concentration de benzène;
- c) les dates auxquelles les défectuosités ont été détectées;
- d) une description des défectuosités détectées;
- e) une description des réparations effectuées sur ces défectuosités;
- f) une description des mesures prises ou qui seront prises, le cas échéant, pour réduire le risque que les défectuosités se reproduisent.
Inspections sur les réservoirs existants effectuées avant l’entrée en vigueur du présent règlement
Délais d’inspections
96 (1) Les inspections prévues aux articles 86 et 90 pour un réservoir existant débutent à la plus récente des dates suivantes :
- a) la date à laquelle le réservoir a été en service pour la première fois, à condition que les dossiers de l’exploitant démontrent que l’ensemble des essais ou inspections de vérification de l’installation et du fonctionnement corrects du réservoir requis par les spécifications de conception aient été effectués;
- b) la date de l’inspection interne du réservoir la plus récente, à condition que le rapport d’inspection de l’exploitant démontre que l’inspection a été effectuée par une personne détenant un certificat valide intitulé API 653 – Aboveground Storage Tank Inspector de l’American Petroleum Institute.
Conditions non satisfaites
(2) Si les conditions prévues aux alinéas (1)a) et b) ne sont pas satisfaites, l’inspection du réservoir est effectuée dans le délai prévu à l’article 113.
Défectuosités
97 Pour l’application des articles 98 et 99, toute défectuosité détectée au moment d’une inspection effectuée sur un réservoir avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement est considérée comme étant détectée un an après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Réparation
Réparation — réservoir hors service
98 Les défectuosités d’un réservoir, d’un toit flottant interne ou d’un toit flottant externe lorsque le réservoir est hors service, doivent être réparées avant que le réservoir ne soit remis en service.
Réparation — réservoir en service
99 (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3), (5) et (6), lorsqu’une défectuosité est détectée lorsque le réservoir est en service, l’exploitant prend l’une ou l’autre des mesures suivantes, selon le cas :
- a) s’agissant d’une défectuosité du réservoir, du toit flottant interne ou du toit flottant externe, dans un délai de quarante-cinq jours suivant la date de la détection de la défectuosité :
- (i) soit mettre le réservoir hors service,
- (ii) soit réparer la défectuosité;
- b) s’agissant d’une défectuosité d’un réservoir muni d’un toit flottant interne ou d’une défectuosité du toit flottant interne, munir le réservoir d’un système de contrôle des vapeurs temporaire dans un délai de cinq jours suivant la date de la détection, et réparer la défectuosité dans un délai de cent trente-cinq jours suivant cette date.
Réservoir désigné au titre du paragraphe 115(1)
(2) Sous réserve du paragraphe (6), si une défectuosité est détectée à un réservoir désigné au titre du paragraphe 115(1) et que la réparation nécessite la mise hors service du réservoir, la réparation peut être reportée jusqu’à ce qu’elle soit exigée au titre de l’article 98.
Défaut des joints de rebord — soixante-quinze jours
(3) Le délai imparti pour la réparation de toute défectuosité d’un joint de rebord est de soixante-quinze jours après la date de sa détection si les circonstances suivantes sont réunies :
- a) la taille totale cumulée de tous les interstices de joints est inférieure à 1 000 cm2 par mètre de diamètre du réservoir;
- b) dans une période de trente jours suivant la date de la détection de la défectuosité, si les conditions suivantes sont réunies :
- (i) une personne détenant un certificat valide intitulé API 653 — Aboveground Storage Tank Inspector de l’American Petroleum Institute a déterminé que le réservoir est libre de toute autre défectuosité détectée qui empêcherait la réparation du joint de rebord lorsque le réservoir est en service,
- (ii) l’exploitant a ajouté cette conclusion aux dossiers tenus sur les réservoirs conformément à l’article 105 de même qu’une indication qu’il tentera de réparer le joint de rebord lorsque le réservoir est en service.
Réparation irréalisable
(4) Si, après avoir tenté d’effectuer la réparation au joint de rebord, l’exploitant conclut qu’il n’est pas possible de le faire lorsque le réservoir est en service, il met le réservoir hors service dans un délai de quarante-cinq jours suivant la date de cette conclusion.
Défectuosités
(5) Les situations ci-après constituent des défectuosités aux toits flottants internes et aux toits flottants externes :
- a) un réservoir qui ne satisfait pas aux exigences de l’article 30 de sorte que l’efficacité du toit flottant interne ou du toit flottant externe peut être réduite en matière de contrôle des émissions;
- b) un interstice de joints qui est supérieur aux dimensions prévues aux paragraphes 57(2) et (3) et 66(2) et (3);
- c) une ouverture qui ne respecte pas les exigences prévues aux articles 58 et 67;
- d) une valeur du pourcentage LIE qui dépasse les seuils maximaux prévus au paragraphe 85(5);
- e) dans le cas d’un toit flottant externe, le drainage inadéquat du toit flottant externe nuit à sa capacité de flottaison sur la surface du liquide;
- f) la présence de liquides pétroliers volatils sur la surface supérieure du toit flottant interne ou du toit flottant externe couvrant une superficie de plus de 1 m2 ou la présence de liquides pétroliers volatils sur la surface supérieure du toit flottant interne ou du toit flottant externe observée plus d’une fois au cours d’une période de douze mois;
- g) la présence de défectuosités structurelles du toit flottant interne ou du toit flottant externe qui pourraient réduire son efficacité en matière de contrôle des émissions;
- h) toute autre défectuosité qui pourrait réduire l’efficacité du toit flottant interne ou du toit flottant externe en matière de contrôle des émissions.
Défectuosités majeures
(6) Si le toit flottant interne ou le toit flottant externe s’est enfoncé, si la valeur du pourcentage LIE d’un réservoir de liquide à haute concentration de benzène dépasse 20 ou si la valeur du pourcentage LIE d’un réservoir désigné en application de l’un ou l’autre des alinéas 7c) ou d) dépasse 50, l’exploitant, dès que possible après la détection de la défectuosité, cesse de charger des liquides pétroliers volatils dans le réservoir et prend l’une ou l’autre des actions suivantes :
- a) vide le réservoir de tout liquide pétrolier volatil dans les cinq jours suivant la date de la détection de la défectuosité;
- b) s’agissant d’un réservoir muni d’un toit flottant interne, munis le réservoir d’un système de contrôle des vapeurs temporaire dans les cinq jours suivant la date de la détection de la défectuosité et répare la défectuosité dans un délai de cent trente-cinq jours suivant la date de la détection.
Dossiers
(7) L’exploitant tient les dossiers contenant les renseignements ci-après, et tout document à l’appui, relatifs aux réparations effectuées en application du présent article et del’ article 98 :
- a) l’identifiant du réservoir;
- b) la date à laquelle la défectuosité a été détectée pour la première fois;
- c) une description de la défectuosité;
- d) la date de la réparation;
- e) une description de la réparation.
Plan de réduction des émissions de COV
Nettoyage du réservoir ou remplacement d’un joint
100 (1) L’exploitant prépare un plan de réduction des émissions de COV avant de procéder au nettoyage de l’intérieur d’un réservoir ou au remplacement d’un joint de rebord sur le toit flottant interne ou le toit flottant externe du réservoir qui est en service, et il le met en œuvre au moment du nettoyage ou du remplacement.
Plan de réduction des émissions
(2) Le plan de réduction des émissions comporte une description des activités planifiées relatives au nettoyage ou au remplacement qui seraient susceptibles de provoquer des émissions de COV ainsi que les mesures qui seront prises pour réduire ces émissions, y compris une description d’au moins une des mesures suivantes dans le cas du nettoyage de l’intérieur du réservoir :
- a) terminer le nettoyage de l’intérieur du réservoir dans un délai de quarante-huit heures après que le toit flottant interne cesse de flotter sur le liquide;
- b) diluer ou décontaminer chimiquement le liquide contenu dans le réservoir de sorte que le liquide n’est plus considéré comme un liquide pétrolier volatil;
- c) munir le réservoir d’ un système de contrôle des vapeurs temporaire.
Évents à pression-dépression
Inspection
Évent à pression-dépression
101 (1) L’exploitant inspecte l’évent à pression-dépression chaque année, et au plus quatorze mois après la date de l’inspection précédente, pour vérifier qu’il satisfait aux exigences prévues aux alinéas 70a) et b).
Cinq ans
(2) L’exploitant inspecte l’évent à pression-dépression tous les cinq ans pour vérifier qu’il satisfait à l’exigence prévue à l’alinéa 70c).
Réparation
Défectuosité détectée
102 (1) Si une défectuosité à l’évent à pression-dépression est détectée pendant que le réservoir est en service, elle doit être réparée dès que possible et au plus tard quarante-cinq jours après la date de sa détection.
Défectuosités
(2) La non-conformité à l’une ou l’autre des exigences prévues aux alinéas 70a) à c) constitue une défectuosité à l’évent à pression-dépression.
Dossiers
(3) L’exploitant tient les dossiers contenant les renseignements ci-après, et tout document à l’appui, relatifs à chaque réparation effectuée sur l’évent à pression-dépression :
- a) l’identifiant du réservoir dans lequel la défectuosité a été détectée;
- b) la date à laquelle la défectuosité a été détectée pour la première fois;
- c) une description de la défectuosité;
- d) la date de la réparation;
- e) une description de la réparation.
Détection — réservoir hors service
(4) Si le réservoir était hors service au moment où la défectuosité à l’évent à pression-dépression a été détectée, la défectuosité est réparée avant que le réservoir ne soit remis en service.
Plan de réparation prolongé
Motifs
103 (1) L’exploitant peut préparer et mettre en œuvre un plan de réparation prolongé pour un réservoir, son toit flottant interne ou son toit flottant externe si le réservoir devrait être mis hors service aux fins de réparation d’une défectuosité et que la mise hors service ne peut être accomplie pour permettre la réparation dans les délais prévus à l’article 99 pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
- a) la mise hors service du réservoir nécessiterait l’arrêt d’une partie ou de la totalité de l’équipement de traitement du pétrole à l’installation et, à tout moment entre le jour où la défectuosité a été détectée et le jour où elle devait être réparée, selon les délais prévus au présent règlement, l’une ou l’autre des situations suivantes se produit :
- (i) au moins 10 %, arrondi vers le haut au pour cent près, des réservoirs à l’installation dont le volume intérieur est supérieur ou égal à 100 m3 sont mis hors service, en raison de travaux de nettoyage, d’entretien ou de construction, pour une période ne dépassant pas une année,
- (ii) au moins 20 %, arrondi vers le haut au pour cent près, des réservoirs à l’installation qui, immédiatement avant leur mise hors service, contenaient un liquide qui est utilisé ou vendu par l’installation de manière interchangeable avec le liquide contenu dans le réservoir à réparer, sont mis hors service, en raison de travaux de nettoyage, d’entretien ou de construction, pour une période ne dépassant pas une année;
- b) l’agent autorisé détermine qu’il n’existe pas, à l’installation ou hors de l’installation, d’options de stockage, de traitement ou d’élimination du contenu du réservoir;
- c) l’agent autorisé détermine que des risques importants associés à la mise hors service du réservoir qui seraient atténués avec un délai de réparation supplémentaire existent pour la santé, la sécurité ou l’environnement.
Définition de agent autorisé
(2) Pour l’application du paragraphe (1), agent autorisé s’entend :
- a) dans le cas où l’exploitant est une personne physique, de la personne physique autorisée à agir en son nom;
- b) dans le cas où l’exploitant est une personne morale, de celui de ses dirigeants autorisé à agir en son nom;
- c) dans le cas où l’exploitant est une entité autre qu’une personne morale, de la personne physique autorisée à agir en son nom.
Cessation du chargement
(3) Si l’exploitant a l’intention de mettre en œuvre un plan de réparation prolongé pour l’un des motifs visés aux alinéas (1)b) ou c), il cesse de charger tout liquide pétrolier volatil dans le réservoir dans les délais suivants :
- a) s’agissant d’une défectuosité visée au paragraphe 99(6), au moment où la défectuosité est détectée;
- b) s’agissant de toute autre défectuosité, dans un délai de trente jours suivant la date de la détection de la défectuosité.
Avis au ministre
(4) Si l’exploitant a l’intention de mettre en œuvre un plan de réparation prolongé, il en avise le ministre par écrit et lui fournit une copie du plan comprenant les renseignements ci-après dans les trente jours suivant la date de la détection de la défectuosité :
- a) le motif invoqué au titre du paragraphe (1) nécessitant la mise en œuvre d’un plan de réparation prolongé;
- b) les renseignements qui démontrent que les motifs énumérés au paragraphe (1) sont applicables;
- c) l’identifiant du réservoir dans lequel la défectuosité a été détectée;
- d) une description des liquides qui sont stockés dans le réservoir, notamment leur PVR et leur concentration de benzène;
- e) la date à laquelle la défectuosité a été détectée;
- f) une description de la défectuosité;
- g) le délai prévu pour la mise hors service du réservoir et les raisons du délai;
- h) une description de la réparation prévue, y compris les mesures qui seront prises pour atténuer les émissions de COV jusqu’à ce que la réparation soit terminée.
Mise hors service — délai
(5) La mise hors service du réservoir doit être terminée dans le délai prévu indiqué dans le plan de réparation prolongé et ce délai ne peut en aucun cas dépasser cent trente-cinq jours à compter du jour où la défectuosité a été détectée.
Défectuosités majeures — délai
(6) S’il s’agit d’une défectuosité visée au paragraphe 99(6), l’exploitant veille à ce que le réservoir soit mis hors service dans un délai de dix jours suivant la date où la défectuosité a été détectée.
Inventaire
Inventaire
104 (1) L’exploitant établit un inventaire, qu’il garde à son installation, des réservoirs désignés en application de l’article 7 et des rampes de chargement désignées en application du paragraphe 8(1), de l’installation, lequel contient les renseignements suivants :
- a) l’identifiant du réservoir ou de la rampe de chargement;
- b) si le réservoir est hors service et la date de sa mise hors service;
- c) si le réservoir ou la rampe de chargement est un réservoir existant ou une rampe de chargement existante;
- d) si le réservoir est désigné réservoir en service intermittent au titre du paragraphe 5(1);
- e) la catégorie à laquelle le réservoir appartient selon sa désignation en application de l’article 7 ou à laquelle la rampe de chargement appartient selon sa désignation en application du paragraphe 8(1);
- f) le type d’équipement de contrôle des émissions utilisé pour chaque réservoir et chaque rampe de chargement;
- g) si le réservoir ou la rampe de chargement sont désignés au titre de l’article 115.
Mise à jour
(2) L’exploitant met à jour l’inventaire dans les cinq jours suivant la date de toute modification apportée aux renseignements qui y sont prévus.
Tenue de dossiers
Dossiers
Réservoirs
105 L’exploitant tient, pour chaque réservoir désigné en application de l’article 7 ou ayant été ainsi désigné au cours des six dernières années, des dossiers contenant les renseignements ci-après, et tout document à l’appui :
- a) les spécifications de conception du réservoir, ainsi que l’année de l’installation du réservoir;
- b) le nom ou la description de chaque liquide stocké dans le réservoir, la date où le réservoir contenait le liquide pour la première fois, et les dates où le réservoir était hors service;
- c) dans le cas d’un réservoir désigné réservoir à service intermittent au titre du paragraphe 5(1), les renseignements démontrant que le réservoir était en service pendant moins de trois cents heures au total par année civile;
- d) l’analyse statistique ou technique démontrant la quantification de la variation des propriétés du liquide pétrolier volatil visée au paragraphe 5(2), s’il y a lieu;
- e) la désignation du réservoir en application de l’article 7, le cas échéant, la date à laquelle il a été ainsi désigné pour la première fois, toute modification subséquente de cette désignation et la date de ces modifications;
- f) la méthode utilisée aux fins de détermination des propriétés des liquides stockés dans le réservoir et les résultats des essais, le cas échéant, y compris leur concentration de benzène, leur PVR et leur concentration de COV;
- g) le type d’équipement de contrôle des émissions installé pendant la durée de vie du réservoir, y compris l’année de son installation;
- h) les spécifications de conception de l’équipement de contrôle des émissions, requises conformément aux articles 41, 52, 61 et 70 et au sous-alinéa 72(3)b)(ii), et les renseignements validant l’installation de l’équipement sur le réservoir;
- i) si un système de contrôle des vapeurs est utilisé comme équipement de contrôle des émissions, les périodes pendant lesquelles le système était hors service, et les raisons pour lesquelles il l’était;
- j) si un système de contrôle des vapeurs temporaire est utilisé sur le réservoir comme équipement de contrôle des émissions, la date de début de son utilisation;
- k) les dossiers sur les inspections, l’entretien et la réparation du réservoir et de l’équipement de contrôle des émissions installé sur le réservoir;
- l) les renseignements visés au sous-alinéa 99(3)b)(ii), s’il y a lieu;
- m) le plan de réduction des émissions visé à l’article 100, s’il y a lieu;
- n) un plan d’entretien du réservoir indiquant le type d’inspection, la fréquence des inspections ou la date la plus tardive permise de la prochaine inspection de chaque type requis par le présent règlement, compte tenu de tout intervalle d’inspection réduit applicable au titre de l’article 94;
- o) si le réservoir est désigné au titre de l’article 115, la date à laquelle il a été ainsi désigné pour la première fois, toute modification subséquente de cette désignation et la date de ces modifications.
Rampes de chargement
106 L’exploitant tient, pour chaque rampe de chargement désignée en application du paragraphe 8(1) ou ayant été ainsi désignée au cours des six dernières années, des dossiers contenant les renseignements ci-après, et tout document à l’appui :
- a) la désignation de la rampe de chargement en application du paragraphe 8(1), le cas échéant, la date à laquelle elle a été ainsi désignée pour la première fois, toute modification subséquente de cette désignation et la date de ces modifications;
- b) la méthode utilisée aux fins de détermination des propriétés des liquides chargés avec la rampe de chargement et les résultats des essais, s’il y a lieu, sur les propriétés des liquides, y compris leur concentration de benzène, leur PVR et leur concentration de COV;
- c) le nom ou la description de chaque liquide chargé avec la rampe de chargement, le volume de chaque liquide chargé chaque jour, et si le chargement a été effectué lorsque le système de contrôle des vapeurs était hors service et sans qu’un système de contrôle des vapeurs temporaire ne soit utilisé;
- d) le type d’équipement de contrôle des émissions installé pendant la durée de vie de la rampe de chargement, y compris l’année de son installation;
- e) les spécifications de conception de l’équipement de contrôle des émissions visé à l’alinéa d) et les renseignements validant l’installation de l’équipement de contrôle des émissions sur la rampe de chargement;
- f) les périodes pendant lesquelles le système de contrôle des vapeurs était hors service, et les raisons pour lesquelles il l’était;
- g) si un système de contrôle des vapeurs temporaire est utilisé sur la rampe de chargement comme équipement de contrôle des émissions, la date de début de son utilisation;
- h) les dossiers d’inspection, d’entretien et de réparation de l’équipement de contrôle des émissions installé sur la rampe de chargement;
- i) si la rampe de chargement est désignée au titre de l’article 115, la date à laquelle elle a été ainsi désignée pour la première fois, toute modification subséquente de cette désignation et la date de ces modifications.
Mesures et calculs
107 L’exploitant tient les dossiers, et tout document à l’appui, relatifs à toute mesure et tout calcul servant à déterminer la valeur d’un élément d’une équation figurant dans le présent règlement, y compris la méthodologie utilisée pour déterminer cette valeur.
Formation suivie
108 L’exploitant tient des dossiers contenant les renseignements ci-après, et tout document à l’appui, relatifs à la formation suivie par toute personne, y compris tout professionnel qualifié, relativement à l’accomplissement des fonctions en application des articles 16, 22 ou 29 :
- a) les nom et titre de la personne, ainsi que son adresse professionnelle et le nom de son employeur;
- b) la date à laquelle elle a terminé cette formation;
- c) le nom de l’entité qui a donné cette formation;
- d) une description de cette formation.
Demandes du ministre — dossiers
109 (1) L’exploitant transmet, au plus tard trente jours après avoir reçu une demande du ministre, une copie de tout dossier qu’il doit tenir en vertu du présent règlement.
Demande du ministre — échantillons
(2) L’exploitant met à la disposition du ministre et, à sa demande, lui envoie à l’adresse et de la manière indiquées dans la demande un échantillon de tout liquide stocké dans le réservoir ou chargé avec la rampe de chargement.
Conservation
Six ans
110 (1) L’exploitant veille à ce que les dossiers tenus en application du présent règlement sont conservés pendant une période d’au moins six ans après la date de leur création.
Inspections de l’intérieur des réservoirs
(2) Malgré le paragraphe (1), les dossiers relatifs aux inspections de l’intérieur des réservoirs effectuées en application des articles 86 ou 90, y compris les dossiers relatifs aux réparations effectuées à la suite de ces inspections, sont conservés jusqu’à la date à laquelle l’inspection de l’intérieur des réservoirs est effectuée en application de ces mêmes dispositions.
Support électronique lisible
(3) Les dossiers qui sont conservés sur un support électronique doivent l’être sur un support électronique compatible avec celui qu’utilise le ministre pour les périodes de conservation prévues aux paragraphes (1) et (2), selon le cas.
Lieu de conservation
(4) Les dossiers sont conservés à l’installation ou en tout autre lieu au Canada où ils peuvent être examinés.
Langue
(5) Les dossiers tenus en application du présent règlement doivent être en anglais ou en français, ou, s’ils sont dans une autre langue, être accompagnés d’une traduction anglaise ou française, et d’une déclaration attestant de l’exactitude de la traduction.
Enregistrement de l’installation
Rapport d’enregistrement
111 (1) L’exploitant transmet au ministre un rapport d’enregistrement de l’installation qui contient les renseignements suivants :
- a) le nom de l’exploitant;
- b) l’adresse municipale, le nom, le cas échéant, et les coordonnées géographiques de l’installation;
- c) l’adresse municipale de l’endroit où sont conservés les dossiers conformément au présent règlement, si elle est différente de celle de l’installation;
- d) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et adresse électronique d’une personne-ressource;
- e) les numéros d’identification de l’inventaire national des rejets de polluants de l’installation, le cas échéant;
- f) une description des activités menées à l’installation;
- g) l’inventaire établi conformément à l’article 104, y compris les renseignements suivants :
- (i) pour chaque réservoir figurant à l’inventaire :
- (A) le volume intérieur du réservoir, en mètres cubes, ainsi que sa hauteur et son diamètre, en mètres,
- (B) le nom ou la description du liquide stocké dans le réservoir, ainsi que ses propriétés, y compris sa concentration de benzène, sa PVR et, s’agissant d’un liquide mélangeant de l’eau et des hydrocarbures, sa concentration de COV, déterminées par des méthodes qui se conforment aux pratiques d’ingénierie généralement acceptées, y compris l’utilisation de la simulation physique, de textes de référence normalisés ou de spécifications du fournisseur,
- (ii) pour chaque réservoir ne figurant pas à l’inventaire dont le volume intérieur est supérieur ou égal à 100 m3 et qui stocke ou peut stocker tout type de liquide pétrolier, y compris un liquide pétrolier non classé comme liquide pétrolier volatil :
- (A) le volume intérieur du réservoir, en mètres cubes, ainsi que sa hauteur et son diamètre, en mètres,
- (B) le nom ou la description du liquide stocké dans le réservoir,
- (iii) pour chaque rampe de chargement figurant à l’inventaire, les débits annuels des rampes pour chaque liquide pétrolier et type de véhicule, pour l’année civile précédente;
- (i) pour chaque réservoir figurant à l’inventaire :
- h) le nombre total de réservoirs visés aux sous-alinéas g)(i) et (ii).
Délai de transmission
(2) L’exploitant transmet le rapport d’enregistrement dans les trente jours suivant la date de début de l’exploitation de l’installation.
Délai — exploitation avant l’entrée en vigueur
(3) Malgré le paragraphe (2), l’exploitant dont l’exploitation de l’installation a débuté avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement transmet le rapport d’enregistrement dans les cent vingt jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Modification aux renseignements
(4) L’exploitant avise le ministre de toute modification apportée aux renseignements visés aux alinéas (1)a) à f) dans les cinq jours suivant la date de la modification.
Fourniture
(5) L’exploitant fournit au ministre, chaque année, les renseignements visés aux alinéas (1)a) à g) dans les trente jours suivant l’anniversaire de l’entrée en vigueur du présent règlement.
Application différée — réservoirs et rampes de chargements existants
Report
Toits flottants
112 Les exigences prévues aux articles 54 et 55, au paragraphe 56(2), aux articles 58 à 60 et 63 et 64, aux paragraphes 65(2) et (3) et aux articles 67 à 69 s’appliquent aux réservoirs existants, à l’exception des réservoirs de liquide à haute concentration de benzène — qui sont munis d’un toit flottant interne ou d’un toit flottant externe, — à compter du jour où l’une ou l’autre des situations suivantes survient :
- a) le réservoir a été inspecté en application des articles 86 ou 90;
- b) le délai pour l’inspection du réservoir prévu aux articles 86 ou 90 est expiré;
- c) le toit flottant externe du réservoir est réparé en application de l’article 99;
- d) le réservoir est remis en service.
Premier anniversaire — réservoirs existants
113 (1) Les exigences prévues aux articles 83 à 90 et 99 s’appliquent aux réservoirs existants, à partir de la date du premier anniversaire de l’entrée en vigueur du présent règlement.
Réservoirs de liquide à haute concentration de benzène
(2) Les exigences prévues aux articles 28 et 31 s’appliquent aux réservoirs de liquide à haute concentration de benzène existants, à partir de la date du premier anniversaire de l’entrée en vigueur du présent règlement.
Rampes de chargement de liquide à haute concentration de benzène
(3) Les exigences prévues aux articles 28 et 35 s’appliquent aux rampes de chargement existantes désignées rampes de chargement de liquide à haute concentration de benzène visées à l’alinéa 8(1)a), à partir de la date du premier anniversaire de l’entrée en vigueur du présent règlement.
Troisième anniversaire — réservoirs existants
114 (1) Les exigences prévues aux articles 28 et 31 à 33 s’appliquent aux réservoirs existants, à l’exception des réservoirs de liquide à haute concentration de benzène, à partir de la date du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent règlement.
Troisième anniversaire — rampes de chargement existantes
(2) Les exigences prévues aux articles 28 et 35 s’appliquent aux rampes de chargement existantes, à l’exception des rampes désignées rampes de liquide à haute concentration de benzène, visées à l’alinéa 8(1)a), à partir de la date du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent règlement.
Période supplémentaire
Désignation
115 (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5) et des articles 116 à 120, l’exploitant peut désigner qu’un réservoir existant est un réservoir visé par une application différée ou qu’une rampe de chargement existante est une rampe de chargement visée par une application différée et bénéficier d’une période supplémentaire pour se conformer aux exigences visées à l’article 114.
Haute concentration de benzène
(2) Une désignation au titre du paragraphe (1) ne peut être appliquée à un réservoir de liquide à haute concentration de benzène ou à une rampe de chargement désignée rampe de chargement de liquide à haute concentration de benzène visée à l’alinéa 8(1)a).
Inventaire et dossiers
(3) Une désignation au titre du paragraphe (1) doit être consignée à l’inventaire établi conformément à l’article 104 et indiquée dans les dossiers tenus pour ce réservoir ou cette rampe de chargement conformément aux articles 105 ou 106.
Au moins deux réservoirs existants
(4) Un réservoir existant peut être désigné au titre du paragraphe (1) si au moins deux réservoirs existants à l’installation ont été munis d’un toit flottant interne ou d’un système de contrôle des vapeurs suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Facteur de charge
(5) Si le facteur de chargement total à l’installation, calculé conformément à la méthode prévue à l’article 1 de l’annexe 3, était supérieur ou égal à 7 à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, une rampe de chargement existante peut être désignée au titre du paragraphe (1) si au moins une rampe de chargement existante à l’installation a été munie d’un système de contrôle des vapeurs suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Quatrième année — réservoirs
116 (1) Dans la quatrième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, le nombre de réservoirs existants à une installation qui peuvent être désignés au titre du paragraphe 115(1) ne peut excéder la moins élevée des valeurs suivantes :
- a) la valeur équivalente à 20 %, arrondi vers le haut au pour cent près, du nombre total de réservoirs prévu dans le rapport d’enregistrement de l’installation présenté conformément à l’alinéa 111(1)h);
- b) douze.
Deux rampes de chargement
(2) Dans la quatrième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, au plus deux rampes de chargement existantes d’une installation peuvent être désignées au titre du paragraphe 115(1).
Cinquième année — réservoirs
117 (1) Dans la cinquième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, le nombre de réservoirs existants à une installation qui peuvent être désignés au titre du paragraphe 115(1) ne peut excéder la moins élevée des valeurs suivantes :
- a) la valeur équivalente à 15 %, arrondi vers le haut au pour cent près, du nombre total de réservoirs prévu dans le rapport d’enregistrement de l’installation présenté conformément à l’alinéa 111(1)h);
- b) neuf.
Une rampe de chargement
(2) Dans la cinquième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, une seule rampe de chargement existante d’une installation peut être désignée au titre du paragraphe 115(1).
Sixième année — réservoirs
118 (1) Dans la sixième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, le nombre de réservoirs existants à une installation qui peuvent être désignés au titre du paragraphe 115(1) ne peut excéder la moins élevée des valeurs suivantes :
- a) la valeur équivalente à 10 %, arrondi vers le haut au pour cent près, du nombre total de réservoirs prévu dans le rapport d’enregistrement de l’installation présenté conformément à l’alinéa 111(1)h);
- b) six.
Aucune rampe de chargement
(2) À compter de la sixième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, aucune rampe de chargement existante d’une installation ne peut être désignée au titre du paragraphe 115(1).
Septième année — réservoirs
119 Dans la septième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, le nombre de réservoirs existants à une installation qui peuvent être désignés au titre du paragraphe 115(1) à une installation ne peut excéder la moins élevée des valeurs suivantes :
- a) la valeur équivalente à 5 %, arrondi vers le haut au pour cent près, du nombre total de réservoirs prévu dans le rapport d’enregistrement de l’installation présenté conformément à l’alinéa 111(1)h);
- b) trois.
Huitième année — aucun réservoir
120 À compter de la huitième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, aucun réservoir existant d’une installation ne peut être désigné au titre du paragraphe 115(1).
Modification connexe au Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
| Article | Colonne 1 Règlement |
Colonne 2 Dispositions |
|---|---|---|
| 44 | Règlement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (stockage et chargement de liquides pétroliers volatils) |
|
Entrée en vigueur
Enregistrement
122 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE 1
(paragraphes 57(1) et 66(1), alinéa 86a), paragraphe 88(1), alinéa 89a) et article 91)
Mesure des interstices des joints de réservoirs à toit flottant
Conditions de contrôle
1 La mesure des interstices des joints de réservoirs à toit flottant doit être effectuée dans les conditions de contrôle suivantes :
- a) à l’aide d’un ensemble de sondes cylindriques uniformes de différents diamètres qui satisfont aux critères suivants :
- (i) la plus petite sonde doit avoir un diamètre de 0,3 cm,
- (ii) l’une des sondes doit avoir un diamètre de 4 cm, dans le cas de la mesure de l’interstice du joint primaire, ou un diamètre de 1,3 cm dans le cas de la mesure de l’interstice du joint secondaire,
- (iii) le diamètre de chaque sonde doit être inférieur au double de celui de la plus petite sonde suivante;
- b) le niveau de liquide dans le réservoir ne doit pas changer pendant la prise des mesures;
- c) si le réservoir est un réservoir à toit flottant externe, toutes les mesures des interstices des joints doivent être prises lorsque le toit flottant flotte librement sur la surface du liquide et non lorsqu’il repose sur une structure de soutien ou sur un système de suspension;
- d) dans le cas de la mesure de l’interstice d’un joint primaire, tout joint secondaire ou toute couverture qui restreint l’accès au joint primaire doivent être éloignés de la paroi du réservoir, retirés ou positionnés de manière à ne pas interférer avec la prise de mesure.
Procédure
2 La procédure ci-après doit être suivie pour mesurer les interstices des joints d’un réservoir à toit flottant :
- a) repérer les interstices des joints sur la circonférence du réservoir en passant une sonde de 0,3 cm de diamètre entre le joint et la paroi du réservoir sans forcer la sonde ni la coller contre le joint;
- b) mesurer la longueur de chaque interstice, en centimètres, la distance circonférentielle le long de la paroi du réservoir entre les deux extrémités opposées de l’interstice;
- c) déterminer la taille de chaque interstice en mesurant, en centimètres, à l’aide de sondes de diamètre de plus en plus grand, la largeur de l’interstice entre le rebord et la paroi du réservoir, et en multipliant chaque largeur par la longueur de l’interstice déterminé à l’alinéa b) (si la largeur de l’interstice en un point quelconque est supérieure au diamètre d’une sonde, mais inférieure au diamètre de la prochaine sonde, la largeur doit être calculée par interpolation linéaire à partir des mesures prises par ces deux sondes);
- d) calculer et consigner la largeur de l’interstice le plus large;
- e) additionner les tailles individuelles calculées à l’alinéa c) pour tous les interstices trouvés à l’alinéa a);
- f) diviser la taille totale calculée à l’alinéa e) par le diamètre intérieur du réservoir et consigner le résultat en centimètres cubes par mètre.
ANNEXE 2
(alinéa 84(1)b) et paragraphe 84(2))
Mesure de la concentration des vapeurs de COV des réservoirs à toit flottant interne
Conditions de contrôle
1 La mesure de la concentration des vapeurs de COV dans l’espace situé entre le toit fixe et le toit flottant interne d’un réservoir à toit flottant interne doit être effectuée dans les conditions de contrôle suivantes :
- a) le volume de liquide dans le réservoir ne doit pas être réduit de plus de 25 % de la capacité totale de liquide du réservoir pendant la période de huit heures précédant la prise de mesure;
- b) la vitesse du vent doit être inférieure à 10 km/h pendant la prise des mesures (si la vitesse moyenne du vent au cours du mois pendant lequel la mesure est prise est supérieure à 10 km/h, telle qu’elle est déterminée à la station d’observation météorologique la plus proche de l’installation selon les données les plus récentes des normales climatiques canadiennes publiées par le Service météorologique du Canada, la mesure est prise lorsque la vitesse du vent est inférieure à 15 km/h);
- c) la mesure doit être prise entre 2 et 4 m de distance verticale au-dessous du toit fixe (s’il y a moins de 3 m de distance verticale entre le toit fixe et le toit flottant, la mesure doit être prise à la moitié de la distance verticale entre le toit fixe et le toit flottant);
- d) la mesure doit être prise à au moins 2 m des trappes, couvercles et autres dispositifs de contrôle des émissions par lesquels des vapeurs peuvent être échangées avec l’extérieur;
- e) dans le cas de l’inspection annuelle visée au paragraphe 84(2), le niveau de liquide dans le réservoir doit satisfaire aux conditions suivantes :
- (i) être à au moins la moitié du niveau nominal de remplissage de liquide le plus élevé du réservoir,
- (ii) ne pas avoir changé pendant au moins quatre heures avant la prise de la mesure,
- (iii) ne pas changer pendant la prise de mesure.
Procédure
2 La procédure ci-après doit être suivie pour mesurer la concentration des vapeurs de COV dans l’espace situé entre le toit fixe et le toit flottant interne d’un réservoir à toit flottant interne :
- a) utiliser l’un des instruments autorisés prévus au paragraphe 20(2);
- b) consigner les renseignements suivants sur la mesure :
- (i) le type d’instrument qui a été utilisé,
- (ii) la vitesse du vent estimée au moment de la mesure,
- (iii) le volume de liquide dans le réservoir au moment de la mesure et huit heures avant le moment de la mesure, et, le cas échéant, dans le cas de l’inspection annuelle visée au paragraphe 84(2), le volume de liquide quatre heures avant la mesure doit également être consigné,
- (iv) les résultats de la mesure;
- c) si le la mesure de l’instrument est exprimé dans d’autres unités que le pourcentage LIE, convertir la valeur en pourcentage LIE et consigner le premier résultat obtenu par l’instrument, la valeur convertie et le calcul de conversion.
ANNEXE 3
(divisions 8(1)c)(i)(A) et (B) et (ii)(A) et (B), sous-alinéa 46b)(ii) et paragraphe 115(5))
Calcul du facteur de chargement
Facteur de chargement total
1 Le facteur de chargement total d’une installation pour l’année civile précédente est calculé selon la méthode suivante :
- a) déterminer la PVR et la concentration de benzène du liquide de chaque liquide pétrolier volatil chargé à l’installation;
- b) pour les réservoirs à toit fixe et pour chaque type de véhicule recevant un liquide pétrolier volatil d’une rampe de chargement, calculer le facteur de chargement pour chaque liquide pétrolier volatil, selon la formule suivante :
- FC = V ÷ (Fbenz × FPVR × Fcharg × 25 000)
- où :
- FC
- représente le facteur de chargement;
- V
- le volume du liquide volatil pétrolier chargé, calculé selon la manière indiquée à l’alinéa c);
- Fbenz
- la valeur figurant dans la colonne 2 du tableau 1 du présent article, selon la concentration de benzène déterminée à l’alinéa a);
- FPVR
- la valeur figurant dans la colonne 2 du tableau 2 du présent article, selon la PVR déterminée à l’alinéa a);
- Fcharg
- la valeur figurant dans la colonne 2 du tableau 3 du présent article, selon le type de destinataire de la charge figurant à la colonne 1;
- c) pour les réservoirs à toit fixe et pour chaque type de véhicule recevant un liquide pétrolier volatil d’une rampe de chargement à l’installation, déterminer le volume de chaque liquide pétrolier volatil, en m3 normalisés, qui a été chargé sans l’utilisation d’un système de contrôle des vapeurs au cours de l’année civile précédente en tenant compte, selon le cas, des modifications suivantes :
- (i) si aucun chargement de liquide pétrolier volatil n’a eu lieu à l’installation au cours de l’année civile précédente, le volume de chargement prévu pour l’année civile en cours,
- (ii) dans le cas d’un véhicule, si le liquide chargé n’est pas un liquide pétrolier volatil et que le dernier liquide contenu dans le réservoir du véhicule était un liquide pétrolier volatil et que les vapeurs n’ont pas été purgées dans un système de contrôle des vapeurs avant le chargement du liquide qui n’est pas un liquide pétrolier volatil, le liquide chargé est considéré comme étant le dernier liquide pétrolier volatil contenu,
- (iii) si une rampe de chargement était munie d’un système de contrôle des vapeurs en application de l’article 35 durant l’année civile précédente ou l’année civile en cours, le volume de liquide pétrolier volatil chargé avec cette rampe n’est pas inclus dans le calcul du volume;
- d) additionner les facteurs de chargement calculés à l’alinéa b). La valeur obtenue correspond au facteur de chargement total à l’installation.
| Article | Colonne 1 Concentration de benzène (% en poids) |
Colonne 2 Fbenz |
|---|---|---|
| 1 | Moins de 0,5 | 2,4 |
| 2 | 0,5 à 1.0 note 1 du tableau i1 | 1 |
| 3 | 1.1 à 2.0 | 0,6 |
| 4 | 2.1 à 10.0 | 0,2 |
| 5 | Plus de 10 | 0,02 |
Note(s) du tableau i1
|
||
| Article | Colonne 1 PVR (kPa) |
Colonne 2 FPVR |
|---|---|---|
| 1 | 3,5 à 10 | 1 |
| 2 | 10.1 à 35.0 | 2,8 |
| 3 | 35.1 à 65.0 note 1 du tableau i2 | 1 |
| 4 | Plus de 65 | 0,4 |
Note(s) du tableau i2
|
||
| Article | Colonne 1 Destinataire de la charge |
Colonne 2 Fcharg |
|---|---|---|
| 1 | Camion | 1 |
| 2 | Wagon porte-rails | 1 |
| 3 | Navire ou barge de transport | 1,5 |
| 4 | Véhicule autre qu’un camion, un wagon porte-rails, un navire ou une barge de transport | 1 |
| 5 | Réservoir à toit fixe | 1 |
Facteur de chargement journalier total
2 Le facteur de chargement journalier total d’une installation est calculé selon la méthode suivante :
- a) déterminer la PVR et la concentration de benzène du liquide de chaque liquide pétrolier volatil chargé à l’installation;
- b) pour les réservoirs à toit fixe et pour chaque type de véhicule recevant un liquide pétrolier volatil par une rampe de chargement, calculer le facteur de chargement journalier pour chaque liquide pétrolier volatil, selon la formule suivante :
- FCJ = VJ ÷ FJ
- où :
- FCJ
- représente le facteur de chargement journalier;
- VJ
- le volume journalier du liquide volatil pétrolier chargé, calculé selon la manière indiquée à l’alinéa c);
- FJ
- la valeur figurant dans la colonne 3 du tableau du présent article , selon le type de destinataire de la charge figurant à la colonne 1, la concentration de benzène figurant à la colonne 2 et la PVR, selon le cas, figurant à la colonne 3;
- c) pour les réservoirs à toit fixe et pour chaque type de véhicule recevant un liquide pétrolier volatil par une rampe de chargement, déterminer le volume le plus élevé de chaque liquide pétrolier volatil, en m3 normalisés, qui a été chargé sans l’utilisation d’un système de contrôle des vapeurs durant une journée au cours de l’année civile précédente en tenant compte, selon le cas, des modifications suivantes :
- (i) si le liquide chargé n’est pas un liquide pétrolier volatil et que le dernier liquide contenu dans le réservoir du véhicule était un liquide pétrolier volatil et que les vapeurs n’ont pas été purgées dans un système de contrôle des vapeurs avant le chargement du liquide qui n’est pas un liquide pétrolier volatil, le liquide chargé est considéré comme étant le dernier liquide pétrolier volatil contenu,
- (ii) si une rampe de chargement était munie d’un système de contrôle des vapeurs en application de l’article 35 durant cette journée, le volume de liquide pétrolier volatil chargé avec cette rampe n’est pas inclus dans le calcul du volume;
- d) additionner les facteurs de chargement journaliers calculés à l’alinéa b). La valeur obtenue correspond au facteur de chargement journalier total à l’installation.
| Article | Colonne 1 Destinataire de la charge |
Colonne 2 Concentration de benzène (% en poids) |
Colonne 3 FJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Camion, wagon porte-rails, véhicule autre qu’un navire ou une barge de transport, réservoir à toit fixe | (1) Moins de 0,5 |
|
| (2) 0,5 à 1 note 1 du tableau i5 | 500 | ||
| (3) Plus de 1 | 30 | ||
| 2 | Navire ou barge de transport | (1) Moins de 0,5 |
|
| (2) 0,5 à 1 note 2 du tableau i5 | 1 100 | ||
| (3) Plus de 1 | 50 | ||
Note(s) du tableau i5
|
|||
Conditions d’utilisation et Avis de confidentialité
Conditions d’utilisation
Vous êtes tenu de vous assurer que les commentaires que vous formulez ne contiennent aucun des éléments suivants :
- renseignement personnel;
- renseignement protégé ou classifié du gouvernement du Canada;
- commentaire discriminatoire ou qui incite à la discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion, l’orientation sexuelle ou contre tout autre groupe protégé en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne ou de la Charte canadienne des droits et libertés;
- commentaire haineux, diffamatoire ou obscène;
- commentaire menaçant, violent, intimidant ou harcelant;
- commentaire venant à l’encontre des lois fédérales, provinciales ou territoriales du Canada;
- commentaire qui constitue une usurpation d’identité, de la publicité ou du pollupostage;
- commentaire dont le but est d'encourager ou d'inciter une activité criminelle;
- liens externes;
- commentaire rédigé dans une langue autre que le français ou l’anglais;
- commentaire qui contrevient autrement au présent avis.
L’institution fédérale qui gère le changement réglementaire proposé conserve le droit d’examiner et de supprimer les renseignements personnels, les propos haineux ou tout autre renseignement jugé inapproprié à la publication, tel qu’il est décrit ci-dessus.
Les renseignements commerciaux confidentiels ne doivent être affichés que dans la zone de texte réservée à cette fin. En général, « renseignements commerciaux confidentiels » désigne les renseignements qui i) ne sont pas accessibles au public, ii) sont traités de façon confidentielle par la personne dont l’entreprise est concernée par ces renseignements et iii) ont une valeur économique réelle ou potentielle pour la personne ou ses concurrents, car ils ne sont pas accessibles au public et leur divulgation entraînerait une perte financière pour la personne ou un gain important pour ses concurrents. Les commentaires fournis dans la zone réservée aux renseignements commerciaux confidentiels qui correspondent à cette description ne seront pas rendus publics. L’institution fédérale qui gère le changement réglementaire proposé conserve le droit de rendre le commentaire public s’il n’est pas considéré qu’il s’agit d’un renseignement commercial confidentiel.
Vos commentaires seront affichés sur le site Web de la Gazette du Canada à la disposition du public pour examen. Cependant, vous avez le droit de soumettre vos commentaires de façon anonyme. Le cas échéant, vos commentaires seront rendus publics et attribués à une personne anonyme. Aucun autre renseignement à votre sujet ne sera rendu public.
Les commentaires seront affichés sur le site Web de la Gazette du Canada pendant au moins 10 ans.
À l’heure actuelle, la fonction de commentaires en ligne ne prend pas en charge les pièces jointes; les zones de texte ne prennent pas en charge les graphiques, les tableaux ou autres éléments multimédias semblables. Si vous devez joindre une pièce jointe à vos commentaires, veuillez écrire à l’adresse de courriel ministérielle indiquée dans l’avis de publication préalable. Veuillez noter que la communication par courriel public n’est pas sécurisée. Par conséquent, si la pièce jointe à transmettre contient des renseignements de nature délicate, veuillez écrire à l’adresse de courriel ministérielle pour discuter des façons dont vous pouvez transmettre ces renseignements.
Avis de confidentialité
Les renseignements fournis sont recueillis en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, ainsi que des lois habilitantes des organismes de réglementation concernés, aux fins de recueillir des commentaires liés aux changements réglementaires. Vos commentaires et vos documents sont recueillis dans le but d’accroître la transparence du processus réglementaire et de rendre le gouvernement plus accessible aux Canadiens.
Les renseignements personnels soumis sont recueillis, utilisés, communiqués, conservés et protégés contre l’accès par les personnes ou les organismes non autorisés conformément aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels et du Règlement sur la protection des renseignements personnels. Les noms des personnes fournis ne seront pas affichés en ligne; ils seront toutefois conservés pour que nous puissions communiquer avec ces personnes au besoin. Les noms des organisations qui formulent des commentaires seront affichés en ligne.
Les renseignements soumis, y compris les renseignements personnels, seront accessibles à Services publics et Approvisionnement Canada, à qui incombe les responsabilités de la page Web de la Gazette du Canada, et à l’institution fédérale responsable de la gestion du changement réglementaire proposé.
Toute personne est en droit de demander que les renseignements personnels la concernant lui soient communiqués ou qu’ils soient corrigés. Pour demander l’accès à vos renseignements personnels ou leur correction, communiquez avec le Bureau de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) de l’institution fédérale responsable de la gestion du changement réglementaire proposé.
Vous pouvez adresser une plainte au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada au sujet de la gestion de vos renseignements personnels par une institution fédérale.
Les renseignements personnels fournis sont versés dans le fichier de renseignements personnels POU 938 Activités de sensibilisation. Les personnes qui souhaitent accéder à leurs renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels doivent en faire la demande à l’organisme de réglementation compétent en fournissant suffisamment de renseignements pour permettre à l’institution fédérale de récupérer les renseignements personnels concernant ces personnes. L’institution fédérale pourrait avoir de la difficulté à retracer les renseignements personnels au sujet de personnes qui formulent des commentaires de façon anonyme et qui demandent l’accès à leurs renseignements personnels.